 Médecins de la Grande Guerre
Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Conférences
-
Conférences
-
![]() Articles
Articles
![]() Photos
-
Photos
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
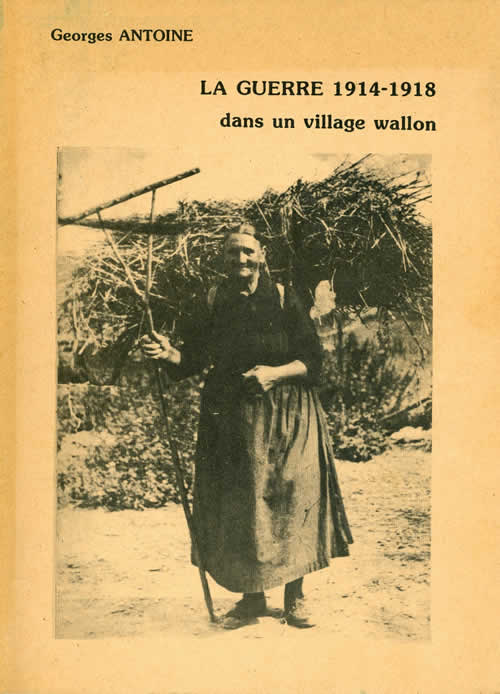
La Guerre 1914-1918 Georges Antoine AVANT-PROPOS Evoquer aujourd'hui la guerre de 14/18, est-ce que cela intéresse vraiment la population actuelle ? Seuls l'ont connue, une dizaine de témoins habitant encore la localité. Tous les soldats qui ont dû l'affronter, nous les avons, avec tristesse, conduits au cimetière. Alors, on oublie tout ? On en a bien assez avec nos problèmes, la crise, le chômage, les « Modérations », beau mot qui n'exprime pas tout ce qu'il veut dire. On brise le maillon de la chaîne qui nous relie au passé ? Mais on ne peut non plus nier que les gros soucis de la vie présente, réels, inquiétants certes, sont relativement légers, si on les met en balance avec la guerre, la Tueuse. Il est peut-être utile de comparer les situations entre 1914 et aujourd'hui, à quelque septante ans de distance. Car la génération d'alors nous apporte une expérience riche de faits vécus, de souffrances endurées, de privations imposées, de liberté perdue, de contrainte de l'étranger. Ceux de 14/18, civils comme soldats, pensaient à leurs enfants et à leur descendance future, c'est-à-dire à nous. Leur mentalité qui renaît dans cette étude nous apprendra que le fond de leur pensée correspond encore à la nôtre. Est-ce que Binche oublie ses Gilles, Mons son Doudou, Liège son Tchantchès, Namur ses Echassiers, Florennes et d'autres cités d'Entre- Sambre-et-Meuse, leurs marches militaires ? Nous voulons rester nous-mêmes avec un rejet absolu d'occupation par un étranger quel qu'il soit, quelles que soient les idéologies qui passent et dans lesquelles nous ne nous reconnaissons pas. Notre sens de la vie a été et est toujours l'indépendance et la liberté individuelle. En se coupant de ses racines, on perd sa personnalité, on devient des « va comme je te pousse » ou mieux, comme poussent les médias engagés, les informations truquées, les groupes violents de pression. Il est intéressant de constater comment après le désarroi profond de l'évacuation d'août 1914, la population s'est ressaisie et a trouvé les moyens de survivre, oh, pas facilement ni plantureusement, pendant quatre ans. Elle s'est ingéniée par ruse à échapper aux réquisitions et aux visées de l'ennemi. Elle a voulu rester digne des siens qui risquaient leur vie, pour elle, là-bas, à l'Yser. Les événements de 14/18 ont frappé très vivement les mémoires de ceux qui avaient sept ans et plus ; ils en ont conservé des souvenirs très précis qui se recoupent et se complètent, sur les horreurs d'août 1914 et sur la longue nuit de l'occupation. Ceux qui savent encore m'ont raconté ce qu'ils ont vécu alors. Je les remercie de leur collaboration. Plusieurs sont décédés depuis, dix. déjà. C'est leur histoire à tous qui sera ainsi transmise à la génération actuelle. En voici la liste par ordre alphabétique: Anceau Albert, Antoine Jeanne, Bajomez Lise, Bienfait Simone, Brichot Madeleine, Censier Germaine, Cosme Madeleine, Cosme Louisa, Ernould Alfred, Grégoire Mariette, Hiernaux Hélène, Laffineur Alfred, Laurent Célina, Laurent Denise, Marotte Germaine, Martens Marie, Piron Philomène, Thirifay Agnès, Thirifay Jeanne, Thibaut Régina et Wayens Suzanne. Des indications m'ont été apportées d'après les récits de leur famille par André Jeanne, Beaumont Marcelle, Brichot Irène, China Eva, Collin Laure, Henquin Marie et Marcelle, Légère Gaston. D'autre part les archives communales consultées ont permis d'évaluer les difficultés et les responsabilités des élus communaux. Avec peu de revenus, ayant dû dès lors contracter des emprunts remboursables après la guerre, ils durent protéger la population, surtout les plus démunis, et ils étaient nombreux en ces temps-là, payer leur personnel complètement à leur charge alors et se plier, le moins possible, aux exigences de l'ennemi. CHAPITRE I Doische est un village d'Entre-Sambre-et-Meuse étalé en longueur au pied et sur les pentes d'un plateau d'altitude de 220 mètres, qui descend brusquement à 170 mètres au seuil de l'église, puis s'ouvre sur une plaine où roule le ruisseau du lieu, le Marais. La plus ancienne partie du village est groupée aux environs de l'église nouvelle bâtie en 1860. Les maisons aux murs épais formés de moellons calcaires tirés sur place dans nos anciennes carrières, aujourd'hui abandonnées, avaient toutes, outre le logement, une écurie, une grange et un fenil ; car, pendant des siècles, la culture avait été, avec les bois, les seules ressources de la population. Quelques habitations portant des dates très anciennes (1573, 1611, 1623), ayant appartenu aux plus aisés, avaient des assises bien régulières de pierres taillées. Depuis 1860, Doische avait sa gare avec deux lignes de chemin de fer : Anor-Hastière, compagnie française, le petit Chimay, comme on l'appelait, et Lodelinsart-Givet. Une singularité en cette gare de Givet : elle présentait deux guichets voisins portant en grandes lettres : Trains belges Trains français. Ces inscriptions étaient dominées par deux horloges : la française marquait 5 à 6 minutes de plus que la belge. C'est que la France réglait l'heure sur le méridien de Paris et la Belgique sur celui de Greenwich, suivant l'heure anglaise. De 1860 à 1914, des maisons nouvelles s'installeront le long de la nouvelle route empierrée menant à la gare. On les construira en briques avec des ouvertures plus larges, plus vastes, plus hautes aussi, coiffées de toits d'ardoises violettes. Des gens avisés, parmi lesquels des cabaretiers, fixeront leur demeure dans le nouveau quartier de la gare. Un vide séparait ce quartier du reste du village. Là, dans les prés bas inondés fréquemment lors des orages ou des fontes de neige, coulait le fossé de la Jonquière. Une grand-route Liège-Philippeville construite au temps de la Principauté de Liège, reliait la commune aux villes voisines. Village frontière, Doische avait beaucoup de relations avec la France dont les usines établies le long de la Meuse recrutaient de la main d'uvre belge. La plus proche, celle d'Aubrives, fabriquait du matériel en fonte pour distributions d'eau ; tuyaux, bornes-fontaines, bouches d'égout. Elle employait du personnel qualifié : modeleurs, mouleurs, ajusteurs, au salaire de 6 à 7 francs par jour et des manuvres gagnant 2,50 frs après 12 heures de travail de 6 à 6, sans congés payés. De plus, les ouvriers de Doische faisaient en plus la route à pied, 5 km matin et soir, été comme hiver, marchant sur les trieux sur trois ou quatre sentiers parallèles. Les mieux lotis avaient un vélo. Tous ces ouvriers étaient payés par quinzaine en pièces de 5 francs. Les gueuzes venaient du bassin de Lorraine, le charbon de Charleroi et le port d'exportation était Anvers. Vireux avait son aciérie avec un haut-fourneau et travaillait pour les chemins de fer et la marine. Une fabrique de soie artificielle à Givet employait un personnel nombreux, surtout féminin. On y était payé en or. Des carrières (Trois Fontaines, Gimnée), encore en activité, vendaient des moellons pour bâtir, des pierres de taille, de grandes dalles rectangulaires pour paver, des pierrailles pour la route. Des artisans encore nombreux offraient leurs services à la population. Des maçons, pour les maisons neuves ou à moderniser et pour la forteresse de Charlemont, employaient du mortier au sablé (cense Lahaye ou Niverlée) et de la chaux provenant des calcaires calcinés dans les fours de Gimnée. Des menuisiers façonnaient le bois pour les bâtiments, les charpentes, les meubles, les cercueils. Un forgeron battait l'enclume de son lourd marteau transformant le fer rougi en outils, fers à chevaux ou à bufs, et cerclant les grandes roues des chariots. Il y avait aussi un poêlier expert en cuisinières avec coffre et plate-buse ou en poêles à colonne « Je brûle tout l'hiver sans m'éteindre » et un plombier-zingueur pour gouttières, soudures, rétamage des cuillers et fourchettes. Le boucher-charcutier servait la viande que les ouvriers mangeaient le dimanche, souvent du bouilli ou de la charcuterie, quitte à compléter l'ordinaire par du petit élevage : lapins et poules. Le cordonnier vendait de fines bottines, mais surtout de bons gros souliers de travail garnis de clous du talon à la pointe, ressemelant jusqu'à usure complète, mais il était aussi capable de monter lui-même une belle paire de chaussures. Des tailleurs de pierre préparaient des encadrements de portes et de fenêtres, des éviers et des baquets, ils devenaient artistes pour les monuments funéraires. Le peintre savait aussi coller du papier peint, blanchir murs et plafonds à la chaux et rapetasser les souliers non achetés chez le cordonnier. Une modiste présentait au public féminin ses éternelles nouveautés en paille ou en feutre et préparait pour les enterrements les grands voiles de crêpe. Des couturières faisaient du neuf, réparaient à domicile, emmenant parfois leur machine à coudre. Un ardoisier réparait les toits d'ardoises. Il restait deux maisons couvertes de chaume au Quartier. Les usines française avaient attiré à Doische pas mal de familles nombreuses venant de Morville-Anthée dans l'espoir d'une amélioration de leurs revenus. Certes, de vieilles familles terriennes étaient restées fidèles à l'agriculture. La ferme du Marais était louée à Monsieur Delcourt. Les Anceau, André, Censier, Henquin Jules avaient gardé confiance dans la glèbe nourricière. Pas de tracteurs bien sûr, encore peu de machines. La faux maniée avec dextérité coupait à ras du sol herbe et denrées très tôt le matin tant qu'il y avait de la rosée. Semailles poignée après poignée. Battage au fléau, tout au long de l'hiver, des céréales engrangées puis des meules d'épeautre, de froment ou de seigle. Quatre commerçants (Hurel, Defooz, Pilpay, Rochet) servaient leurs clients en puisant avec des pelles dans des casiers remplis de sucre en morceaux, café, cassonade, sel, placés côte à côte, et en emplissaient des sachets pesés dans la grande balance à deux plateaux, car ils n'avaient pas de marchandises emballées. On trouvait chez eux aussi alcool, vinaigre, huile, tabac à fumer ou à chiquer, allumettes, un peu d'aunage. Dans un coin isolé se trouvait un gros tonneau de pétrole où l'on emplissait bouteilles et bidons. Pour l'achat d'un bon costume il fallait se déplacer à Florennes ou à Dinant. Pour 100 francs, un homme flambant neuf sortait du magasin : chapeau, chemise, cravate, un complet chic, chaussettes et souliers, mais, à l'époque, on gagnait de 2,50 frs à 7 frs par jour. Les cafés, très nombreux (une maison sur quatre environ) portaient comme enseigne au dessus de la porte d'entrée une branche de « petton » (genévrier croissant sur les tiennes de Foisches). On y jouait aux cartes et on bavardait entre amis et connaissances. On y servait des gouttes à un sou ou à deux sous dans des verres semblant bien grands, mais au fond épais à souhait et aussi, tirée au tonneau, de la bière naturelle et rafraîchissante. Au carnaval on savait joindre la farce à la bonne humeur : les jeunes, masqués s'installaient à table, se laissaient servir puis, apportant un vieux rouet et une poignée de laine, demandaient : « Peut-on filer ? » Alors ils partaient sans payer puisqu'ils pouvaient filer... à l'anglaise. D'aucuns ayant exagéré, ne rentraient qu'aux petites heures le lundi et cuvaient leur boisson et ils chantaient encore, les brigands : « Quand Joseph fait l'lundi, i gna s'femme qui l'berdelle ». Tandis que le mari reprenait ses esprits embués par l'eau de vie, la femme qui ne s'amusait guère menait paître les vaches, fermant la porte à clef après avoir caché les souliers du soulard. Et celui-ci redevenu conscient mais non corrigé trouvait moyen d'enlever quelques tuiles du toit et d'aller retrouver les copains en sabots. Il existait aussi des cabaretières par trop intéressées qui, voyant la clientèle prête à sortir disaient : « Asseyez-vous, je vous paie une bonne tasse de café percé », (du café fort). Certains allaient à la ducasse à pied à Romedenne (7 km), y buvaient, y dansaient, s'y battaient, quitte à revenir à pied vers les quatre heures du matin, se changer, remettre leur costume de travail et faire encore une heure de route, toujours à pied, pour être à l'usine à six heures. Le hameau de Petit-Doische recevait dans ses cafés les militaires de la garnison de Givet, le 148e de ligne, en plus des artilleurs de Charlemont. Il y avait plusieurs mariages de jeunes filles du lieu avec des soldats français. C'était une vie gaie, insouciante. On pratiquait la devise ; « On n'est pas riche mais on vit bien ». N'allez pas conclure que tous les hommes de Doische étaient des ivrognes. Les fêtes étaient de grands moments de détente dans une vie souvent très besogneuse. La brasserie Collin, dans ses grandes cuves, faisait de l'excellente bière livrée à domicile, aux particuliers, aux grandes fermes occupant du personnel et aux cafés. Les garçons brasseurs partaient avec un long haquet tiré par deux solides chevaux. C'était un chariot étroit sur lequel étaient placés bout à bout les tonneaux de 50 litres, 100 litres et plus. Le village frontière de Doische avait aussi ses agents des douanes : ceux de la gare pour surveiller les voyageurs venant de Givet et ceux qui circulaient à pied selon le rôle déterminé journellement par leur brigadier aux aguets sur les routes secondaires et les sentiers. Ils occupaient comme locataires les maisons disponibles et changeaient fréquemment de centre d'attache. En service, ils construisaient parfois des cabanes pour s'abriter et mieux épier. Par beau temps ils emportaient leur lit sur le dos. De petits fraudeurs jouaient à cache-cache avec eux, à leurs risques et périls. On passait en France, tabac, jeux de cartes, café, allumettes... On s'y approvisionnait en chaussures, alcools vins, parfums. On allait à pied à Givet avec de vieilles savates et on revenait au train avec des souliers neufs. Et les lavandières partaient au travail avec un sac à double fond pour y cacher du café. Un loustic avait trouvé un bon stratagème : arrivé en gare de Doische, il passait la main par la portière à contre-voie et déposait une bouteille de « pecket » sur le toit de la voiture du train échappant ainsi au contrôle ; il la reprenait lorsque le train se remettait en route et descendait à l'arrêt suivant, à Gimnée. Il fit cela jusqu'à ce qu'il fut « vendu ». Un jour, un douanier français eut bien du plaisir. Arrivait vers lui un bonhomme qui, voyant le danger, se débarrassa d'une boîte de cigares en la jetant au pied d'une haie. L'interrogatoire commença : « Pas d'tabaque ? ». L'interpellé répondit : « Non » la main sur le cur pour se faire convainquant. « Et ça alors, c'est quoi ? ». Et le douanier indiquait le chien fidèle (?) qui rapportait dans sa gueule la boîte de cigares à son maître. Le village comptait deux écoles primaires peuplées chacune d'une quarantaine d'élèves. L'instituteur, Monsieur Maistriaux, tenait une classe où l'on savait lire, conjuguer, écrire à peu près sans faute, construire une bonne phrase, résoudre opérations et problèmes. L'institutrice, Mademoiselle Feys, prenait les filles et leur apprenait en plus les travaux de couture et de tricot, sans maîtresse spéciale. A noter que les traitements des enseignants étaient à charge de la commune comme ceux des autres employés : secrétaire, trésorier, garde champêtre et fossoyeur. L'instituteur nommé le 19 mai 1893 avait droit à 1800 frs (par an). Son traitement fut porté à 1900 frs au 1er janvier 1914 après 20 ans de service. L'institutrice nommée le 18 janvier 1905 n'avait à toucher que 1300 frs, somme portée à 1400 frs au 1er janvier 1914. Il n 'y avait à Doische en 1914 que trois autos : le notaire Jeanmart, le docteur Dubois et Monsieur Octave Thibaut commerçant en cafés. Quelques particuliers et fermiers possédaient une charrette à cheval pour leurs déplacements, leur commerce ou pour se rendre au marché. Un nouveau curé, l'abbé Pirmez, était arrivé en janvier 1914. Il animait une chorale féminine, aimait les beaux offices, prenait contact avec son petit monde. Le conseil communal renouvelé par élection le 15 octobre 1911 était présidé par Monsieur Hubert Hennard, Echevin faisant fonction de Bourgmestre, assisté de Messieurs Fesler Jules, Cosme Joseph, Brichot Adolphe, Penasse Arthur et Pilpay Ferdinand. Ils vont connaître bien des difficultés au cours de l'occupation allemande. Il y en avait un septième qu'on trouvera plus loin. 
CHAPITRE
II C'est dans ce pays paisible et laborieux, vivant loin de l'aisance actuelle mais en progrès notable sur les générations précédentes qu'éclata soudain la guerre. Pas de radio ni de télévision, quelques rares journaux, peu de nouvelles pour la masse de la population. Les soldats rappelés rejoignaient leurs unités sans trop s'alarmer, une affaire de quelques jours de mobilisation. On croyait encore à notre neutralité garantie solennellement par nos grands voisins. Aussi est-ce avec stupéfaction et horreur que l'on apprit l'invasion du 4 août 1914, puis les durs combats contre la position fortifiée de Liège. Des fantassins français entraient en masse pour seconder notre armée. L'inquiétude grandissait. Le 15 août déjà, les Allemands étaient à Dinant d'où les Français du 148e les délogèrent. La marée ennemie s'élargissait du Luxembourg à l'Escaut. Le 23 août les Allemands prirent le malheureux Dinant, brûlant la ville et massacrant 672 civils, en emmenant d'autres en captivité. A Doische aussi les Français reculent, emportant leurs blessés hospitalisés dans la maison Thibaut, forçant des fermiers à transporter leur matériel. La ferme Anceau Hector doit leur fournir un chariot mené par le domestique Petit Pierre. A Gimnée aussi les fermiers sont mis à contribution. L'un d'eux, Camille Couvreur, ne peut revenir chez lui et ne rentrera que fin 1918. Soudain, en gare de Doische, arrive un train. Le bruit court que c'est le dernier train, l'ennemi va arriver. Dans l'affolement on se précipite dans les wagons sauveurs : le chef de gare, les employés, les ouvriers qui ont pu avertir les leurs. Ainsi partent les familles Hubert, Tayenne, Jourdain parents et jeunes gens, Anceau Cyrille et aussi Laffineur. Charles Burton, 14 ans, porteur de télégramme, s'engouffre aussi dans le train sans s'occuper de sa famille, les parents Grégoire aussi, pensant que leurs filles étaient montées. Les nerfs craquaient. A Mariembourg, à l'arrêt, les parents Jourdain et leu fille Clotilde, les parents Grégoire et Monsieur Laffineur descendent, préférant rester au pays malgré le danger. La famille Bernard Hurel avec leurs filles Bertha et Julia, dont les maris étaient mobilisés, filèrent vers la France déjà vers le 6 août et passèrent la guerre derrière le front. La famille Collin après le massacre de Dinant attela sa charrette et s'en fut loin des lignes de combat. Dans la nuit du 24 au 25 août, une très forte concentration de troupes françaises attendait les ordres. Les soldats se reposaient couchés côte à côte, partout, sur le chemin, dans les fossés, sur les prairies. La forteresse de Charlemont tirait sur Romedenne et Surice. On entendait siffler les obus au dessus de nous. Que se passait-il là-bas ? Enjambant les fantassins dormant partout, nous arrivons sur le Plémont et nous voyons avec horreur Romedenne en flammes. Du Tienne du Bois, de la Pireuse, de partout on regardait ces flammes hallucinantes. Les Allemands étaient là, tout près, aussi barbares qu'à Dinant. Certains ont même perçu des bruits de cavaliers ennemis en patrouille. Le 25 au matin, les Français s'écoulèrent rapidement par la vallée de la Meuse. Quel sort nous attendait ? Où aller ? Quelques-uns se rendirent à Vaucelles qui ne semblait pas être dans l'axe de marche des armées. Jules Ernould Légère, garde forestier qui connaissait tous les recoins du bois, se réfugia avec sa famille, celle d'Alphonse Ernould Laurent, avec Berthe et Madeleine, le notaire et le curé Pirmez dans une grotte souterraine à Vaucelles. Celle-ci était assez vaste pour s'y installer et s'y coucher. De là ils voyaient des uhlans sur la route de Mazée. Alphonse Ernould dans un moment de calme, descendit au village chez sa sur ; aucun danger n'apparaissant, il alla chercher les siens puis revint à Vaucelles et à Gimnée. Les autres du groupe regagnèrent Doische. La famille Thirifay et Adolphe Legros partirent à pied pour Treignes, logeant dans un fenil. Les Allemands arrivent de Gimnée, leur demandant des renseignements sur Charlemont. Ils reviennent chez eux, mais le 27 août, départ en chariot pour Merlemont avec Joseph Legros et la famille d'Achille Toussaint. C'est là que vint au monde la petite Berthe Toussaint dans des circonstances bien pénibles. Vers le 23 août, le groupe Henquin Hector et Hiernaux, avec une impotente et une petite Lucienne de 4 mois, emprunte un tombereau au brasseur Collin. C'est la cohue des émigrants et des soldats. Ils atteignent Mariembourg mais ne peuvent continuer. Ils reviennent par Matagne-la-Petite où ils rencontrent les Allemands. C'étaient les mauvais bougres qui avaient brûlé Surice et Romedenne, prétextant avoir été attaqués par des francs-tireurs. L'abbé Sohet, ancien curé de Doische put parler à un officier de haut grade, se portant garant pour sa paroisse, affirmant que personne ne tirerait sur les soldats. Cela détendit l'atmosphère ! Toutefois les hommes furent enfermés dans l'église, les femmes allèrent se cacher dans les caves. Le curé obtint que deux soldats aillent chercher la mère impotente pour l'amener à la cure. On resta là 2 ou 3 jours. Le tombereau, son contenu et le cheval avaient disparu. Le calme étant revenu, la famille put profiter d'une charrette à baudet qui la déposa à la barrière de Romedenne sur la grand-route. De là on transporta l'infirme en brouette jusqu'au Crestia. Là, le père Masson attela vivement son petit cheval et on retrouva la maison. Mais ce n'est pas tout encore. Le 27 août, nouveau départ général. Cette fois la famille put partir en chariot avec Lucien Squélart pour se fixer à Vodecée. On sut par eux qu'Alcide Crassin, ouvrier à la gare de Doische, avait été tué sur les tiennes de Matagne. Pourquoi ? Peut-être, à cause de son képi, fut-il pris pour un Français ? Eugène Censier et les siens, sans oublier la petite Denise née en juin 14 et la famille de son frère Germain s'arrêtent à Treignes où ils logent chez les Demoiselles Martin. Lambert Anceau qui se trouvait là fut réquisitionné pour donner des indications sur Charlemont et aller montrer les emplacements des ouvrages militaires. Au retour ils furent encore en péril lors d'une escarmouche entre soldats français et allemands. Et le 27 août, nouveau départ pour Florennes cette fois. Les Wayens avec leurs enfants passent une nuit à Vaucelles. Des uhlans arrivent par la route de la Gueuze, entrent à la brasserie. Vital leur sert de la bière mais ils ne boivent qu'après qu'il eut vidé son verre. Quelle méfiance ! Et le 27 août, toute la famille part pour Merlemont avec les Burton, chacun emportant un pain. Le 26 août, les Allemands entrent à Doische ; quelques soldats, doigt sur la gâchette, précèdent un groupe plus nombreux. On sort des maisons pour leur passage. Pas d'incident. Mais le 27 août, de grand matin, le bourgmestre faisant fonction, Hubert Hennard, accompagné d'un officier allemand, frappe à toutes les portes : ordre de quitter le village immédiatement sans délai possible. C'était, disait-il, pour protéger la population civile pendant le siège de Charlemont. Point de rassemblement : Villers-le-Gambon. Les fermiers attellent leurs chevaux, chargent matelas, linge, saloir, et prennent sur leurs chariots parents et amis, chacun avec le strict nécessaire. Ainsi partirent les familles Hector Anceau et Thibaut Octave essayant de gagner Mettet où elles avaient de la parenté. A Villers-le-Gambon, elles rencontrèrent la famille Delcourt avec le notaire Jeanmart et l'abbé Pirmez en route pour trouver refuge à Sart-Eustache. Plein d'angoisse et de regret, chacun abandonnait, porte ouverte, sa chère maison. Beaucoup partaient à pied, groupés autour d'un vélo chargé de ballots. D'autres s'en allaient avec une voiture d'enfant où s'accumulaient valises, vivres et objets de ménage. En route vers l'inconnu menaçant, les vieilles gens se demandaient où elles allaient vivre leur dernière heure. Les parents, pleins d'appréhension pour leurs enfants, songeaient à leurs maigres ressources. Qui les accueillerait ? Le plus grand nombre trouva refuge à Villers-le-Gambon dans les bâtiments d'une carrière. Puis on fut refoulé vers Merlemont et de là vers Sautour. Ma famille a suivi cet itinéraire à pied, poussant la vieille voiture d'enfant à quatre roues, emportant un grand pot de lait car les enfants relevaient de la scarlatine et ne pouvaient manger normalement. Germain Laurent et son épouse Rosa firent le même trajet à pied avec une petite Alphonsine née en janvier 1914. Les familles en exode avançaient un peu au hasard, selon des on dit peu crédibles. Quelques-uns, Auguste China, Adolphe Brichot et les leurs se rendirent à Gimnée et eurent de la chance car ce village ne fut pas contraint d'évacuer. Mais le major Allemand Schuman avait affiché l'avis que voici en allemand : « Je suis obligé de prendre des otages. On fusillera des otages sans pitié si l'on tire sur les soldats allemands. En outre on brûlera les maisons d'où l'on a tiré. Chaque habitant doit être chez lui à 7 heures. Quiconque se trouve encore au chemin, sera mis en prison. Les maisons dont les habitants sont déjà rentrés doivent être éclairées par une lampe ou bougie au moins pendant toute la nuit ». Des hommes pris comme otages furent enfermés dans l'église. Henri André, les siens et les Miliche furent arrêtés en chemin par des soldats qui les interrogèrent et les fouillèrent. Le douanier Miliche qui avait sur lui son pistolet de service fut froidement abattu devant sa femme et ses trois enfants qui en restèrent gravement traumatisés. La panique s'en mêlait : Marie Martens, 9 ans, était au Culot (route de Vaucelles) chez sa grand-mère Sidonie et ses deux tantes. Elles trouvèrent place, bien contentes dans la charrette à baudet de Catherine Dinant, et, fouette cocher, arrivèrent ainsi à Florennes, cependant que les parents Martens étaient forcés de s'en aller d'un autre côté, sans savoir où était leur fille. La famille Beaumont Valentin vécut des jours atroces. Le père devait garder le lit, immobilisé, un genou plâtré. Il y avait quatre enfants nés en 1909, 1912, 1913 et 1914. Il fallut partir sans moyen de transport. La mère Scieur Julia, heureusement forte, ne put rien faire d'autre que d'installer avec des coussins, son mari dans une brouette. L'aînée Noëlle marchait, les 3 autres étaient auprès du père. Ils s'en furent ainsi jusqu'à Fumay par les routes encombrées de soldats et d'émigrants. Un militaire pris de pitié portait la petite Noëlle. Soudain, dans un remous de la circulation, il perdit de vue la famille en détresse et dut confier l'enfant épouvantée, sachant à peine s'expliquer, à de braves gens de Fumay qui purent retrouver les parents. Autre équipée : celle du groupe Piron Joseph et Lambeau René, deux beaux-frères avec leurs enfants. Ils se tirèrent d'embarras avec un tombereau à charbon du père Staf. Les hommes traînèrent le peu commode véhicule jusqu'à Merlemont où ils se fixèrent. Ils y retrouvèrent la famille Ernould Vital. Autre direction : Clotilde Laret et ses enfants, Hélène, Edouard et Camille étaient allés à Petit-Doische chez la Grand-mère Léonie. Charlemont y bombardait les Allemands qui firent partir tout le groupe vers le nord. Ils allèrent jusqu'à Anseremme. Julie Demanet, épouse de Légère Fernand, mobilisé, avec sa sur Elise purent, à temps, gagner Treignes et, par les sentiers des bois, se mettre en lieu sûr au Mesnil. Joseph Cosme avec son épouse Vitaline et leurs cinq enfants décidèrent de se rendre chez une tante Amélie à Givet. Joseph put parler avec Ernest Loison, soldat français marié à Doische et qui fut prisonnier après la reddition de la forteresse. Ils purent revenir mais accompagnés d'un soldat allemand qui devait les conduire à Gimnée. Tout de même ce soldat leur permit d'entrer quelques minutes chez eux pour se désaltérer (c'était un café), et comme le village était évacué ils partirent pour Gimnée emmenant avec eux Lydie qu'ils rencontrèrent. Autre situation. Les parents Grégoire étaient partis, on l'a vu, au dernier train et, voyant que leurs filles Mariette et Madeleine n'étaient pas dans le convoi, descendirent à Mariembourg. Celles-ci étaient parties à pied à Vierves avec un chef garde de train connu d'elles. Il y avait combat et les villageois s'étaient réfugiés dans les bois. Les Grégoire purent enfin se réunir. Ils essayèrent de rentrer par des sentiers vers Treignes. Ils avaient retrouvé Germain Brichot et les siens. Comme il y avait quelques soldats français si repérables avec leurs pantalons rouges en 1914, ils subirent des coups de feu mais purent s'éclipser sans dommage. 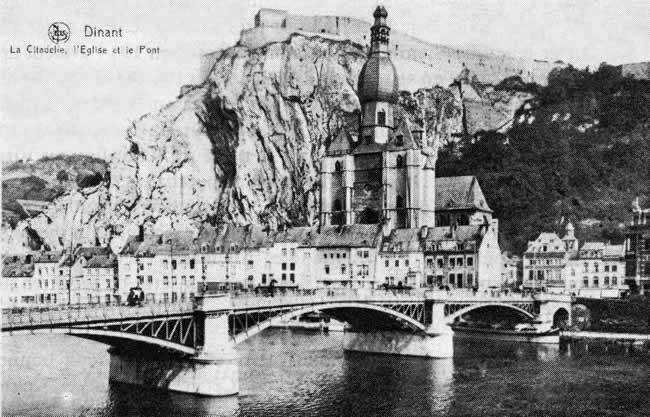
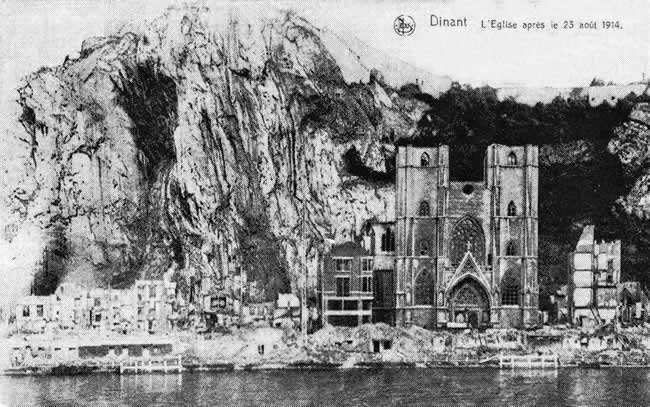
Désiré Laurent, mobilisé à Namur, avait reçu la visite de son épouse Cécile accompagnée d'une amie. Les deux femmes parties à pied, hotte au dos, avaient pu lui· parler et lui donner du linge. A la chute de la ville, il put échapper à la captivité et revenir à Doische. Il fut le témoin d'un fait tragique. Les Allemands avaient arrêté Joseph Dumonceau, sourd et muet, domestique à la ferme Anceau et qui essayait de gagner Foisches. Le malheureux ne put évidemment pas parler ni s'expliquer. Il fut abattu près de l'église. Peu après, les Bienfait et leur fille Simone qui habitaient Rosée en 1914 avaient cru se mettre en sécurité en se rendant à Treignes. Ils traversèrent Doische, abandonné par ses habitants évacués et virent sur les marches de l'église, le cadavre de Dumonceau. Le malheureux fut enterré sans cercueil le long d'une haie à droite de la route de Vaucelles par Vital Wayens et Félix Bayet. Après la guerre on rechercha ses restes pour les déposer au cimetière : on retrouva les os et les souliers. Quand à Désiré Laurent qui put quitter les lieux inaperçu, il se cacha un bon moment chez Houbat puis rentra chez lui. Les Allemands, accompagnés du Bourgmestre, vinrent l'y chercher, il invoqua son état de santé et fut par chance relâché. Une note plus gaie. Pendant cette évacuation, deux bonnes fermières qui tenaient quelques vaches, Cécile Henquin et Célina Légère, osèrent revenir à travers champs et bois pour savoir ce que devenait le bétail abandonné. Celui-ci broutait en paix. Elles rencontrèrent des soldats près de la fontaine de la Gueuze. Etaient-ils fermiers ? Leur parurent-elles inoffensives ? Ils les laissèrent passer. Les armées étaient engagées sur le territoire français. Après la fameuse bataille de la Marne, le front se fixa de la Suisse à l'Yser, c'était la guerre de tranchées. A Doische, à partir du 3 septembre, la population revint par petits groupes. Toutes les maisons avaient été occupées, fouillées, pillées : matelas, linge, ustensiles de cuisine étaient éparpillés un peu partout selon la fantaisie des soldats et des émigrés. On récupéra quelques objets épars. Et surtout il fallut un solide nettoyage de la cave au grenier. Après notre retour un voisin, pendant qu'on lavait tout, nous disait « On féce » en wallon, ce qui veut dire : nettoyer une étable ! On faisait jour après jour l'inventaire de ce qui avait disparu. Mais qu'on était heureux d'avoir retrouvé la maison intacte ! CHAPITRE
III On
était au début septembre. L'usine d'Aubrives avait
fermé ses portes. Fin 1914 et début 1915, rien n'était encore organisé pour ravitailler
la population. Les stocks de farine de nos boulangers, échappés au pillage,
furent vite épuisés de même que ceux de la boulangerie de Romerée.
Les gens allaient glaner, à plusieurs par famille. Après leur passage, on
n'aurait plus trouvé un épi par terre en fouillant à la loupe. Quand le fermier
enlevait les dizeaux, c'était la ruée. Le peu de froment qu'on avait pu glaner
ou acheter était conduit aux moulins de Vaucelles ou
de Vodelée qui s'étaient vite équipés pour moudre épeautre,
froment et seigle. On y courait avec brouette, hotte, voiture d'enfant, par
route et par sentiers des bois. Certains essayaient de vieux moulins à bras,
voire des moulins à café. Et il fallait de la levure. Sylvain Beaumont, le père
Manjot, Lambertine China
s'en procuraient à Charleroi et environs en allant la chercher en charrette à
cheval ou charrette à bras. D'autres en revenaient au levain : morceau de pâte fermentée,
conservée au frais pour incorporer à la future cuisson. Quelques petits
propriétaires se hâtaient de faire labourer un pré pour y semer surtout de
l'épeautre, cette vieille céréale rustique qui pousse quand même dans des
terrains moins riches. Les ouvriers en chômage cherchaient du travail dans les
fermes à 2,50 frs ou 3 frs par jour. C'est fini à jamais la boule de pain à 7
sous et la livre de beurre à 28 ou 30 sous de 5 centimes ! Une
amélioration s'imposait: un accord conclu entre le gouvernement belge du Havre
et le président des Etats-Unis Hoover et accepté par les Allemands, permit aux
Américains d'envoyer des vivres. Les gros navires chargés de blé purent
atteindre Anvers et déverser leur précieux contenu dans trains et péniches.
Celles-ci remontaient la Meuse. A Givet, comme ailleurs, les ponts avaient
sauté lors de la ruée Allemande. On avait établi un nouveau pont sur des
bateaux placés côte à côte. Il fallait interrompre la circulation pour livrer passage
aux péniches à blé. 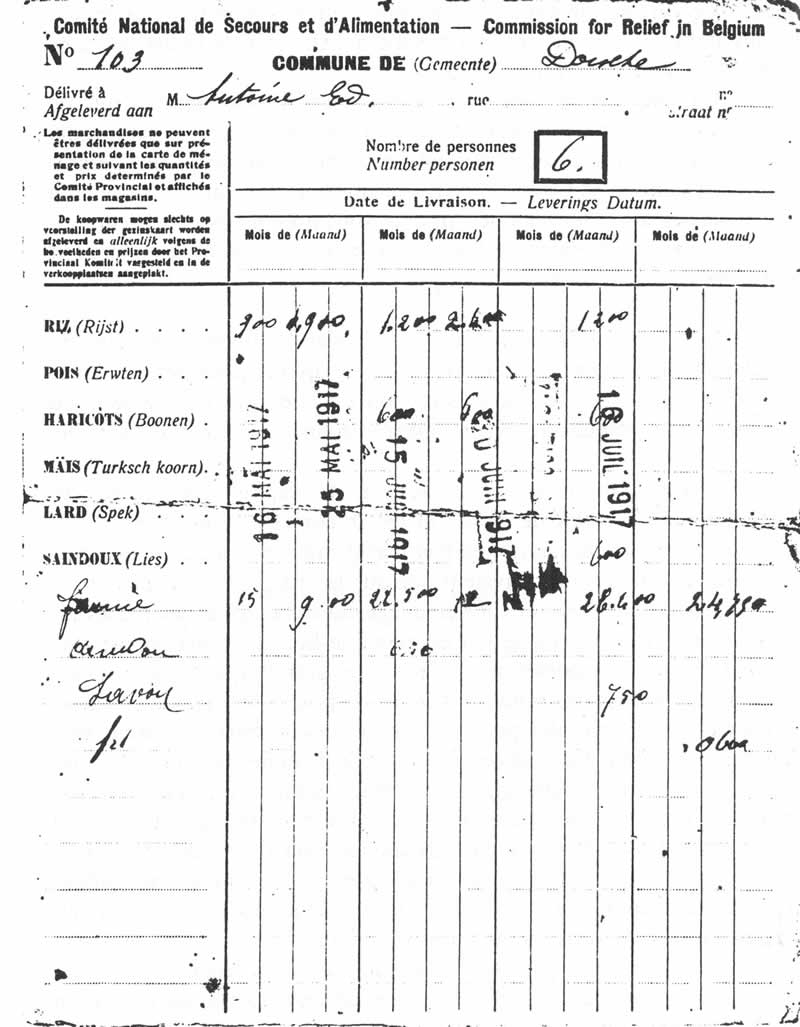
Carte de ravitaillement Dans
chaque commune se forma un comité de ravitaillement chargé d'une distribution
équitable des vivres reçus. On allait chercher à Philippeville, par chariot, ce
qui revenait à notre commune. Le dépôt se faisait dans la maison actuelle de
Madame Van Thielen. Ce comité, fort indépendant du
conseil communal, comprenait le bourgmestre Hubert Hennard,
le curé Pirmez, Louis Laurent, Théodule Dogny, avec des changements au cours des ans, car vouloir
contenter chacun n'était pas une place de tout repos. Lucien Wayens y a sans doute participé, on ne sait plus ... Il
fallut prévoir des veilleurs de nuit pour prévenir les vols. Les fermiers
devaient fournir une part fixée de leurs récoltes. Chaque
famille recevait, après paiement, sa ration de farine avec son. Souvent on
tamisait, on ajoutait des pommes de terre pour allonger. On rallumait les vieux
fours de jadis ou on cuisait le pain dans le coffre du poêle. Les chômeurs,
pour leur travail au profit de la commune, recevaient des bons pour payer les
vivres reçus. Le ravitaillement procurait aussi à périodes irrégulières un peu
de saindoux, du lard, une sorte de miel bleu ou rose dont on fabriquait, avec
de la farine de seigle, du soi-disant pain d'épices. Les
Américains nous envoyaient aussi deux spécialités : 1) la céréaline :
paillettes de maïs aplaties, blanches ou jaunes. Cela se mangeait dans une
soupe au lait ou dans le potage. On en faisait aussi des crêpes. Avec du sucre
et du lait, cela donnait dans le four une sorte de gâteau dans un moule à pain. Chaque
ménage avait son jardin, avec plus de légumes que de fleurs. On en tirait deux
récoltes, et souvent on avait, à la campagne, un second jardin avec pois,
haricots et pommes de terre. Les patates nous sauvaient la vie. En robe des
champs, rôties sur la « buse » du poêle, servies avec des légumes,
midi et soir, présentées avec un creton de lard, c'était un extra ; relevées
par laurier et thym, elles étaient aussi servies avec moitié de rutabagas. Les
fermiers devaient fournir de la viande au ravitaillement. Les bouchers
travaillaient au ralenti avec ce qu'ils pouvaient acheter légalement, tuant parfois
une bête non déclarée au recensement ou accidentée, ou même crevée et enterrée
pour le service de contrôle. Chaque
famille élevait facilement des lapins avec l'herbe, les épluchures, les
feuilles de choux et les chicorées sauvages. On le cuisait sans beaucoup de
graisse et pas mal d'eau, on y ajoutait des pruneaux séchés. Les enfants
avaient surtout la charge du clapier pour ce qui est de la nourriture et du
nettoyage. Les chèvres et les brebis revenaient à la mode pour le lait et même
le beurre. Voilà encore une occupation pour les gosses après l'école, les
grands ayant d'autres soucis plus graves. Certains pouvaient tenir des poules
soignées avec l'avoine glanée ou achetée, des pâtées de son et des déchets de
cuisine. Plusieurs nourrissaient un cochon, mais c'était difficile, avec petit
lait des chèvres, son, orge, seigle glané ou semé, épluchures, fruits véreux, orties
et chardons cuits dans une cuve, des caboulées
disait-on. Et si possible on ne le déclarait pas. Quand on sacrifiait l'animal,
c'était grande fête : on en tirait de la viande pour toute l'année en y allant doucement
: tripes, boudins, tête pressée, andouilles pour ne rien perdre, côtelettes, le
reste étant au saloir, débité morceau par morceau chaque dimanche. Les pattes
et la queue, ça faisait déjà cinq semaines assurées. Des rusés profitaient du
gibier devenu nombreux puisqu'on ne chassait plus. C'était le bon temps pour
les poseurs de lacets. Mais les sangliers venaient ravager les champs de pommes
de terre. Le
comité de ravitaillement pensait aux enfants. Chaque jour à la sortie de la
classe matinale, les demoiselles Hennard, filles du bourgmestre,
avec quelques dévouées leur servaient une large ration de soupe épaisse,
grasse, avec riz et céréaline. Le matin, à la récréation,
chaque élève recevait une tasse de liquide baptisé café, avec un petit pain
allongé, cuit par Sylvain Beaumont. Rarement, et alors c'était merveille, on
avait une tasse de cacao. C'était un supplément très apprécié pour la petite
jeunesse sous-alimentée. Comme
il y avait encore pas mal de maisons anciennes avec étable, une vingtaine de
familles modestes purent acheter une vache. Il fallait trouver quelques
prairies à louer, à faner et à faire pâturer. Les
fermiers se tiraient mieux d'affaire, surtout si la récolte était bonne, mais
les Allemands tenaient tout à l'il, cherchant à s'approprier le plus possible
les surplus de production. Voici la carte d'information envoyée de la part de Provinzial Ernte Kommission de Namur : En exécution des arrêtés des 19 et 20
août 1917 de son Excellence le Gouverneur général (allemand) il vous est donné
avis que l'on disposera de la façon suivante de votre récolte de 1917 de céréales
destinées à la panification et d'avoine : I. Céréales
destinées à la panification Genre de céréale quantité
destinée quantités destinées quantités supplémentaires
aux semences au
producteur à recevoir du
CN Epeautre 150 Kg 742 Kg Froment d'hiver Froment d'été Seigle C'était pour une famille de six personnes. Pour l'année 1918 : voici les consommations
mensuelles prévues par tête d'habitant 10 kg froment, seigle, méteil ou 13 kg
et demi épeautre. Vous
avez bien lu : « Il vous est donné avis que l'on disposera de votre
récolte de la façon suivante ». Ça
sonne bien drôle à des oreilles belges... 
Carte dinformation 
Chaboteau Fernand, prisonnier à lYser, placé en tête de pont 
Auguste Willem, le vétéran, 4 ans de front, citations honorifiques. Ici dans lintimité. 
Loison Ernest (1er à droite) soldat français prisonnier lors de la reddition de Charlemont (Givet) Pour
l'avoine c'était pire encore, car les Allemands avaient encore en 14/18 de
nombreux chevaux. Lisez : « Le cultivateur est obligé de vendre
les quantités d'avoine qu'il possède en surplus des quantités
renseignées au tableau ci-dessus, conformément aux instructions détaillées
du Kreischef aux acheteurs lui désignés notamment
aux détenteurs de chevaux qui ne cultivent pas eux-mêmes l'avoine nécessaire
à leur besoin ou bien aux marchands agréés (par les Allemands). Avec
peines pénales très graves : 5 ans d'emprisonnement et amende
pouvant atteindre 20.000 marks ; éventuellement les deux peines pourront
être appliquées simultanément. (Et allez-y ... ). Sont solidairement
responsables en même temps que le cultivateur, la commune dans laquelle
il a son domicile ainsi que la totalité des cultivateurs qui y sont
domiciliés ». C'est le pays en esclavage..... On tire tout ce qu'on
peut pour l'armée Allemande. Certains marchands de céréales ou de bêtes de
boucherie, ont été poursuivis après 1918 pour collaboration avec l'ennemi.
L'argent n'a pas d'odeur. L'un de ces marchands était surnommé le Baron Von Spitch. TISSUS Comment
s'habiller ? Quatre ans sans renouveler sa garde-robe. Et les enfants qui
grandissaient ? Et les premières communions ? Et les mariages ? Il y avait
parfois encore des costumes neufs. Il fallait aller à Florennes à pied puisque
la gare était fermée pour les civils. A Treignes, on
vendait des vêtements d'enfants, peu de choix bien sûr. Les couturières eurent
de l'imagination. On taillait dans de vieux manteaux et pardessus, on utilisait
les larges jupes des grands-mères et les sarraus des grands-pères.
Et on teignait dans une eau très chaude les couvertures en noir, les draps de
lit en clair. Faute de mieux, cela servait de robe de cérémonie. Certains
allaient jusqu'à échanger un peu de nourriture avec les vieux réservistes
allemands qui n'étaient pas incorruptibles et qui refilaient vestes et capotes
dont on ne leur demandait pas l'appartenance. 
Sagot Auguste, soldat français du 148e de ligne. 
Sagot Auguste, soldat français du 148e de ligne. Quatre ans de front, rescapé de Verdun. 
Devigne René a fait la guerre comme gendarme. 
Trois jeunes de Doische : Houbat, China et Adam qui ont tenté, en vain, le passage par la Hollande pour rejoindre le front belge. On
allait aussi rechercher les vieux rouets vermoulus au grenier, on en fabriquait
de neufs, et jeunes filles et femmes filaient, après l'avoir lavée, la laine
des moutons ou à défaut celle des matelas. Et en avant aiguilles et crochets.
Dans les doigts habiles, la laine devenait chaussons, bas, écharpes, jerseys,
châles, le soir à la clarté d'un lumignon. CHAUSSURES Et
les pauvres pieds, il est temps d'en parler. Notre cordonnier Censier Germain
avait liquidé au prix d'avant guerre ce que les pillards lui avaient laissé.
Après, ce furent les guêtres, cartables en cuir des écoliers, dessus de bottes
qui servirent aux ressemelages et on y plantait des clous du talon jusqu'à la
pointe. On eut aussi recours aux galoches et aux sabots que certains artisans
savaient refaire. Les enfants aux pieds tendres attrapaient des engelures et
des plaies bien lentes à guérir. Des ménagères adroites imaginaient de
fabriquer des pantoufles à semelles faites de grosses ficelles cousues entre
elles, attachées à un tissu épais qui était parfois de la bâche. Camille Houbat, le menuisier, fournissait des semelles de bois. On
y clouait des brides, ou on les recouvrait d'une étoffe solide. ECLAIRAGE Le
pétrole était rare. Des marchands ambulants de Charleroi en apportaient de
petites quantités pour faire des échanges. Il y avait des dépôts allemands à
Givet. Certains en profitaient, de connivence avec les occupants. Il y avait
les vieux crassets, mais avec eux il fallait de
l'huile, manquante elle aussi. Ceux qui logeaient des soldats, en recevaient
parfois de ceux-ci. Les petites veilleuses à huile ou à graisse, avec mèches
furent utilisées, faute de mieux. La bougie était reine : avec elle les
écoliers voyaient clair pour faire leurs devoirs, mais comme elle se consumait
vite ! 
Legere Fernand fait prisonnier au fort de Marchovelette (Namur) 
Legere Fernand 
En 1917, Léon Herix et ses camarades ont organisé une petite séance récréative avec musique et grands chapeaux. Il fallait cela pour conserver le moral des prisonniers. 
Léon Herix en 1915 en Allemagne. 
Clovis Rossomme, 4 ans au front, blessé au combat. Ici avec son épouse Bertha, cest lépoque heureuse avant la guerre. L'ustensile
le plus employé fut la lampe à carbure avec ses deux réservoirs l'un à eau qui
lâchait le liquide goutte à goutte dans l'autre, ce qui dégageait un gaz
nauséabond vers un bec qui s'encrassait souvent. On vendait ce carbure dans les
magasins. Pas fameuses les soirées d'hiver (sans radio ni télévision bien sûr !)
On jouait aux cartes, on racontait les derniers bobards, on sciait du gros bois
pour le lendemain, on écossait des pois et des haricots secs, on laissait une petite
fente au couvercle du poêle ce qui donnait un peu de clarté... et on se
couchait tôt. CHAUFFAGE Rarement
on obtenait une ration de charbon. Les deux écoles en obtenaient 500 kg. On
pouvait acheter « de la terre houille » un charbon en poussière que
l'on agglomérait avec de l'eau et de l'argile. Ca cassait l'air froid. Il y
avait heureusement le bois. Doische possède de
nombreux hectares plantés de charmes, de bouleaux en taillis. La commune
délimitait chaque année des portions vendues au plus offrant, mais au moins une
pour chaque foyer. On abattait à la cognée et on ébranchait à la serpe. On
savait se procurer des fils pour lier les fagots : du bois fin au milieu pour
allumer le feu, des bûches sur le pourtour. Les connaisseurs savaient repérer
avant la vente les portions avec de belles perches épaisses. On sciait à la
main. Les bûches étaient nécessaires aussi pour chauffer les fours et cuire les
pains. Comme dans les années 1600, les bois étaient l'ultime ressource de la
population. A Fagne, les petits chênes étaient nombreux dans « les pans de
bois ». On retrouva les vieux peloirs vermoulus,
on en fabriqua de nouveaux et on enlevait une ou deux hauteurs d'écorce. On les
faisait sécher sur un plan incliné. On les liait en fagots et on les vendait
aux tanneries. On arrivait ainsi à payer sa portion. Les
plus pauvres avaient l'autorisation de couper les grosses épines, excellent
bois de chauffage, et le bois mort. C'était parfois tragi-comique. Ainsi Marie
Penasse recherchait les plus gros buissons d'aubépines et de prunelliers
hérissés de piquants. Elle en désignait 3 ou 4 à son mari Camille, très myope.
Et ce dernier de demander « Où ce qu'elle est donc Marie, l'épine ? ». Et celle-ci répondait,
impatiente : « Pougne didins,
tel sintra bin ». Ils
arrivaient quand même à remplir leur charrette à bois. On ramassait bien
précieusement les copeaux au pied des gros arbres abattus (les astelles). NETTOYAGE Le
savon était assez rare. Le ravitaillement n'en distribuait pas assez. Le marché
noir en vendait. Le Allemands avaient une composition verdâtre, très légère qui
flottait sur l'eau et durait deux ou trois jours. Une recette bien connue :
acheter du « collagène » chez un droguiste, y faire dissoudre du
saindoux ou une graisse. C'était énergique. On mettait tremper le linge la
veille du lavage, et le lendemain on manuvrait la machine à laver à 3 pieds et
à 2 poignées et vas-y de gauche à droite et inversement pendant un quart
d'heure pour chaque « tournée ». On conseillait de ramasser les
cendres de bois du poêle et du four dans une cuve et d'y jeter de l'eau
bouillante. On passait l'eau ainsi chargée d'un peu de potasse à travers un
linge. Le résultat obtenu faisait son possible pour blanchir le linge. TABAC Temps
de pénitence pour les fumeurs, mais pas de repentir. On acheta de la graine de
tabac : il fallait la semer dans une caissette sur la tablette de la fenêtre,
repiquer les jeunes plants très frêles de 1 à 2 cm, procéder à un second
repiquage, mettre en terre après les gelées tardives, les buter contre les
limaces, étêter la tige principale, enlever les jets qui poussaient à
l'aisselle des feuilles, cueillir celles-ci quand elles jaunissaient, les
piquer sur un fil pour le séchage en plein air, hacher le tabac dans des
machines imitées des temps anciens, se procurer du papier à cigarette... et
faire des ronds de fumée ! Pour les non fumeurs le tabac était un excellent
produit d'échange mais il y avait une taxe d'accises à payer. CHAPITRE
IV. Fin
1914 déjà, le front semblait figé. Le canon tonnait : au nord-ouest c'était
l'Yser, au sud-est c'était Verdun. On l'entendait mieux encore l'hiver quand le
sol était gelé. Les pensées se portaient vers nos soldats, guettant l'ennemi
derrière les sacs de sable, dans la région du fleuve historique, inondée depuis
1914. Que devenaient-ils par les grands froids, sous le vent du large, dans la
pluie et la boue ? Leurs familles vivaient dans une angoisse constante.
Quelques mobilisés étaient prisonniers de guerre : Marteau, le douanier, Ernest
Loison pris à Charlemont, Fernand Légère pris dans un
fort de Namur, Fernand Chaboteau capturé en tête de
pont sur l'Yser. Trois d'entre eux étaient internés en Hollande, séparés des
troupes belges après la chute d'Anvers : Désiré Mahau,
Louis Masson et Emile Brichot. Ils écrivaient quand
on le leur permettait, envoyaient peut-être une photo souriante. Ils avaient
besoin de colis pour tenir, sauf s'ils travaillaient dans les fermes. Les plus
nombreux, ceux du front, ne pouvaient envoyer, par la croix rouge, que quelques
mots conventionnels : bonne santé, on tient le coup.bon courage, à bientôt.....
Parfois ils essayaient d'écrire des lettres bien personnelles qui arrivaient parfois
à destination grâce à un service clandestin. Les
hommes jeunes partis au dernier train de Doische
avaient été mobilisés : Cyrille Anceau, Arthur et
Lucien Jourdain, Burton Charles, Tayenne Victor. Nos
soldats belges obtenaient par an un congé de 10 jours augmenté de 2 jours pour
le voyage. Où aller ? Souvent dans les familles d'évacués de Doische ou des environs. Plusieurs avaient une marraine de
guerre qui leur envoyait des colis, tel Jules Verlaine. Et
le canon ne cessait de tonner..... Les femmes de soldats n'étaient guère
secourues. Elles devaient pourtant veiller sur la santé des enfants, payer
nourriture et chauffage, s'occuper du jardin. Séparation, isolement, soucis de
famille, manque d'argent, guère de nouvelles, angoisse constante, victimes
souvent de l'égoïsme et de l'incompréhension. Cécile Anceau
me disait avec amertume qu'un jour elle avait dû abattre, pour se chauffer, un
arbre de son jardin, avec la cognée. Et qu'un piètre personnage, au lieu de
l'aider..., riait d'elle. On attendait la correspondance avec impatience : le
facteur devait la prendre à Givet, à pied ou à vélo, puisque les trains
n'arrêtaient plus à Doische. Après
les familles de soldats, les ouvriers étaient le plus à plaindre. L'usine d'Aubrives, où la plupart travaillaient, était fermée. Les
ressources étaient brutalement taries. Beaucoup d'entre eux se mirent à la
besogne dans les fermes ou dans la forêt. Semailles à la main, fauchage à la
fenaison et à la moisson, battage au fléau l'hiver. Ernest Triffoy
faisait un petit commerce de fagots, de hourettes. Il
embaucha quelques hommes. La commune trouvait pour les chômeurs, sans
indemnités alors, des occupations pas toujours intéressantes, mais il fallait
vivre : casser des cailloux à la massette de plomb puis en recharger les
routes, y jeter de la terre pour les stabiliser, curer les fossés, nettoyer les
trois grands puits communaux, creuser des trous sur les Retondus pour
plantation de sapins, couper du bois pour les écoles et les bâtiments publics. Les
commerçants (Rochet, Hanoul, Pilpay .... ) vendaient
ce qu'ils pouvaient se procurer ; tous les fonds de magasin des maisons de gros
trouvaient acquéreurs. On pouvait s'approvisionner chez eux : sel, sucre,
cassonade, tabac à fumer ou à chiquer, du papier à lettre, des cahiers
d'écolier de piètre qualité, du tchirou ou sirop de
betterave très collant, des sabots et du carbure bien venus. Et les prix montaient
régulièrement. Les
fermiers devaient se soumettre aux livraisons pour le Comité de Ravitaillement,
auprès des marchands imposés par les Allemands, ainsi qu'aux réquisitions de
chevaux. En 1914 déjà, la ferme Anceau en avait livré
un, conduit à Namur. Puis au cours des années, l'occupant faisait rassembler
les bêtes de trait de plusieurs villages et choisissait dans le tas, les
meilleures. On essayait bien d'en cacher dans les bois ou d'en emmener dans les
localités où la rafle était déjà faite. Plusieurs fermiers durent atteler des
bufs, même des vaches chez les plus petits exploitants. Eugène Censier
essayait de faire attelage avec un cheval et un buf. Plusieurs chevaux furent désignés
pour charrier les arbres des Ardennes. L'ennemi ravageait sauvagement la forêt,
dut-elle être mise à blanc-étoc. Si l'année était de bon rendement les
cultivateurs pouvaient avoir un surplus disponible dont parents et amis
profitaient. Ceux à qui on ne vendait rien les traitaient d'accapareurs. Les
écoles tenaient quand même. Le personnel enseignant devait conserver les
enfants jusqu'à 14 ou 15 ans puisqu'il n'y avait pas de train pour les emmener
à l'école moyenne. Malgré les ennuis de chauffage et d'éclairage, malgré la
pénurie de livres et de papier, maître et maîtresse sentaient leur
responsabilité envers leurs élèves dont beaucoup firent de bonnes études après
la guerre. Ils entretenaient la fibre patriotique par des récitations bien
choisies. Les garçons, naturellement, jouaient au soldat avec des sabres de
bois au bout teinté de rouge. Il y avait des bataillons ennemis avec gradés et
piottes marchant au pas et s'affrontant à l'arme blanche, sans aucun blessé cependant.
Mais si un avion venait à atterrir, c'était une ruée irrésistible pour le voir
de près. Il y avait aussi à Vaucelles un gros ballon captif
qu'on voyait d'ici et qui excitait les imaginations. Les
jeunes gens craignaient la déportation. On apprit un jour qu'Alexis Houbat, Joseph China, Emile Adam dit Méhul, car il était un
peu musicien, étaient partis avec un Givetois vers la
Hollande pour, de là, rejoindre l'armée combattante. Mais il fallait franchir
les fils barbelés électrifiés d'une charge mortelle. Ils échouèrent et furent emmenés
en Allemagne. Alexis Houbat eut encore la malchance d'être
prisonnier de guerre 40/45. Le
zèle de l'occupant s'en prit aussi à l'église de Doische.
Non content d'avoir supprimé la messe de minuit et d'avoir volé les cloches, il
prétendit y instaurer des offices protestants. L'abbé Pirmez
entra pendant leur première réunion pour emporter les hosties consacrées. Après
cet office, une paroissienne choquée, alla enlever sa chaise, propriété
personnelle alors. Ce fut un signal : chacun s'empressa de l'imiter. « S'ils
veulent occuper l'église, qu'ils y restent debout ». Les offices
religieux, jusqu'à la libération, auront lieu à la chapelle Santa Casa au
faubourg : messes, mariage d'Albert Wayens et Laure Houbat, funérailles d'Alexis Jacquemart, receveur communal. 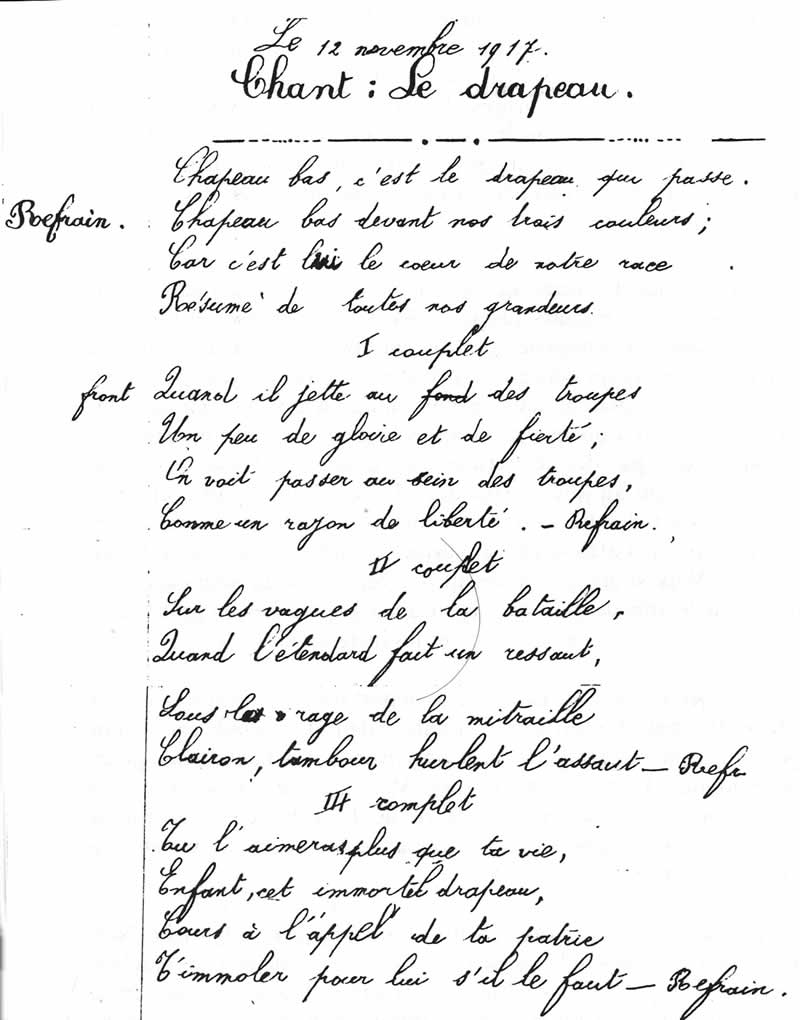
Chant : Le Drapeau Fin
1916, un accident tragique émut le village. Notre boucher, Henri Jaumotte, était allé conduire, avec sa charrette à quatre
roues, une voyageuse à la gare d'Heer-Agimont.
Soudain le cheval affolé revint seul. Un train survenant de la tranchée de
chemin de fer avait démoli l'arrière du véhicule et tué le conducteur. Il n'y
avait plus de garde-barrière. Et
le conseil communal, comment va-t-il fonctionner ? Il comprend en 1914 les 7
membres suivants : Hennard Hubert, menuisier de
profession, faisant fonction de Bourgmestre (nommé seulement en juillet 1919), Fesler Jules, échevin (puis simple conseiller le 6 janvier 1917),
Brichot Adolphe, conseiller (puis échevin le 6
janvier 1917), Cosme Joseph, Penasse Arthur et Pilpay Ferdinand. Saquet Francois, le 7e, ne se rendra qu'une
seule fois aux séances du conseil, pour la nomination du receveur communal le
23 juillet 1918. Les conseillers qui devront gérer la chose publique en ces
temps sombres ont un handicap funeste : la commune est pauvre. Comme recettes :
vente de bois, une coupe par année. En 1914 elle est estimée à 692 frs. En
plus, les centimes additionnels : 7 centimes sur la contribution foncière, 7
sur les contributions personnelles, 7 sur le droit de patente et 15 pour la
voirie. Et encore la location de la chasse, la taxe sur les chiens, la vente de
concessions au cimetière. Mais la commune doit payer elle-même tout son
personnel : en 1914, l'instituteur, (4 enfants) touche 1900 frs par an,
l'institutrice 1400 frs, le secrétaire 605 frs, le receveur 500 frs. Il y a
encore le garde-champêtre et le cantonnier. Puis en guerre, il fallait bien
soutenir les nécessiteux, les chômeurs, alimenter le Bureau de Bienfaisance,
chauffer les écoles, payer les livres et fournitures classiques et satisfaire
aux réquisitions de l'ennemi. Le conseil dut se résoudre à emprunter de grosses
sommes pour l'époque où une journée de chômeur était payée 2 frs. Sur 4 ans, il
dut trouver 44.600 francs, dont voici le détail approximatif : 7500 frs au
Crédit Communal et le reste aux habitants du village : Rochet Félix 1500, Higuet Gillain 3000, Cosme Joseph
2000, Pilpay Ferdinand 3500, Wayens Lucien 1000, Anceau-Rérnit 1000, Anceau Hector 20.000, Toupet Arthur 1500, Henquin Arthur 2100 (de Dinant), Thibaut Octave 500, Masson
François 1000 (de Dinant). 
Timbres allemands avec surcharge Belgien CHAPITRE
V Et
les gris, on en voyait ? Ils ont occupé la gare en 1914 s'occupant des
transports militaires par chemin de fer. Leur chef avait élu domicile à la
maison Dumont, les hommes logeaient dans le quartier de la gare. C'étaient
plutôt des réservistes, des vieux paletots, heureux d'être là plutôt qu'au
front. Ils avaient installé une boucherie dans le logement du chef de gare et
ils cuisaient leur pain chez Grégoire. Ils s'éclairaient avec des accus qu'ils
faisaient recharger à Romedenne auprès d'un groupe
qui exploitait les forêts. Ils rapportaient du bois, essayaient d'échanger pour
des vivres, du pétrole et ce qu'ils pouvaient chiper à leur intendance. Ils
n'inquiétaient guère le monde et se payaient volontiers un air de viole (piano
automatique). D'autres
groupes, encore des réservistes, transportaient on ne sait quoi dans leurs
chariots étroits. Ils faisaient la cuisine dans la maison d'Annie Rodrique et mettaient les chevaux dans les étables. Des
hommes de ce groupe occupaient la maison vide de Clara Suray
au Quartier (l'hôtel Clara). Ils y couchaient la nuit, allumant des bougies sous
un toit de chaume ! Des
unités d'active, avançant vers le front, s'arrêtaient un jour ou deux : on
devait leur céder des chambres à coucher. Les Allemands réoccupèrent la gare en
1917, c'étaient pour nous des Bahnoff.
Mais un sacré jour de malheur, arriva à Doische
le plus bel échantillon du militarisme allemand, le chef de la Kommandantur (commandature en wallon) fixée chez nous. Logeant à la
maison Renglet au faubourg, casquette bien campée sur
sa tête sournoise, bien sanglé dans son ceinturon « Gott
mit uns », badine au poing, plantant ses yeux méchants sur la piétaille
qui se mouvait sur la route, raffolant de chevauchées en pleine campagne,
surveillant la route du moulin, inquisiteur au point d'ouvrir la porte des
armoires (« On vit bien ici ! ») et même de soulever le
couvercle des casseroles pour en inspecter le contenu, voilà ce que nous
destinait l'autorité d'occupation ennemie. Antipathique à tous dès le premier
jour, ce petit capitaine prussien obtint spontanément de la population un
surnom : « Pète sec ». Voir au dictionnaire Larousse : homme
autoritaire qui commande sèchement. Le bourgmestre ne savait où donner de la
tête pour satisfaire ses exigences et le garde-champêtre courait en tous sens
pour exécuter ses ordres : « demain, balayage des routes, puis nettoyage
des fossés, ensuite disparition des fumiers, plus de purin ... » pour
chagriner son odorat hypersensible. « Allez ! balayez, balayez,
putzen et laus et
schnell. On leur apprendra la propreté à ces paysans
de belges. Et encore à respecter le silence de la nuit ». Pour cela
un clairon surnommé Pernotte, accompagné de deux
sentinelles sonnera la retraite depuis la grand-route de Philippeville jusqu'à
la Chapelle du faubourg. Tut, tut, tut! Tout le monde chez soi à 10 heures du soir
! Tant pis pour les joueurs de cartes attardés et autres noctambules. Ils iront
passer la nuit dans la cave de la Kommandantur ou dans une pièce de la maison
Censier réservée comme prison. Un soir, un malheureux gamin de Charleroi, petit
marchand ambulant, vous voyez : lacets, papier, cirage..., ne sachant où
disparaître, était rentré chez nous en pleurant. On l'avait logé bien sûr. « Et
puis levez-vous plus tôt pour mieux travailler : vous suivrez l'heure
allemande. Avancez vos horloges de 60 minutes ». Comme on l'a
maudite cette nouveauté imprévue. Les fermiers prétendaient marcher avec le
soleil, seul maître pour régler le temps. Mais les écoles devaient suivre
l'heure officielle. Il fallait changer le moment des repas. A quelle heure la
messe à Doische et à Gimnée
? Nouvelle heure ? Vieille heure ? Distribution de ravitaillement, ouverture de
la poste, enterrement : nouvelle heure ou heure belge ? On arrivait trop tard à
la gare d'Heer-Agimont : le train était filé à
l'heure allemande. Et
puis encore, de l'ordre, de la discipline. Pète-sec régnait à la salle
communale devenue Kommandantur. « D'abord, qui êtes-vous, vous
qui me parlez ? Je dois tout savoir : vous porterez une carte d'identité
sur vous, rédigée par le Bourgmestre et signée par vous avec photo ".
Muni de cette carte, vous vous présentiez à son bureau surchargé de
formulaires. 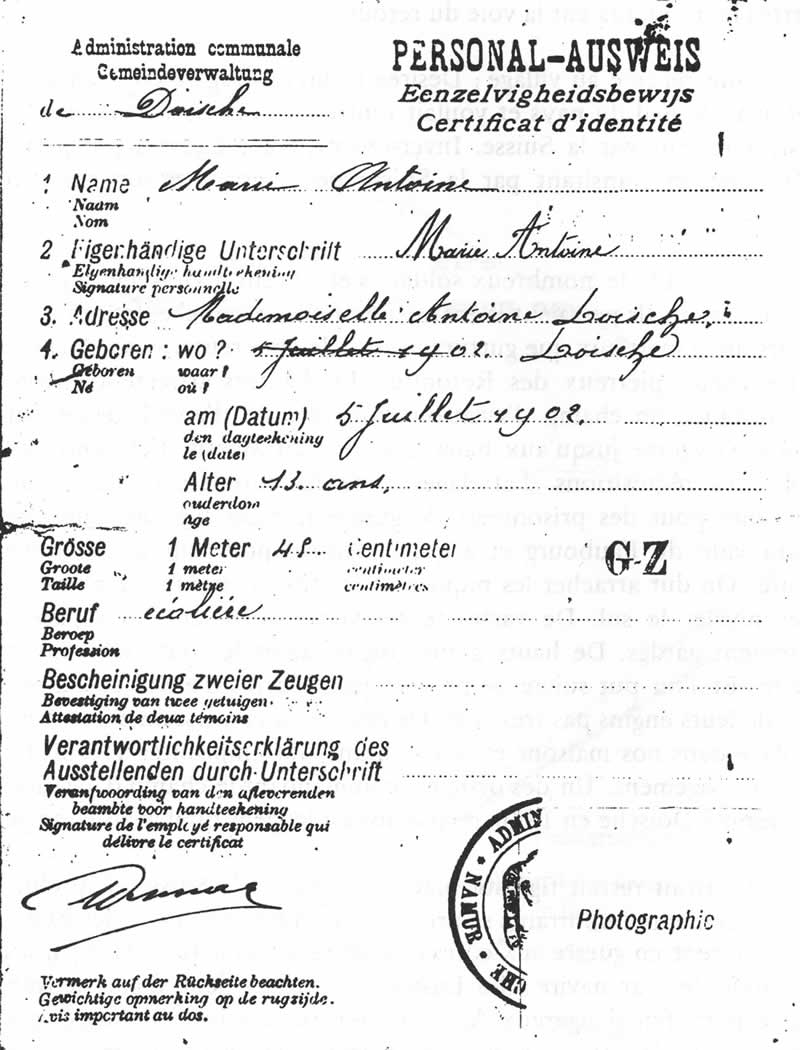
Personal-Ausweis « Tiens vous désirez aller à Givet ?
Quoi faire s'il vous plaît
? Et à quelle heure ? Départ ? Retour ? Et on se découvre pour parler à
un officier allemand, monsieur. Vous aurez un permis de 10 h à 15 heures seulement, à rapporter dès
votre retour. Tiens, vous avez acheté une portion de bois ? Il vous
faudra venir chez moi chercher une autorisation pour aller la couper et
la façonner. Sait-on ce qu'on peut faire dans un bois ? Vous avez de la
denrée à faire moudre ? Chançard ! De l'ordre, de l'ordre, vous viendrez
chercher un passavant pour aller demain au moulin et reprendre la
farine après-demain. Et le meunier est surveillé ! » Et pourtant...
Si personne n'était visible à la salle communale, on filait à Vaucelles ; on en revenait en vitesse et on retournait
au moulin une seconde fois avec le même passavant. Le meunier était toujours
d'accord, ayant acheté son surveillant. Certains empruntaient les sentiers des
bois pour aller à Vaucelles ou à Vodelée
avec quelques kilos de froment et d'épeautre... « Il me revient, disait
Pète sec, que la nuit, on se permet de voler les récoltes. Et bien !
le Bourgmestre organisera des rondes dans toute la campagne avec des
hommes sûrs, bien choisis. Hé donc ! il y a aussi nos braves soldats qui
montent vers le front ». Pète sec entre dans chaque maison. « Combien
de personnes ? Combien de chambres ? Allons voir. Bon. Vous logerez six
hommes. Et un bon lit s'il vous plaît ». Et sur la porte
d'entrée il crayonnait 6 Mann. Quelles trognes allaient encore nous
venir importuner ? Et
enfin et surtout, ils veulent gagner la guerre. Tout pour la victoire. On abat
les noyers dont le bois est réputé pour la fabrication des crosses de fusil
(chez Cécile Anceau, à la cense
Lahaye, à l'école des garçons). Et il faut des
uniformes pour l'armée. « Vous élevez des moutons, vous avez de
bons matelas ? Vous allez nous fournir de la laine que vous porterez à Treignes, à pied, à cheval ou en voiture, à votre
choix. Et les munitions ? Vous entendez le canon ? Vous nous apporterez
vos objets en cuivre : chandeliers, clenches des portes, poignées des
fenêtres, objets d'art qu'importe. Et vous serez bien payés car nous sommes
honnêtes, n'allez pas en douter. 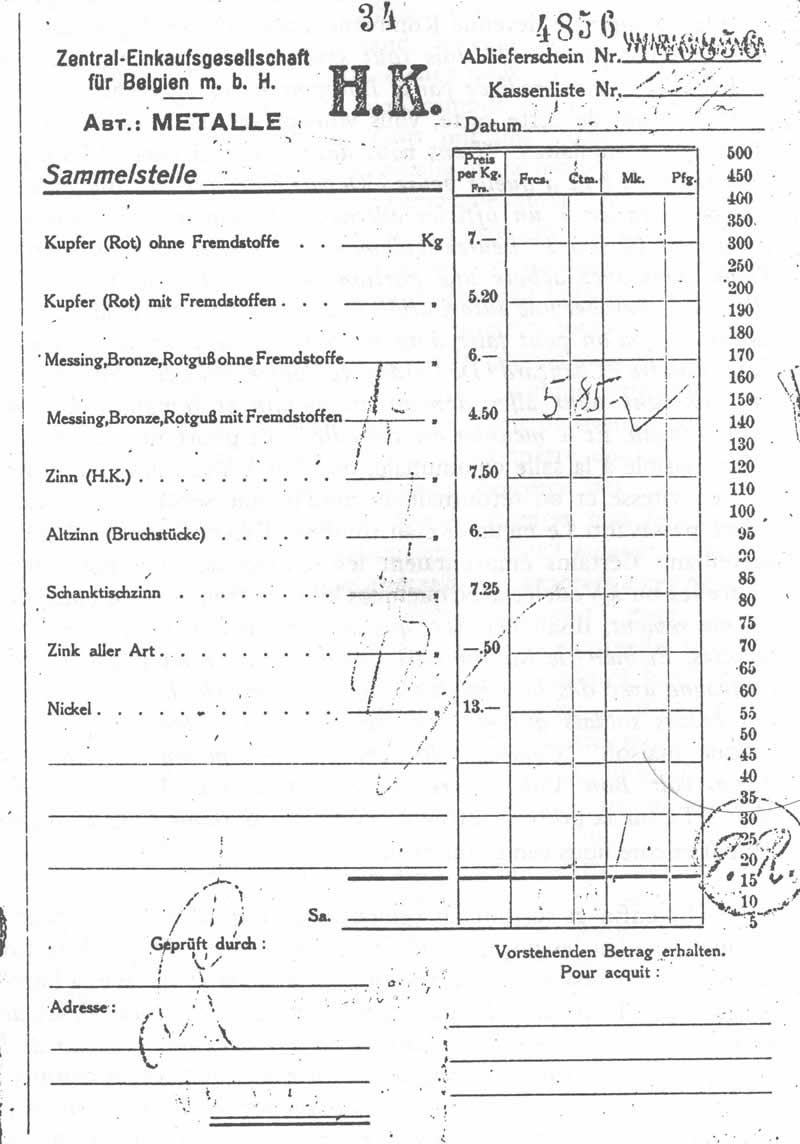
Réquisition de métaux Ah ! Vous buvez encore de la bière en temps
de guerre ? Désormais vous boirez de l'eau ou de la tisane car nous enlevons
les cuves de la brasserie, du beau et bon métal. Et vos cloches qui me cassent
les oreilles ! Elles serviront à fabriquer de bons et beaux canons. On vous
laissera la plus petite, par condescendance ». Et elles partirent
nos cloches... Mais elles revinrent après 1918, sans avoir été fondues. Que
restait-il à faire ? Cacher tout ce qui était jaune dans le foin, sous un tas
de fagots. Donner du cuivre avec lequel les balles ennemies tueraient nos
soldats ! Quelle abjection ! Les gamins, en l'absence momentanée des soldats,
s'emplissaient les poches de déchets de cuivres enlevés à la brasserie proche de
l'école. Au fond c'était bon signe : leur machine de guerre s'usait par manque
de métal. De même ils avaient enlevé à Givet la statue en bronze de Méhul, le
musicien, qui eut aussi la chance de retrouver sa Grand-Place, n'ayant pas été
fondue. Et le petit capitaine faisait du zèle : « Et
tous ces hommes de moins de 35 ans ? Ils sont capables de s'esquiver pour
éviter le travail en Allemagne, ou même de passer en Hollande. Imaginons un appel-contrôle
des hommes valides à Agimont. Cette petite promenade leur
sera bénéfique ». Mais où les choses se gâtèrent vraiment,
c'est quand Pète sec voulut réquisitionner les pommes de terre. Ses hommes se
permettaient d'arracher 1 m² dans chaque lopin et, d'après cela ils évaluaient la
récolte. « Vous avez droit à tant de kilos par personne, vous livrerez
le reste. D'ailleurs, des sous-officiers iront visiter chaque maison et chaque
cave pour connaître exactement votre production ». Nous enlever nos
patates ! Non, vraiment ça passait les limites de l'acceptable ! Chacun imagina
un truc, une cachette, comme on disait. Pour les uns c'était un gros tonneau
camouflé dans la terre ou dans le fenil. Le douanier Giot
avait choisi la cave d'une maison écroulée dont il louait le jardin. Germain
Censier avait creusé un trou dans le sol où pouvait entrer la moitié de sa
récolte. Alors, un bien petit tas dépassait à ras du sol. Le curé, lui,
dissimulait sa provision sous le siège du confessionnal. Mon père avait divisé
en deux une chambre à coucher étroite. Un portemanteau chargé de vieilles
hardes camouflait la cloison, de bois séparatrice. On y accédait par une petite
porte dans un coin et pour la dissimuler, il fallait recoller du papier peint
après chaque entrée. 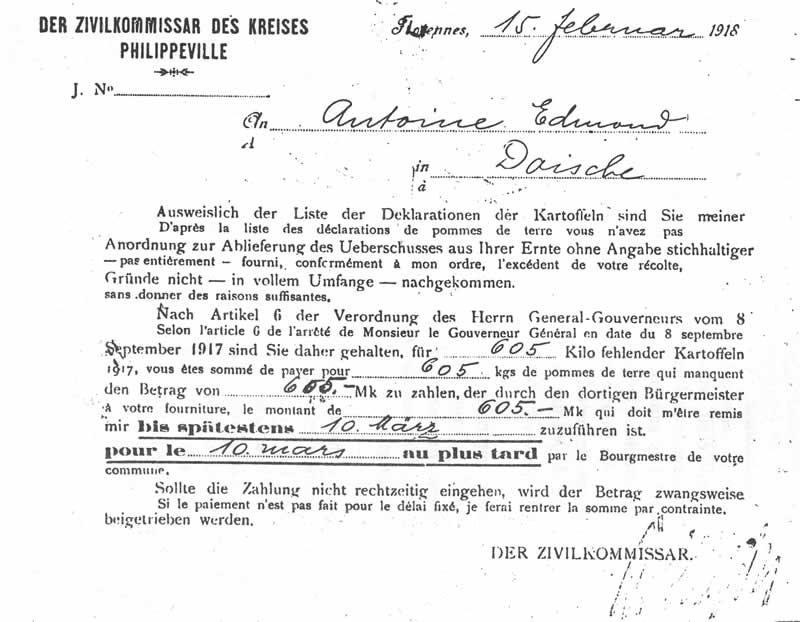
Amende pour fourniture insuffisante de pommes de terre. Un autre envoyait
ses enfants dans les champs pour ramasser tous les tubercules pourris laissés
sur place. Quand le contrôleur se présentait : « Voyez donc, toute ma
récolte est gâtée ! Que vais-je devenir ? ». Encore un autre
truc ? Les Allemands avaient visité le lundi le lieu-dit « le
Quartier ». Alors, les gens de la Pireuse, en passant
par les jardins, y apportaient les sacs de patates précieux. Et le mardi, on
n'avait plus en cave que la ration permise. Le plus rusé fut Adolphe Defooz. Plusieurs fois il était arrivé chez le Bourgmestre,
agitant de grands bras, les yeux exorbités : « On a encore venu
voler 25 fosses dans ma terre aux Hallets.
Déclarez-le pour le contrôle ». Comme cela se répétait, mon père,
anxieux, car il cultivait un jardin pas loin du terrain en question, alla
surveiller les lieux, invisible derrière une haie épaisse. Et soudain, un homme
arriva, pressé, avec un sac et une fourche. Comment identifier ce vaurien ? Mon
père se baissant avança prudemment et il reconnut le vaurien. Vous ne le devineriez
pas. C'était Adolphe Defooz en personne. Et quand les
recenseurs arrivaient chez lui, il exhibait devant eux les attestations des
vols commis à ses dépens. « Que vais-je devenir en hiver ? » Un
Allemand l'aurait plaint ! Et voilà des histoires de pommes de terre. A bon
chat, bon rat, mon capitaine ! L'épreuve la plus redoutée en 1917 était
la déportation des ouvriers en Allemagne. Mouleurs, modeleurs, gens de métier
faisaient changer leur carte d'identité et remplacer leur spécialité technique
par cultivateur. On préparait dans chaque maison un sac à dos, une caissette ou
une valise avec le meilleur linge possible. On attendait anxieusement. C'était
un procédé barbare de séparer les familles, de la part d'un ennemi qui sentait
plier sa force. Heureusement, Doische échappa de près
à ce malheur. Mais des villages peu éloignés en furent frappés. Et les années s'écoulaient, tristes et
mornes. Le canon tonnait sans cesse et la population devenait de plus en plus
pauvre. Peu de nouvelles. Un monsieur Demars de Mazée
vendait le journal, censuré naturellement, « L'Ami de l'Ordre ». On
l'achetait peu. Parfois des avions alliés lançant des tracts antiallemands
ranimaient quelque espoir. On n'aurait osé écrire ce qu'on pensait, car les
lettres pouvaient être décachetées et lues. Elles étaient affranchies au moyen
de timbres allemands surchargés BELGIEN. Le facteur qui allait chercher la
correspondance à Givet, déclarait avoir vu la surcharge « Givet-Belgien ». 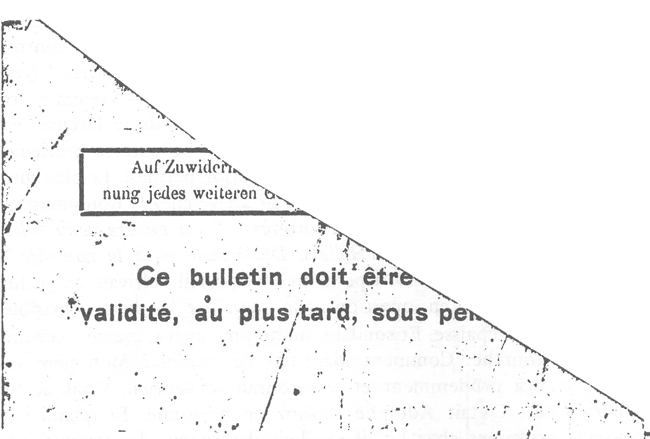

Chaque nuit des
avions allemands partaient de leur champ d'aviation de Morville
pour des missions de bombardement. De terre, des fusées rouges et vertes leur
indiquaient la voie du retour. Une rentrée au village : Désirée Haurel, réfugiée en France en 1914 avait le mal du pays et
voulait rentrer près de sa fille Lina. Elle réussit à revenir par la Suisse.
Inversement, Alice Laurent put partir de Doische en
transitant par la Suisse pour retrouver son mari en France. En 1917 de nombreux soldats s'établirent
à Doische, logeant chez l'habitant. Ils partaient le
matin avec pelles et pioches en braillant des airs aussi martiaux que
gutturaux. Ils allaient creuser des tranchées sur les trieux
pierreux des Retondus. Et d'autres arrivèrent encore pour installer un champ
d'aviation dont la piste d'envol descendait du bois Grégoire jusqu'aux haies
des prés du Marais. Cela entraîna encore des réquisitions d'attelages chez les
fermiers et du travail obligatoire pour des prisonniers de guerre français
logeant dans une maison vide du Faubourg et à qui les gosses portaient leur
couque scolaire. On dut arracher les piquets et les fils de pâture, combler les
fossés niveler le sol. De vastes tentes vertes abritaient les appareils sévèrement
gardés. De hauts gradés organisaient le tout avec soin et célérité. Et l'on put
suivre de près les manuvres d'envol et d'atterrissages de leurs engins pas
très gros. De plus, tout ce personnel dut trouver place dans nos maisons et la
commune dut emprunter 15.000 frs pour leur logement. Un des officiers
commandant le champ d'aviation est revenu à Doische
en 1940, reconnaissant les gens qu'il avait connus. Le front restait figé sur place, de
l'Yser à la Suisse. Toutefois deux évènements importants se produisirent. Le 6
avril 1917 , les Etats-Unis entrèrent en guerre aux côtés des Alliés, après le
torpillage par les Allemands de leur navire « Le Lusitania ». Mais il
leur fallait arriver. D'autre part, fait dangereux, la révolution russe arriva.
Soudoyés par les Allemands, les Russes signèrent un armistice avec l'ennemi. Le
15 décembre 1917, abandonnant sans préavis leurs alliés, ils déposèrent les
armes. CHAPITRE VI Les Alliés ont enfin la suprématie sur
mer. Les Américains arrivent en force. Mais les Allemands ont pu ramener à
l'Ouest la masse des régiments qui combattaient à l'Est et en quelques mois ils
vont monter une formidable offensive. En Picardie le 21 mars, sur la Marne le
17 mai et en Champagne le 15 juillet. Un régiment de dragons allemands ayant
passé par Doische avaient percé le front français à Cambrai.
Ils arrivèrent près de Paris, dernier coup de boutoir de la bête traquée.
Devant le danger les Alliés ont enfin admis l'unité de commandement sous les
ordres du maréchal Foch. Celui-ci va pouvoir déployer son génie militaire dans
tous les secteurs. Les Américains sont arrivés en force, avec une multitude
d'avions. Les Alliés acquièrent la maîtrise de l'air. Les tanks, une inconnue
dans cette guerre, vont surprendre les ennemis qui n'ont pas de parade contre
eux. Soutenus par l'artillerie, les blindés foncent en avant sans grand risque
suivis des fantassins décidés à en finir. Français, Britanniques, Américains et
Belges sentent fléchir l'adversaire qui recule mais en bon ordre encore. Ce
n'est qu'en septembre 18 que l'offensive progresse partout, irrésistible. On
attend fiévreusement et on redoute aussi le moment où le front arrivera chez
nous. Le 1er novembre 1918 nouvelle
douche glacée sur les enthousiasme. Les Allemands ordonnent l'évacuation
complète du village pour le soir de ce jour de Toussaint. Lieu d'exode fixé à Romerée. Idem pour les habitants de Foisches
et de Ham-sur-Meuse et pour des gens de Saint-Quentin chassés de chez eux dans
les Ardennes françaises. Pourquoi ? Pour une éventuelle résistance sur la Meuse
? Quel branle-bas inattendu ! Les fermiers attellent vivement leurs chariots. On
fait appel à tous les charretiers de Romerée, on
reprend tombereaux, charrettes d'enfants, brouettes et l'on s'en va, porte
ouverte à tous les intrus. Chacun a chez lui cette fois, une bonne cachette à laquelle
on se fie, où l'on entasse ce qu'on a de précieux. On charge en partant farine,
saloirs, linge, matelas. Et les gens de Romerée sont vraiment
accueillants et charitables. « Faites comme chez vous », nous disaient-ils.
Les avions alliés passaient, nombreux, surveillant les concentrations ennemies. Et une épreuve nouvelle survient,
angoissante : la grippe espagnole, terrible maladie qui a sévi dans tous les
environs, comme la peste survenait au moyen âge après les guerres. Elle frappe
spécialement les jeunes gens en pleine force. Marcel Lambeau en meurt à 18 ans.
Au moment de l'évacuation Albert Wayens en est
gravement atteint. Il avait épousé Laure Houbat le 13
juin. Le malade intransportable fut soigné par sa femme et sa belle-mère. Les
autres membres de sa famille durent partir. Albert mourut le 5 novembre. Les
Allemands ne prétendirent pas qu'on l'enterre à Doische.
Les funérailles eurent lieu à Romerée, son corps
étant déposé dans un caveau. Il n'aura pas eu le bonheur de voir sa fillette
née après son décès. Sur le terrain, les alliés progressent,
le front allemand craque de partout. Les Belges ont repris le Mont Kemmel et la
forêt d'Houthults. Pendant plusieurs jours repassent
d'énormes troupeaux de bovidés aux grandes cornes, réserve de viande fraîche de
l'armée ennemie. Puis ce sont des prisonniers français occupés derrière le front.
Ils sont affamés. Quand ils traversent un village, Romerée
en particulier, ils entrent dans les maisons malgré les sentinelles trop peu nombreuses
qui frappent et qu'on injurie. On donne à ces malheureux tout ce qu'on peut.
J'en ai vu ramasser des morceaux de sucre qu'on leur lançait et qui étaient
tombés sur un fumier. Parfois ils traînent à bout de bras un chariot chargé de
leurs maigres bagages. Puis enfin ce sont les colonnes serrées des troupes
allemandes aux croisements des routes. Enfin le 11 novembre, les soldats
ennemis criaient pleins de joie d'avoir tout de même échappé à la mort : « Guerre
finie, Madame ! » On en doutait encore. Et pourtant c'était vrai. La
nouvelle se répandait comme une traînée de poudre. Les Alliés étaient déjà à
Chimay. Dès lors on n'eut plus qu'une idée :
rentrer chez soi... Avec mes parents je revins à Doische.
Le drapeau belge flottait au clocher de Gimnée dont
les gens avaient échappé à l'évacuation. Les Allemands occupaient encore notre
maison, cuisinant, lavant leur linge dans notre grande casserole. Nous nous
sommes réserve la plus petite chambre a l'étage, celle qui touchait à la
cachette qu'ils n'avaient pas devinée. Mon père avait bloqué le loquet de la
porte avec son crayon et la nuit se passa sans que nous soyons dérangés. Le
lendemain 12 novembre, de grand matin, les derniers gris partaient enfin après
avoir brûlé dans la prairie d'en face, une foule de papiers et documents
compromettants. A neuf heures le village était libre. Les habitants rentraient par
groupes. Soudain vers 11 heures la petite cloche qui nous était restée
se mit à sonner, frénétiquement, sans arrêt. Que se passe-t-il ? On court. Ils
étaient là, les chasseurs d'Afrique, les beaux cavaliers français à toque
rouge. On n'avait à leur offrir que notre admiration et notre infinie
reconnaissance. Les libérateurs qu'on avait tant attendus étaient là ! Quel
bonheur de se trouver parmi eux. Mais c'étaient eux qui, nous voyant si
démunis, nous offraient quelques douceurs. Puis ils furent remplacés par des
chasseurs alpins. Pas un gosse qui ne cherchât un souvenir, ne fût-ce qu'un
bouton. Moi, je fus comblé par un bonnet de police qu'un chasseur me donna. Je
crois bien qu'on ne me l'aurait enlevé qu'avec la vie. Les soldats suivaient
les Allemands pas à pas, sans combattre puisque l'armistice était signé. On put
voir des Australiens, des Néo-Zélandais aux grands feutres kaki, tous jeunes, biens
nippés, propres, ardents. Alors on procéda au grand nettoyage et ce fut un gros
travail de laver tout, de la cave au grenier, de décrasser les ustensiles de
cuisine et d'ouvrir enfin les « cachettes » pour replacer chaque
objet à sa place, tout en dénombrant les objets manquants. Les évacués étaient
rentrés : tous les visages étaient transfigurés par le bonheur. On respirait
avec délices l'air de la liberté, la vie était radieuse. Pendant quinze jours,
des prisonniers français, libérés après l'armistice repassaient à pied et
devaient rejoindre Mariembourg où des trains les
attendaient. On les invitait, on les logeait, on leur donnait à manger ce qu'on
pouvait. Eux aussi étaient délivrés du cauchemar de la guerre. Cependant cette joie exaltante n'était
pas partagée encore par les familles de nos soldats. Qu'étaient-ils devenus
durant l'offensive libératrice ? Collés aux talons des Allemands, ils les
reconduisaient chez eux et on les attendait, Dieu sait avec quelle impatience. Puis
assez tôt, ce fut le retour des prisonniers de guerre dont la plupart étaient
restés quatre ans en captivité, soumis à l'ennemi, à ses travaux forcés
accomplis avec écurement, à ses brimades. Ils avaient supporté la séparation,
les privations, la faim. Puis ce furent les internés de Hollande qui n'avaient
pas non plus été gâtés, considérés comme des gêneurs indésirables et on le leur
avait bien fait sentir. Enfin ceux de l'Yser qui avaient tenu quatre ans
derrière les sacs de sable, mordus par le vent et la gelée, les pieds dans la
boue glacée, toujours inquiets, le doigt sur la gâchette pour prévenir une
attaque, soumis aux bombardements et aux gaz asphyxiants, comme Wauthier Albert, ceux qui enfin s'étaient élancés hors des
tranchées, avaient foncé sous les balles des mitrailleuses, risquant le tout
pour délivrer le pays et étaient parvenus le 11 novembre au canal
Gand-Terneuzen, tous, y compris ceux qui avaient été mobilisés en France où ils
s'étaient réfugiés. Rentrèrent aussi les soldats français mariés à Doische, tous au complet. Un fait amusant lors de la rentrée
d'Auguste Sagot qui, après avoir connu l'enfer de
Verdun, se trouvait le 11 novembre à côté des Belges. Accompagné des siens dont
son fils Jules né le 5 août 1914, il faisait le tour des parents et des amis
avant de rentrer enfin chez lui au Tienne du Bois, alors le gamin qui ne
connaissait pas son père s'était arrêté sur la route et avait demandé : « Il
vient coucher à la maison cet homme là ? ». Mais quelques familles ont attendu en
vain dans l'angoisse et elles connurent la triste nouvelle qu'elles redoutaient
: Nestor Beaumont mort en 1914 en sentinelle à Termonde, Joseph Laurent mort à l'Yser,
Arthur Jourdain blessé mortellement lors de l'ultime offensive, soigné par la
Reine. Ils ont payé de leur vie, la paix et la liberté dont nous jouissons. Ils
étaient de la génération à qui le sacrifice suprême a été imposé. Pensons
encore à la reconnaissance que nous leur devons, à eux et aussi à leurs
familles. La loi belge a accordé aux mères et aux veuves de soldats le droit de
vote. C'est pourquoi Victorine Chaboteau mère de
Joseph Laurent était la seule femme qui avait le droit de voter à la place de
son fils. Dans leur fuite, les Allemands avaient
abandonné de nombreux trains emplis de chargements divers. Certains en
profitèrent pour se procurer des choses utiles. Mais il y avait aussi des
wagons de munitions. L'armée belge envoya quelques hommes pour les surveiller. Ils
ne s'ennuyèrent pas à Doische car plusieurs y
trouvèrent une épouse qui les dédommagea des maux soufferts pendant la guerre.
Ils étaient enviables les héros revenus chez eux. Mais des munitions, il y en
avait partout, le long des routes, des bois : les caissons d'artilleries s'étaient
vidés pour s'enfuir plus vite. Tous les gamins, comme enragés, arrachaient
entre deux pierres d'un mur les balles des cartouches, récoltant la poudre pour
la faire brûler. Les grands vidaient les obus de tous calibres qui renfermaient
une poudre sous la forme de macaronis jaunes. Par farce, on mettait le feu à
une extrémité et ça courait ça et là à l'improviste provoquant la panique des
uns, la joie des autres. 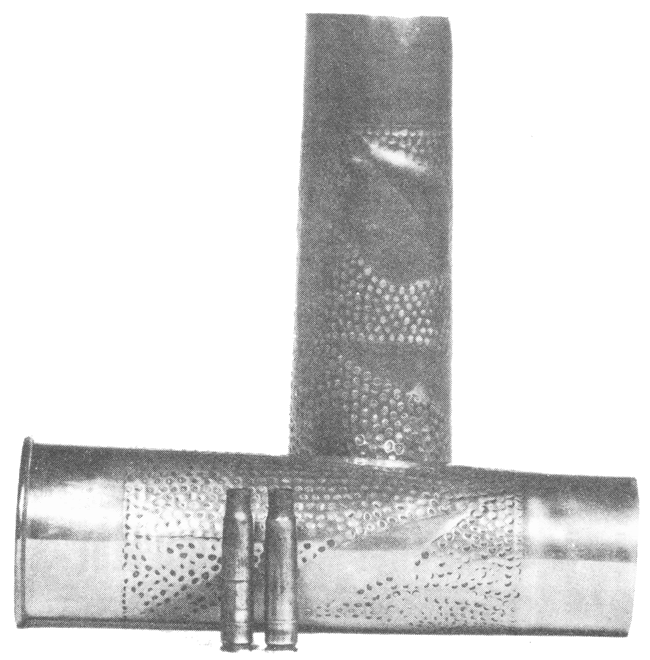
Art de tranchées Ce fut la grande
mode des douilles d'obus employées comme vases et récurées avec ardeur. Hélas !
des accidents nombreux devaient en résulter, à la figure, aux mains, aux yeux. Il
y avait tellement de munitions, que les autorités françaises les faisaient
conduire sous bonne garde à l'ancien champ de tir entre Doische
et Givet pour faire sauter, chaque jour, un lot dans l'après-midi. Alors ce fut
la ruée pour récolter les éclats qu'on revendait comme ferraille à Monsieur Demblon qui en faisait commerce. On disait que c'étaient
des Annamites qui étaient chargés de cette dangereuse besogne. Les Allemands nous laissèrent un autre
cadeau empoisonné : leurs marks avec quoi ils payaient leurs achats, la solde
des soldats. Ce mark avait évidemment cours officiel à 1,25 frs. Le
Gouvernement belge les reprit à leur valeur de 1,25 frs. Il y en avait pour
sept milliards (argent de 1918). Alors les dirigeants allemands provoquèrent la
faillite de leur monnaie. Les ouvriers allemands avec qui les prisonniers belges
ont travaillé en 1940 disaient : « A l'usine on payait les ouvriers
deux fois par jour : à midi on dépensait tout l'argent gagné dans la
matinée et le soir après le travail, on achetait ce qu'on trouvait mais
déjà 20 pour cent plus cher qu'à midi. Le lendemain les prix étaient
doublés ». Puis un beau jour on a imprimé de nouveaux marks à valeur
stable. Un état qui fait banqueroute n'a plus de dettes. Ils ne sont pas les
seuls à l'avoir fait d'ailleurs. La Belgique n'a pas recouvré ses sept
milliards. Qu'à cela ne tienne, on était débarrassé de leurs personnes, de leur
idéologie néfaste, de leur racisme bien germanique. 


Chez nous la vie reprend. Les anciens
combattants ne sont pas riches : toutes les petites économies ont été dépensées
par la famille pour survivre. Ils recommencent à zéro. Ils recevront des
chevrons de front ou de captivité bien mérités. Les entreprises rouvrent leurs portes
: il y a tant à reconstruire. Les gens de Doische qui
ont subi deux fois l'évacuation peuvent réclamer des dommages de guerre. « Ils
paieront », se disaient les bonnes gens. Pour la population c'est toujours la
joie, l'espoir d'un long avenir de paix assuré. On rétablit les kermesses. La
Madelon des poilus de France fait le tour de tous les villages avec d'autres
chants patriotiques. Toutes les librairies, même les magasins de Doische, vendent des récits des grandes
batailles : Verdun, chemin des Dames, Marne, Yser. On célèbre les grands
artisans de la Victoire : Foch, Clémenceau, le roi Albert et Wilson,
l'Américain, et Lloyd George, l'Anglais. A Doische on
fête les anciens combattants placés dans le chur pour la grand-messe, puis
discours, vin d'honneur. Ils auront leur drapeau par souscriptions volontaires.
Le 11 novembre est devenu jour férié légal, le jour du souvenir où tous doivent
retrouver des idéaux communs. Les nations qui s'étaient si sauvagement
entretuées ont créé la Société des Nations à Genève où, en théorie, les
représentants de tous les pays devront résoudre les litiges et empêcher des
guerres futures. On y a cru, l'idée était généreuse. On passa quelques bonnes
années dans l'euphorie de la victoire et de la liberté reconquise. Mais un jour on s'apercevra qu'on a rêvé
les yeux ouverts. Car 1940 est venu. On a subi une seconde guerre pire que la
première. On a créé l'Organisation des Nations Unies, l'O.N.U., avec
cinq Grands qui ont le droit de veto. Sera-ce seulement une tribune politique
de format mondial ou le lieu de rencontre des artisans de Paix ? Souhaitons que
les Présidents tout puissants des Grands pays. ne soient que des hommes au cur
de chair, humbles, pacifiques, bons comme sont les tous petits. IN MEMORIAM En reconnaissance émue et respectueuse
envers les soldats morts au champ d'honneur et les victimes civiles. 
Givet : La trouée de la Meuse |
© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©