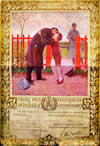Médecins de la Grande Guerre
Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Conférences
-
Conférences
-
![]() Articles
Articles
![]() Photos
-
Photos
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
|
Les
déportés en Allemagne. Préface La déportation de milliers
de travailleurs belges et Français fut
un véritable fléau pour nos populations. Ce crime de guerre fut
souvent passé sous silence et tomba vite dans un certain oubli
vraisemblablement parce que la
souffrance de nos ouvriers fut considérée comme peu glorieuse en comparaison de
celle endurée par nos soldats, prisonniers de guerre et résistants ! Le récit ci-dessous parut
dans « Dr Loodts et Francis
De Look. Les
déportés en Allemagne Aux premiers jours de la mise en vigueur
des déportations, nous avons consigné les faits suivants : «Les trains de civils » sont devenus
dans l’est de la Belgique des mots à signification spéciale, un « terme de
guerre ». Ce sont les trains chargés de civils déportés, qui suivent
surtout la ligne de la vallée de la Vesdre, Liège-Verviers- Welkenraedt. Et les
habitants de la région observent leur passage et s’entretiennent parfois avec
les déportés lorsque les trains doivent se garer pour laisser passer des
convois militaires. Ainsi le 1er décembre, on vit
passer trois longs trains : un le matin, un à midi et le troisième à 4
heures. Ils transportaient des civils de Saint-Nicolas, de Tamise et d’Anvers. La veille avaient passé les déportés
d’Andenne. On voit sur ces trains toutes sortes de
civils, entre autres un paysan avec ses trois fils, un facteur des postes en
uniforme, enlevés directement de la rue, etc. Des trains de civils circulent également
la nuit, comme le prouvent les clameurs et les chants qui s’en échappent. On envoyait surtout en Allemagne les
déportés du territoire du gouvernement. Traçons d’abord un aperçu général. Le voyage en Allemagne durait deux, trois
ou quatre jours, selon le camp sur lequel les malheureux étaient dirigés.
Pendant le trajet on leur distribuait un peu de maigre soupe, de sorte que l’on
était bientôt contraint d’entamer les vivres emballés par la mère. La gelée ne tarda pas à se faire sentir et
bien des malheureux grelotaient derrière les vitres de leur wagon. Les camps de concentrations se trouvaient
à Münster, Soltau, Mescheide, Olten-Grabow, Guben, Cassel, Klein-Wittenberg. On parquait les déportés comme de
véritables prisonniers derrière les clôtures de fil de fer, dont certains
étaient chargés d’un courant électrique. Le traitement différait d’un camp à
l’autre ; ici on chauffait les baraquements, ailleurs il n’y avait pas de
feu ; certains hommes devaient dormir sur le parquet, d’autres sur des
sacs, qui généralement grouillaient de vermine. Cette place était d’ailleurs
commune à tous les camps, même à ceux des prisonniers. Un moyen radical de la combattre était le
rasoir, que Victor Delille, de Maldegem, a décrit d’une façon typique. Victor Delille a été prisonnier à
Holzminden et a publié sur son séjour d’intéressants détails dans son journal
hebdomadaire : « Het getrouwe Maldegem ».Nous en extrayons ce
qui suit : « L’idée de raser les prisonniers des
pieds à la tête a été mise en vigueur pendant l’été de 1915. Tout d’abord on n’avait procédé qu’à la
désinfection des vêtements, ce qui était déjà suffisamment scandaleux. A l’improviste on donna lecture d’une
liste d’une trentaine d’hommes qui devaient aller au bain le lendemain sans
qu’il fût encore question de désinfection. Mais chacun avait vu arriver la
chaudière à vapeur que l’on avait déposée devant la salle des bains. Cette
vapeur entrait dans un coffre en fer aussi vaste qu’une voiture foraine et on y
jetait les vêtements munis du nom de leur propriétaire. Il va sans dire que chacun en enlevait
d’abord son porte-monnaie, car sans cela le cuir était irrémédiablement abimé,
comme je l’ai expérimenté moi-même en y laissant un jour mes bretelles. Mais on me demandera où restaient les
hommes ainsi privé de leurs habits ? Ils se tenaient pendant deux ou trois
heures groupés ensemble dans leur costume primitif, juste comme des porcs,
prêts à être abattus. Ceux qui avaient songé à emporter une
paire de sabots pouvaient au moins abriter ses pieds, et ceux qui avaient
trouvé le moyen de cacher un essuie-main, pouvaient se le mettre à la ceinture,
mais ils préféraient s’asseoir dessus, afin d’éviter le contact direct de la
place que venait de quitter un homme couvert de furoncles sur tout le corps. Car nulle part je n’ai vu aussi
lamentablement mise à nu, la misère humaine, causée surtout par la faute des
gens eux-mêmes en temps d’abondance. Ce qui me fit revenir à la mémoire les
paroles du directeur de l’asile d’aliénés de Gand : « La moitié des
malheureux qui sont ici sont les victimes de la débauche. » Mais il y avait aussi dans le nombre des
gens honorables. Aussi je n’oublierai jamais ce Français
septuagénaire qui avait une bosse devant et une autre dans le dos. Il avait déjà atteint cet âge respectable
et peut-être était-ce la première fois de sa vie qu’il était obligé de montrer
à d’autres son disgracieux physique que seule sa mère avait vue, et maintenant
il pleurait comme un enfant, peut-être aussi pour la première fois depuis qu’il
avait quitté sa mère... Au bout de deux, trois heures arrivait
l’heure – qui en durait parfois deux – où l’on conduisait les hommes dans une
pièce plus spacieuse afin de leur remettre leurs vêtements. Cette salle de dimensions vastes, était
aussi beaucoup plus froide, et pour se réchauffer les hommes sautaient sur le
dos l’un de l’autre ou dansaient une polka, offrant un spectacle si bêtement
sauvage que les nègres n’auraient pu faire mieux. Un Gantois, acrobate de son état, se
trouvait dans son élément. Jamais il n’avait pu exécuter ses tours avec une
pareille liberté sur la grand’ Place ; aussi lançait-il ses jambes en
l’air et battait-il des pieds avec autant de forces que ses compagnons le
faisaient à l’aide de leurs mains. Dommage pour lui qu’il ne pût collecter de
l’argent, attendu que personne n’avait de veston. La distribution des vêtements portait ce
jeu sauvage à son point culminant. Ils n’étaient plus munis de cordes ou de
rubans distinctifs, ni de noms quelconques : chemises et flanelles,
pantalons et vestons, bas et caleçons étaient saisis par vingt mains à la fois
et essayés à vingt corps et plus, avant de trouver leur véritable propriétaire,
et beaucoup d’hommes qui étaient venus avec un bon pantalon s’en allaient avec
un pantalon usé et rapiécé, prêts à vider définitivement le conflit à l’intérieur
du baraquement. En ce qui concerne l’argent, la montre et
les bijoux, ces objets avaient été mis en sureté chez l’un ou l’autre ami. Mais qu’arrivait-il lorsque l’on procédait
subitement à l’appel dans cette baraque et que tout ce qu’elle refermait devait
être versé dans la chaudière ? Cette première période de la désinfection
n’était rien encore en comparaison de ce qui allait se produire un mois plus
tard : les séances de rasoir ! Cela commença naturellement aussi par la
remise et on ne savait pas à un jour près quand l’opération se ferait. Car un
grand nombre avaient déjà payé un mark ou deux pour se présenter à leur place. Ce n’est que le matin lorsque deux
Allemands se postaient devant la porte, la baïonnette au canon, que l’on était
sûr de devoir aller à la chaudière. Même début donc : déshabillement et
remise des vêtements ! Ceux qui étaient très propres, pouvaient en
réchapper, mais tous les autres devaient prendre place sur la table. Je fus un des rares qui n’ont pas été
couchés sur la table, mais j’ai observé le manège par la fenêtre, que plus tard
on a aveuglée au moyen de planches. J’avais d’abord entendu raconter la chose
par M. Calberghe, le fabricant de chapeaux d’Audenarde, qui s’était laissé raser
quasi volontairement la première fois afin de pouvoir décrire la chose, la
seconde fois il paya aussi un remplaçant ; il y avait ainsi des
prisonniers qui gagnaient de l’argent en se faisant raser et gratter
constamment au point d’être lisse comme des anguilles. Mais le fait le plus répugnant dont j’aie
été témoin est le suivant : un riche habitant de Bruges, un homme d’une
soixantaine d’années, étendu sur la table, tandis que son fils de seize ans
était obligé d’assister à la scène ; et après le père ce fut le tour du
fils. Il m’avait juste dit la veille qu’il
devait être particulièrement pénible d’être rasé par derrière, qu’il avait
connu un homme qui en avait fait l’expérience à la suite d’une opération et qui
éprouva d’abord des difficultés à marcher. Et dire que les bourreaux qui
remplissaient cette besogne étaient des Belges eux aussi et trouvaient un
certain plaisir à prolonger la torture le plus longtemps possible et à apporter
toutes sortes de raffinements. On rasait d’abord la tête, et de si près
qu’on eût dit autant de cailloux et, chose extraordinaire, on ne touchait pas à
la barbe. Mais pour le reste on ne laissait pas un
poil sur tout le corps jusqu’aux orteils, comme on fait pour les cochons de lait
qui sont expédiés en Angleterre. Et lorsque la partie supérieure était en
règle, un ou deux aides-bourreaux retournaient le corps sur le côté et ainsi
finalement on arrivait à la partie postérieure et on écartait les jambes. On devine sans peine que tout cela ne se
faisait pas avec l’habileté d’un chirurgien expert. Une fois j’ai entendu hurler un patient,
probablement blessé, jusque dans ma baraque, à cinquante mètres du lieu de
l’opération. A la fin les Allemands n’avaient plus de
savon et c’est pourquoi ils employaient un produit chimique qui brûlait les
poils presque instantanément, mais non sans douleur. On le voit, les hommes livrés à
l’Allemagne devaient renoncer à toute dignité, à toute liberté personnelle. Ils
n’avaient plus de volonté propre. Aussi s’efforçait-on par tous les moyens de
briser la résistance des déportés. Quelques jours après leur arrivée, on les
laissait tranquilles. Puis on demandait aux infortunés s’ils
voulaient signer un contrat de travail ; ainsi on croyait pouvoir réfuter
la preuve de la contrainte. Mais pour amener les déportés à signer, on
voulait d’abord les épuiser physiquement et moralement. A cet effet, on mettait
en œuvre ces deux armes : le froid et la faim ! Il fallait vivre d’une soupe à l’eau avec
un croûton de pain, car c’était la seule nourriture que recevaient les
malheureux. La faim tenaillait nos compatriotes, que
l’on voyait circuler autour des cuisines et des bacs à ordures, à la recherche
d’un morceau de pomme de terre ou d’épluchures, d’une pelure de navets ou d’une
croûte de pain. Et c’est à de tels moments que les
Allemands se présentaient avec leur contrat séduisant et disaient : « Mais signez et vous serez un
travailleur libre, vous gagnerez de l’argent et vous pourrez acheter de quoi
manger. » Dans ces conditions beaucoup devaient
succomber. Mais beaucoup aussi résistèrent et refusèrent. « Vous n’êtes pas obligé de
travailler pour la guerre », prétendaient les enrôleurs. « Vous
pouvez allez en congé à la maison, et envoyer de l’argent à votre
famille. » Mais ils refusaient malgré tout. On
voulait leur envoyer des colis du pays. Mais les vaillants Belges ne pouvaient
pas être aidés dans leur lutte. Le gouvernement général défendit à
l’Agence belge, pour les prisonniers sous la protection de la Croix-Rouge
d’envoyer des vivres aux soi-disant chômeurs. En effet on les nommait des
« travailleurs libres » et on ne pouvait les atteindre que par la
poste ordinaire, c’est-à-dire que l’expédition devait être chère et lente. Les plaintes se firent plus vives, les
ministres étrangers se mêlèrent des faits et le marquis de Villalobar réussit,
malgré tout à organiser le 19 février 1917 un service pour les hommes déportés
en Allemagne. Le Comité National accorda son concours et
l’initiative privée parvint à recueillir en quelques jours, presqu’en secret,
une somme de 367.647 francs, qui devaient servir à expédier 108.417 kilos de
vivres à sept camps. Que de souffrances endurèrent ceux qui
persistaient dans leur refus ! Ils furent accolés à des murs, dans la
neige ou la boue, pendant des heures, le jour et la nuit, exactement comme dans
le Nord de la France. Beaucoup s’abattirent exténués ; on les transportait
à l’hôpital, où ils mouraient, ou bien ils retournaient finalement chez eux
comme de lamentables épaves. Puis il y avait encore un autre
moyen : on envoyait les réfractaires en Prusse Orientale, dans les mines
de sel, en Silésie, dans les régions éloignées, où n’existait aucun contrôle et
où l’on pouvait maltraiter encore davantage les pauvres martyrs ! Citons encore quelques dépositions
relatives à ce qu’on a justement appelé l’enfer allemand, expression qui n’est
certes pas exagérée. Henri Spinoy, de Bruxelles, déclara ce qui
suit dans une enquête officielle : « Le 24 janvier 1917, nous avons été
embarqués à Bruxelles-Midi, dans un train chauffé au départ ; à Louvain,
toutefois, le chauffage était interrompu. A Landen, il nous a été servi une
portion de choucroute. A Aix-la-Chapelle et dans une localité un peu plus
éloignée, mais que nous ne pouvons désigner, on nous a servi une soupe
immangeable, dans laquelle nous avons constaté la présence de tranches de
betteraves. Après un voyage de trente-six heures, nous sommes arrivés au camp
de Münster. On nous obligea à nous coucher sur des paillasses fabriquées au
moyen de déchets de papiers et de chiffons, remplis de vermine. Notre nourriture au camp consistait :
le matin, en un pain de 2,5 kilos pour dix personnes ; à 8 heures et
demie, en une mixture s’appelant thé : à 13 heures, en une soupe aux
poissons, aux choux-raves ou aux betteraves, et à 16 heures, on nous servait
également une boisson que les Allemands appelaient thé. Une fois, il nous a été
servi un plat de céréaline. La quantité de soupe était d’environ un demi-litre.
Nous sommes restés environ huit jours à Münster, où nous avons subi la visite
médicale. Le lieutenant Heping est venu nous
solliciter, à plusieurs reprises, pour que nous signions un contrat de travail ;
jamais aucune réponse n’a été réservée à cette proposition. Huit jours après notre arrivée, le camp a
été divisé en groupes. Celui dans lequel nous nous trouvions a été dirigé vers
Porta. Comme nous refusions de travailler, nous avons dû nous placer en file
indienne, à 50 cm l’un de l’autre, debout dans la neige. Il nous était
formellement interdit de bouger, d’accomplir nos besoins, de mettre les mains
en poche ou de les couvrir de gants. Pendant
trois jours, nous avons dû rester dans cette position, de 9 heures à 12 heures et de
14 heures à 17 heures. Nos paillasses et nos couvertures nous
avaient été enlevées et, par ce froid rigoureux, nous devions dormir avec nos
vêtements comme seule couverture. On nous dispensait tous les jours, une demi-ration
de tiges de choux moulues qui répandaient une odeur nauséabonde. Ces traitements inhumains nous ayant mis à
bout, trente d’entre nous ont accepté de travailler, mais sans signer aucun
contrat, dans une fabrique « Akt Ges. Porta-Cimentwerke », à Porta.
Quarante Anglais y travaillaient déjà. Le directeur Mayer, était un homme
brutal ; sans rime ni raison, il frappait les déportés. Le travail était rude ; il consistait
à déblayer la neige et la glace, à charrier des pierres. Toujours cette besogne
s’accomplissait à ciel ouvert. La plupart du temps, nous étions trempés
jusqu’aux os et dans l’impossibilité de nous changer. Porta était éloigné de toute église ;
il nous était donc impossible d’accomplir nos devoirs religieux. Nous sommes restés
un mois sans avoir jamais vu un prêtre. Ne pouvant plus endurer les traitements
qui nous étaient infligés, nous avons, après un mois, refusé tout travail. Nous avons alors été renvoyés au camp de Münster,
où nous sommes restés pendant quatre jours. Nous avons ensuite été dirigés sur
Oberhausen (près de Düsseldorf), où l’on nous a employés dans une usine de
béton armé. A Oberhausen, nous n’avons pas été battus,
mais la nourriture était comme partout, insuffisante et immangeable. Celle-ci consistait
en 250 grammes de pain par jour ; trois quarts de litre de soupe de
choux-raves ou aux betteraves le midi ; le soir, à 7 heures, une soupe aux
féveroles. Philippe Dubois fut également envoyé à Münster
et de là à Merklinden près de Bochim, où il y avait un grand chantier de
construction. « Nous étions logés, raconte-t-il,
sans feu dans des maisonnettes construites pour les mineurs. Le matin, le lever
sonnait à 5 heures et nous devions nous diriger vers le chantier, où nous
arrivons vers 6 heures. Aussitôt, il fallait se mettre au travail. Celui-ci
consistait en une besogne de terrassier. Nous étions plongés dans l’eau
jusqu’aux genoux. A 9 heures, on nous remettait environ 100 grammes de pain et
le travail continuait jusqu’à midi. » Nous nous dirigions alors vers un
baraquement construit sur le chantier même et où l’on nous donnait une
demi-gamelle de soupe aux rutabagas et aux betteraves. Le repas de midi variait entre 1 heure et
1 heure et demie ; on se remettait alors au travail jusqu’à 4 heures, puis
un repos d’un quart d’heure était accordé, au cours duquel on nous distribuait
une nouvelle ration de 100 grammes de pain. Le travail reprenait jusqu’à 8
heures ou 9 heures du soir, alors que les ouvriers allemands terminaient à 7
heures. Il arrivait aussi que la soupe, nous, fût
distribuée à la fin de la journée, mais, très souvent, le contremaître allemand
déclarait que nous n’avions pas suffisamment travaillé et, en conséquence, nous
étions privés de nourriture. Les deux contremaîtres allemands étaient
porteurs de matraques dont ils se servaient constamment. Ainsi, un jour,
souffrant de la gorge, je demandai au contremaître de m’autoriser à aller voir
le médecin. Je fus battu comme plâtre. Après ces brutalités, le contremaître me
demanda narquoisement si j’étais guéri. Merklinden était un véritable enfer. Mon
jeune frère, qui se trouvait à mes côtés, pleurait constamment ; sa
souffrance m’était plus pénible encore que le mienne. Jamais nous ne pouvions accomplir nos
devoirs religieux ; le dimanche était le jour de travail comme les autres.
Si nous négligions, le dimanche, d’aller au chantier, des soldats venaient nous
chercher dans nos baraquements et nous plaçaient dans la cour, les mains en
l’air, par un froid intense. Nous pensions que ces traitements
inhumains étaient interdits et constituaient des excès de la part du personnel
subalterne. Nous fûmes nous plaindre au patron, Monsieur Naumann, mais celui-ci
nous déclara qu’il devait en être ainsi et que nous devions mourir à la tâche. Vers le 10 mars, tous les Belges se
trouvant à Merklinden se concentrèrent et, d’un commun accord, refusèrent le
travail. A partir de ce moment, aucune nourriture ne nous fut plus accordée.
Pendant sept jours nous vécûmes de pelures de pommes de terre et d’un rare
morceau de pain que nous allions mendier aux enfants sortant de l’école. Le
septième jour, des soldats vinrent nous prendre et nous conduisirent à Münster.
Là, nous restâmes inactifs jusqu’au 30 mars. Alors, affaibli, mourant de faim,
je consentis à travailler, mais sans contrat. Je fus conduit à Sterkrade, dans une usine
où se fabriquaient des munitions et où s’exécutaient des travaux en bois, en
fer, etc. Pour ma part, voyant des prisonniers français et russes dans un
atelier de bois, je dis aux Allemands que j’étais menuisier et on m’employa à
la confection de caisses. Le 30 juillet, nous avons cessé le
travail, parce qu’il nous avait été promis que nous aurions été libérés à cette
date. Nous restâmes inactifs jusqu’au 9 août. A cette date, un officier de
Münster vint nous engager à continuer le travail, en disant que nous serions
complètement libérés le 12 décembre et que nous pourrions, sur le champ,
bénéficier d’un congé de quinze jours. Abattu moralement et physiquement, je
feignis d’accepter cette proposition ; je ne voulus toutefois signer aucun
contrat et je me réservai de me cacher à Bruxelles, afin d’éviter une nouvelle
déportation. A Sterkrade, pas plus qu’à Merklinden,
nous ne pouvions accomplir nos devoirs religieux. Le dimanche, nous devions
travailler de 6 à 13 heures. Les Allemands nous disaient que nous
gagnions 5 marks par jour, mais au bout de la semaine, il ne nous restait que
quelques pfennigs. Le bon que je vous confie établit que, pendant la semaine à
laquelle il se rapporte, je n’avais, en fin de compte, rien gagné. 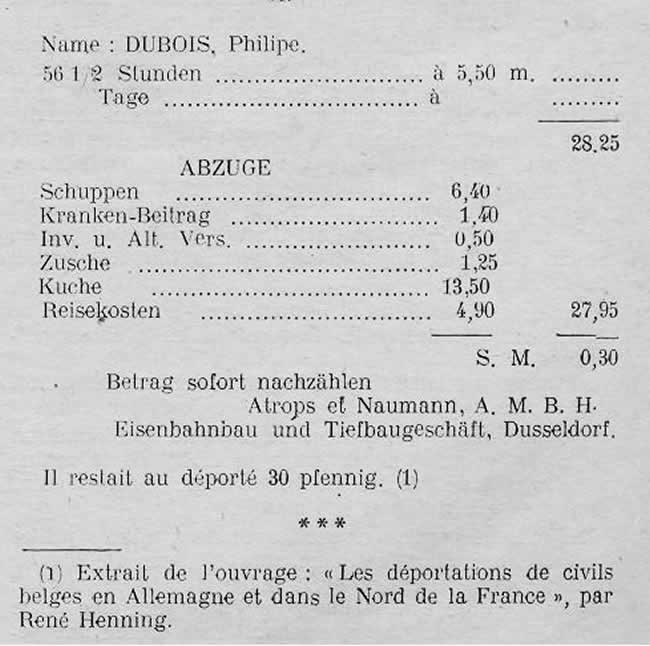
Nous venons de voir par une déposition que
les enfants allemands témoignaient souvent de la commisération envers les
déportés et leur donnaient du pain. A ce point de vue nous trouvons des
détails frappants dans le récit des aventures du Malinois François Rillaerts.
Celles-ci sont rapportées par M. Fr. Van den Bergh dans son excellent ouvrage :
« Récit de guerre », au chapitre : « Dans une prison allemande ». Rillaerts était occupé dans une ferme. Il
devait mettre des gerbes dans la batteuse. De temps en temps une fillette
venait assister au travail ; c’était une Gretchen revenue du pensionnat,
un blond myosotis de quatorze ans. Cet enfant savait un peu de français et elle
était fière d’étaler ses connaissances en présence de ses petites camarades
moins instruites qu’elle. Lorsque la glace fut rompue, l’ingénieur, un des
compagnons de travail, se risqua à demander s’il n’y avait rien à se mettre
sous la dent. La jeune fille courut à la maison et
revint avec une tartine revêtue d’une épaisse couche de pâté de foie, qu’elle
tenait cachée sous son tablier. Cela me fit songer à un fait identique dont
j’ai été témoin à Malines, mais avec les rôles intervertis. Lorsque des soldats
allemands récalcitrants, qui ne voulaient plus se battre, et des prisonniers de
guerre italiens furent obligés, en guise de punition, de décharger des bateaux
dans le canal près de la porte de Bruxelles, j’éprouvai une véritable joie à
observer les actes de notre jeunesse compatissante. Les enfants savaient ces
condamnés insuffisamment nourris, et ils accouraient, surtout les petites
filles, en dissimulant sous leur tablier leur couque scolaire ; elles
passaient le plus innocemment du monde et, sans que l’un des inspecteurs pût
rien remarquer, la couque déménageait
dans la poche du veston de l’affamé, qui n’avait pas eu besoin d’un long
apprentissage pour savoir comment il devait se placer. Les enfants, toujours et partout, sont
généreux, ils ne deviennent égoïstes qu’en fréquentant les grandes personnes. « Et mon ami là-haut », dit
l’ingénieur en me désignant, « est-ce que tu l’as oublié ? » L’enfant qui parlait français se précipita
vars la maison paternelle et pendant ce temps le moitié de la tartine avec le
pâté de foie fut lancée en haut : bon ! Délicieux ! Dommage que
c’était si vite mangé. Notre ange gardien revenait aves deux
minces petites tartines au jambon. La mère aura été heureuse d’avoir constaté
que son enfant avait si bon appétit ce jour-là : signe de santé. Une
tartine pour l’ingénieur, une autre emballée dans du papier, en haut !
Puis encore une petite pomme pour chacun ; je dis une « petite
pomme » ; en réalité c’était fort probablement une
« pomme », mais c’était mon estomac, avec ses verres rapetissant, qui
me le fit croire. Ah ! Ces angoisses de la faim !
Combien de déportés, sous le coup du désespoir et de l’épuisement, commirent
une imprudence, frappèrent un gardien, un de leurs tyrans, et finissaient par
être traînés dans une de ces prisons infernales, où l’on endurait de si
effroyables souffrances. Les corps minés étaient sans cesse en
proie aux affres de la faim. Heureux ceux qui recevaient un colis de temps en
temps. Mais quel crève-cœur pour ceux qui ne recevaient rien. Le Malinois
Rillaerts raconte encore les détails qu’on va lire : « Un jour, je vis un Français pleurer
de désespoir comme un enfant. Il ressentait une atroce douleur en constatant
que les autres étaient toujours gratifiés de colis tandis que lui-même était
exclu des distributions. Il accusait les siens de l’avoir oublié sans pitié et
se refusait à admettre qu’on lui avait déjà envoyé plusieurs paquets, mais
qu’aucun d’eux n’était parvenu à sa destination. Une fois cependant, il fut au
nombre des privilégiés ; il se mit alors à danser comme un fou, s’élança
vers moi pour me communiquer la bonne nouvelle, serra le cher colis contre sa
poitrine, le baisa avec des transports d’affection et alla se cacher dans sa
cellule pour le soustraire à tous les regards. A peine y était-il assis auprès de son
trésor, au moment où il venait d’étaler le tout en le dévorant des yeux, voici
que retentit l’ordre inexorable du gardien sans pitié : « Heraus,
arbeiten ! » Effrayé, il se leva en sursaut sans avoir
le temps d’emballer et de cacher le précieux colis ; lorsqu’il revint
quelques instants plus tard, le tout avait disparu, sans que personne sut ce
qu’il en était advenu. Alors, j’ai vu cet homme rigoureux pleurer comme un
enfant, se cogner la tête de désespoir contre la muraille, menacer de tout
détruire et de se jeter sur tout le monde. Je reçus l’autorisation de lui
offrir mon paquet ; il refusa, en disant que ce n’était pas le même, que
les mêmes sentiments n’y étaient pas attachés, qu’il n’avait pas été préparé
par les mêmes mains aimées. Lorsque je fus parvenu à l’apaiser, il consentit
seulement à partager le contenu avec moi. Nous tirâmes à la courte paille pour
savoir lequel pourrait choisir : lui d’abord, puis moi, nous prîmes
chacun, à notre tour, un morceau ; ce qui restait du pain d’épices après
qu’il eût subi le pillage coutumier au bureau fut partagé en deux : le
plus gros morceau lui échut. La chance lui était favorable. J’eux la
satisfaction de le voir rire tandis que des larmes sillonnaient ses joues. Il
me garda toujours de la reconnaissance et s’entendit à me rendre souvent de ces
petits services qui sont d’une grande importance lorsqu’on se sent abandonné au
milieu d’un monde d’ennemis. C’était un homme, d’une très grande culture,
un ingénieur, qui s’était opposé par la force aux gendarmes allemands qui
étaient entrés dans l’usine de son père à Maubeuge pour saisir des machines. Rillaerts dit encore à propos de ces
prisons : « On s’habituait peu à peu à la solitude
de la cellule, on décomptait les jours, les heures, les minutes ;
c’étaient des siècles, sans doute, mais ce qui était passé, était autant gagné.
Mais la nuit, la nuit sans sommeil, hantée de rêves lugubres, on en avait peur,
non pas peur de l’obscurité, mais de soi-même. Nous nous trouvions tous dans la
situation du promeneur à l’esprit faible qui, marchand au bord d’un abîme, se
sent irrésistiblement attiré par la sombre profondeur. Cet abîme s’ouvrait
chaque soir pour nous et la question se posait de savoir si l’on pourrait
résister à la tentation qui à mesure que la faiblesse augmentait, s’imposait de
plus en plus fort la tentation de se suicider... Chaque semaine on en retirait qui avaient
mis fin à leur vie en se pendant ; lorsqu’ils ne pouvaient main la main
sur un bout de corde, on le remplaçait par un morceau de drap de lit, de la
chemise ou du mouchoir. C’est de cette façon que le brave Malinois E... pour
qui le chagrin était trop fort, mit fin à son existence. Cependant toutes les mesures de précaution
étaient prises : une fois que le signal d’aller se coucher était donné,
chacun devait se dévêtir devant son lit, plier tous les vêtements avec soin et
les déposer sur le banc que l’on glissait devant la porte et qui restait dehors
jusqu’au matin, y compris la fourchette et la cuiller. Le prisonnier ne gardait
qu’une paire de pantoufles aux pieds. Et malgré cela le nombre des suicides
s’étendait comme une épidémie, la faim en était la cause principale. Encore si nous avions reçu tout ce qu’on
nous expédiait de la maison, combien, après s’être rassasiés eux-mêmes,
auraient arrachés des camarades à la mort ! On volait en cours de route,
les gardiens volaient ensuite, et les officiers venaient à leur tour. J’ai lu dans un journal que l’on a dressé
une statistique suivant laquelle quarante pour cent seulement des dons généreux
recueillis en Amérique auraient atteint leur destination dans les régions
dévastées. Alexandre Scheerlinck, de Bruxelles, dut
rester neuf jours sans manger au camp d’Alten-Grabow, parce qu’il refusait de
signer un contrat. Il devait vivre d’un peu de soupe à l’eau. Georges Quinet, de Bruxelles, déclare de
son côté : « J’affirme que le 6 août 1917, alors
que j’étais à Alten-Grabow, trente-cinq hommes se trouvaient déjà depuis vingt
jours sans pain. On voulait obtenir d’eux la signature d’un contrat de travail
et on leur accordait seulement la soupe du midi et du soir. » Et Jean-Baptiste Roelandt, d’Anderlecht : « A Pillau, nous devions décharger
les bateaux, mais j’ai refusé de travailler. A la suite de ce refus, les
Allemands m’ont, un jour, accablé de coups de crosse qui m’étendirent par
terre. Je ne pouvais plus me bouger et j’ai été conduit à la baraque par deux
de mes compagnons. Il nous est arrivé de tuer les chiens en rue et de manger
leur viande encore palpitante. » Nous pourrions multiplier ces dépositions,
mais toutes signalent les mêmes faits, la brutalité des mauvais traitements, la sauvagerie éhontée des
bourreaux, l’esclavage et la misère la plus horrible. Et comment ne pas parler du tourment que
causait la séparation des êtres chers ! Oh ! Comme on sentait bien à
présent les liens de la famille. Ce phénomène psychologique est relevé, en
termes parfois touchants, dans une foule de mémoires particulières et de
descriptions. Alphonse Sevens, un écrivain gantois
connu, qui a goûté de la prison en Allemagne et qui a publié une foule
d’impressions de guerre, nous donne dans son livre « Loin des yeux, loin
du cœur » une analyse pénétrante de ce qu’il a vu et observé autour de
lui. « Le camp de Wurtzbourg était affecté
aux soldats français. Parmi eux il y avait des territoriaux qui
avaient été faits prisonniers au début des hostilités. Je résidai là pendant une dizaine de jours
à l’infirmerie. C’était en plein été et nous devions nous coucher dès que la
tiède clarté vespérale commençait à se fondre. Non loin de moi à trois lits de distance,
était couché un territorial à la chevelure noire prématurément grisonnante, à
la face anguleuse éclairée par des yeux fixés. De toute la journée il
n’adressait la parole à personne, paraissait toujours emporté par ses pensées à
des centaines de lieues, courait comme un égaré de gauche à droite, entrait et
sortait – car le major le laissait faire – et roulait constamment des
cigarettes. Je demandai à l’infirmier français ce qui lui manquait. D’un geste
significatif, il fit tourner un doigt sur son front : « La cervelle
un peu dérangée. » Certain soir, lorsque l’atmosphère rose du
soir fut devenue d’un bleu noir, au moment où la plupart des malades dormaient,
j’entendis des sanglots étouffés, comme ceux d’une très vieille personne. Je prêtai l’oreille. La douleur humaine longtemps continue ne
doit-elle pas chercher à se frayer un chemin ? Les larmes et les sanglots
ne sont-ils pas la soupape de sureté des pensées bouillonnantes qui feraient
éclater la tête si elles ne pouvaient pas de temps à autre, et même la nuit, se
donner libre cours ? C’était notre territorial. Je me retournai
le plus doucement possible et redressai la tête avec circonspection. Il était
couché le visage tourné vers le lit, les mains sur son petit traversin et dans
ses mains un portrait. Et il l’accablait de baisers. Et plus loin. « Je ne vous apprendrai évidemment
rien de nouveau en vous disant qu’en temps de guerre – à part la fonte des
balles et canons – aucune industrie ne connaît un plus haut degré de prospérité
que la photographie. Combien de millions et de millions de
portraits n’avait-on pas fait ? Qu’y a-t-il de plus doux pour l’homme
arraché à tous les êtres qui lui sont chers – et rendons ici un hommage de
profonde admiration à nos soldats qui, outre la longue séparation marchent avec
l’éternel fantôme de la mort à leurs côtés – qu’y a-t-il de plus doux – que de
reporter sa pensée vers le foyer, que d’essayer d’évoquer devant l’esprit les
traits l’attitude, la façon d’agir, tout l’être de ses proches, de ses frères
et sœurs, du père et de la mère, des enfants, de l’épouse ! Mais petit à petit par suite de l’absence
prolongée et poignante de la faiblesse croissante de la tête, de la détresse
grandissante de l’âme, les traits aimés des absents se font de plus en plus
vagues, comme une région sur laquelle la nuit descend d’une façon insensible
mais irrésistible. On lutte contre l’obscurcissement des
images, on s’efforce sans cesse de les réveiller à nouveau, de les fixer dans
son esprit en lignes plus fermes ; on tend les bras vers ces figures adorées
et qui vont se dissipant, comme le naufragé qui sent monter l’eau sombre autour
de lui, se débat désespérément vers
l’air et la lumière. Seuls ceux qui ont fait de la prison
cellulaire, connaissent toute l’horreur de ce sentiment. Avant l’entrée en
cellule, on leur enlève tous les portraits qu’ils ont apportés. Craint-on donc
que l’image de la femme et des enfants réchaufferait trop bien la froide
cellule ? Mais la peine arrive à expiration et les
portraits sont là. L’esprit possède de nouveau une image claire. La solitude se
dissipe, le découragement cède, la tristesse même s’atténue. Le portrait c’est la lettre continuelle,
permanente, le véritable soutien du cœur. Dans la vie du camp on est toujours et
partout livré aux griffes de l’effroyable uniformité ; on devient un pion,
un numéro. On se sent enfermer dans l’abîme de l’impersonnalité. Bref, le camp est un tombeau vivant. Oh ! Le portrait : Il vous apprend qu’un jour vous sortirez
certainement de votre tombeau, que vous avez là bas, loin, très loin, un foyer
propre, que votre propre sang vous attend ; qu’une épouse soupire après
vous. » Tels étaient les sentiments qui régnaient
parmi les déportés : leur femme et les enfants les préoccupaient sans
cesse. Combien d’entre eux, dès qu’ils pouvaient goûter un moment de repos, se
prenaient la tête entre les mains et toujours leur pensée s’envolait auprès des
êtres chers qu’ils avaient dû quitter. Mais il fallait lutter contre la nostalgie,
contre le découragement funeste, faute de quoi on n’était qu’une épave et on ne
faisait plus que languir. Car la mort fauchait sans répit. J’ai sous les yeux la lettre d’un déporté.
Il écrit d’un village de la Forêt Noire. « Froid piquant et pas de feu. Hier
des camarades avaient enlevé quelques planches de dessous les matelas et les
avaient fait flamber. L’officier vient d’arriver et il nous déclare que nous
avions à débourser chacun un mark d’amende, pour payer le bois. Ceux qui ont de
l’argent doivent payer pour ceux qui n’en ont point. On vient à l’instant de
chercher six hommes pour porter des cadavres. Il y a déjà huit morts ce matin.
Combien n’y en aura-t-il pas ce soir ? Et alors nous les emportons au
cimetière près du bois, où le vent murmure dans les arbres sa plaintive
mélopée. » Jean-Jules Dufour écrit : « Cette baraque du lazaret à Ohrdruf
est réservée aux affections pulmonaires, et on y meurt sans trêve... Alors
l’aumônier militaire allemand vient quelquefois. Lui aussi est en uniforme
gris-vert de campagne, haut guêtré de cuir, avec des étoiles de capitaine. A sa
casquette, au col, une minuscule croix violette rappelle son sacerdoce. L’autre
jour, deux d’entre nous agonisaient. Prévenu, il tombe par erreur en arrêt
devant mon lit, et d’une voix rauque et forte : « Vous allez mourir.
Présentez-vous devant le tribunal de Dieu... » Détrompé, sans s’émouvoir,
il va aux deux mourants, et recommence brutalement. L’un d’eux, qui passait doucement à cette
voix sauvage se réveille, revint aux réalités ; l’autre écouté avec une
sueur d’effroi... ; puis il part, les laissant aux terreurs de la mort. Pour Pâques, il est venu dans les salles
en uniforme, l’aumusse pendue à l’avant-bras, les hosties dans la poche :
« Qui veut communier ? Qui veut communier ? » Et ce fut
vite fait. » Voici encore une autre scène : « Dans un coin de l’enceinte en fil
de fer barbelé, une petite baraque toute pleine de fous. A tous instants, en
pleine nuit, une contagion terrible les saisit : ce sont alors de grands
cris effrayants – des luttes – la camisole de force... » « Trois cents prisonniers civils
viennent d’arriver – ce sont des Français des régions du Nord. Ils crèvent de
faim. Isolés dans les doubles enceintes de fil de fer. Nous avons toutes les
peines du monde à les ravitailler. L’autorité voudrait trouver parmi eux des
volontaires pour le travail. Ils refusent ; on les trimbale de camps en
camps, espérant que la faim et les vexations les feront réfléchir. Trois vieux,
maigres comme des squelettes, viennent de mourir. Il en est ainsi à chaque
déplacement. Il y a des gamins de dix, douze ans. Ils ont froid. La plupart
sont pitoyables dans de vieux vêtements, autrefois jaquettes ou vestons
confortables. » On emmena beaucoup de prisonniers, civils
et soldats, dans des camps de représailles. Les Allemands prétendaient adopter
cette mesure pour se venger d’un fait dont ils accusaient l’Entente, par
exemple le travail imposé à des prisonniers allemands dans la zone du front. Oui, ils osaient formuler un pareil
reproche ceux qui chassaient des milliers de civils inoffensifs comme des
esclaves jusque dans la ligne de feu. Ils transportèrent même des prisonniers
jusqu’au front russe[1]. Hélas ! Nous ne pouvons donner qu’un
écho affaibli de l’existence atroce menée par nos déportés et les autres
prisonniers en Allemagne. Mais puisque nous traitons ce point
spécial, il nous faut rappeler que nos prisonniers de guerre endurèrent une
misère inouïe. Ils étaient enfermés dans des camps, d’où on les envoyait faire
des travaux de toute espèce, dans les mines, les usines, dans les canaux, les
ports, aux champs, etc. Pour compléter leur alimentation notre
gouvernement leur fit parvenir des biscuits. Il se créa aussi des organismes
spéciaux dans les pays alliés et neutres qui se chargèrent de l’envoi des
colis. Mais il y avait tant d’affamés à soulager et plusieurs pays limitaient
l’exportation des denrées, parce qu’eux-mêmes n’avaient pas de réserves
suffisantes. Beaucoup de prisonniers, se sont évadés de cet
enfer et ont réussi à franchir la frontière suisse ou néerlandaise. D’autres y
ont laissé la vie. Reproduisons seulement un des nombreux faits rapportés par
René Van Voeren dans le « Courrier de l’armée » :
« Lorsque, en août 1914, notre Roi fit appel au patriotisme de ses
enfants, des milliers d’hommes vinrent se ranger sous notre fière bannière.
Parmi eux il y avait beaucoup de religieux et d’ecclésiastiques qui prirent du
service comme brancardiers, infirmiers ou aumôniers. Un grand nombre tombèrent au champ
d’honneur, d’autres furent fait prisonniers et martyrisés ou assassinés dans
des camps de concentration allemands. Parmi ceux qui trouvèrent la mort en
Allemagne se trouvait le R. P. Brouwers, S. J. Quand la guerre éclata, le R. P. Brouwers
était professeur de poésie latine au Collège du Sacré-Cœur à Charleroi. Sans
une minute d’hésitation il obéit à l’impulsion de son cœur de patriote, quitta
son école et ses élèves et prit volontairement du service dans l’armée belge
comme aumônier. Aux termes de la convention internationale
de Genève, qui a été signée également par l’Allemagne, des aumôniers ne peuvent
pas être faits prisonniers et enfermés dans des camps de prisonniers. Nous
savons avec quel respect les Allemands ont observé les conventions
internationales de La Haye et de Genève, qu’ils ont considéré comme un
« chiffon de papier » et déchiré, de même d’ailleurs que le traité de
neutralité de la Belgique. Le R. P. Brouwers fut fait prisonnier par les
Allemands et enfermé au camp d’Osnabrück. Il y fut lâchement assassiné le 23
août 1915 dans les circonstances ci-dessous rapportées, dont la véracité et
l’authenticité sont garantie par un témoin oculaire, le capitaine d’infanterie
français Robert de Versailles, qui en a dressé le récit suivant : « Le R. P. Brouwers, qui avait pris
du service dans l’armée belge comme aumônier, fut enfermé au camp d’Osnabrück
par les Allemands sous l’accusation fausse qu’il avait pris les armes contre l’ennemi.
Dans la nuit de 22 au 23 août 1915 le R. P. Brouwers tenta, en compagnie de
deux officiers russes (le capitaine Schmidt et un lieutenant), de s’évader du
camp. Les trois prisonniers sautèrent, par une fenêtre du rez-de-chaussée de la
caserne. Le R. P. Brouwers et le capitaine Schmidt s’étaient déjà élancés dans
la cour et étaient couchés par terre près du fil barbelé du camp, pour y
attendre leur compagnon. Lorsque celui-ci sauta par la fenêtre, il fut aperçu
par une sentinelle, qui était postée du côté opposé du fil barbelé. Le soldat
tira quatre ou cinq coups de fusil. Au bruit des détonations, les prisonniers
furent éveillés dans la caserne et quelques-uns, dont moi-même, allèrent voir à
la fenêtre ce qui se passait. La sentinelle donna le signal d’alarme et
la garde de camp accourut. Les trois évadés restèrent près du fil barbelé, dans
l’attente de leur sort. Une trentaine de soldats allemands, le
fusil serré dans les deux poings, arrivèrent à la cour et ne tardèrent pas à
apercevoir les prisonniers. Le R. P. Brouwers s’était levé et il fur
aussitôt entouré de soldats. Une violente discussion s’engagea, au cours de
laquelle je ne pus entendre que ces mots : « Nicht !
Nicht ! Après une dispute de deux ou trois minutes, l’un des soldats
saisit tout à coup son fusil et tua le R. P. Brouwers à bout portant. Le corps
resta sur place jusqu’au lendemain, puis il fut transporté au cimetière. Le
commandant du camp, le capitaine Blankenstein, serra la main au soldat-assassin
et le félicita de son « acte héroïque ». Que les Allemands visitent dans leur pays
les cimetières de prisonniers belges. Les nombreux tertres leur parleront
éloquemment de la misère et des souffrances, des tortures et des meurtres qui
ont conduit nos jeunes gens à la tombe. Les croix innombrables étendront vers
eux leurs bras en des gestes de reproche et dans le gémissement du vent, ils
entendront les cris de haine et de vengeance de nos morts. Beaucoup de prisonniers civils et
militaires devinrent malades. Heureusement, on inaugura le système de
l’échange. Un grand nombre de prisonniers de guerre
belges et alliés, internés en Allemagne, dans des camps qui souvent ne
répondaient pas aux exigences les plus élémentaires de l’hygiène et de
l’humanité, virent bientôt dépérir leur santé. Grâce à l’intervention de la
Croix-Rouge de Genève une commission de médecins de pays neutres réussit à
faire envoyer en Suisse quelques centaines de ces prisonniers, choisis parmi
les plus malades et les plus faibles. Le gouvernement suisse mit à leur
disposition des hôtels, des villas et des baraquements dans les parties les
plus saines et les plus pittoresques de ce merveilleux pays, entre autres sur
le lac Leman, à Montreux, à Clarens, etc. Malheureusement les soins les plus
empressés, ne parvinrent pas à vaincre le mal implacable dont un grand nombre
de prisonniers alliés étaient atteints ; ils rendirent le dernier soupir,
loin des leurs, loin de leur patrie. Dans le pieux dessein de rendre hommage à
leurs frères d’armes décédés, deux artistes, le sculpteur Bernard Callie,
ex-interné belge, et le lieutenant interné Castel, architecte français, ont
érigé à la mémoire des soldats des armées alliées, morts dans la région de
Montreux, un superbe monument, qui se dresse dans le cimetière de Clarens. |
© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©