 Médecins de la Grande Guerre
Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Conférences
-
Conférences
-
![]() Articles
Articles
![]() Photos
-
Photos
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
|
Josephine Cloostermans Introduction Le texte qui figure ci-dessous provient d’un document manuscrit déposé au centre de documentation du musée Flanders Fields Museum d’Ypres. Je dois sa connaissance à Annick Vandenbilcke que je remercie ici très chaleureusement. L’auteur de ce texte est une jeune femme du nom de Joséphine Cloostermans qui pendant l’automne et l’hiver de 1914 se dévoua sans compter au profit des habitants d’Ypres soumis à des conditions de vie effroyables en raison des terribles bombardements subis par leur cité. Terrés le plus souvent dans leurs caves, de nombreux Yprois durent affronter la faim, la soif, la maladie mais, ils préférèrent longtemps ces maux à l’abandon de leur ville. Ces habitants durent bien souvent leur survie à de véritables héros qui veillèrent à leur apporter soins médicaux, vaccination contre la typhoïde, fourniture d’eau potable, transports en voitures d’ambulances vers les hôpitaux. Ces mêmes personnes remarquables durent aussi à maintes reprises se transformer en fossoyeurs et pompiers. Nous connaissons les noms de la plupart de ces hommes et femmes. Il s’agit du Curé Delaere, d’une religieuse appelée Sœur Marguerite, de la comtesse Van den Steen de Jehay et d’une importante équipe de Quakers, venus d’Angleterre sous le commandement de Geoffrey Winthrop Young. Ces Quakers avec leur « Friends Ambulance Unit » fournirent médecins, brancardiers et véhicules d’ambulances à la ville assiégée. Ils avaient créé leur propre ambulance (ambulance, durant la guerre 14-18, signifie hôpital et non pas le véhicule d’intervention) dans l’asile du Sacré-Cœur. Les principaux acteurs de cette épopée, Sœur Marguerite, Sir Winthrop Young, la comtesse Van den Steen nous livrèrent des récits poignants que le lecteur retrouvera résumés sur ce site. Les deux premiers auteurs mentionnent, à plusieurs reprises, qu’une jeune fille, appelée Joséphine Cloostermans, leur fut d’une aide précieuse dans les soins portés aux blessés et malades d’Ypres. C’est le manuscrit de cette héroïne que j’ai le plaisir de vous livrer ci-dessous dactylographié par mes soins. On peut regretter qu’il n’ait pas été connu et diffusé plus tôt, lors du centenaire de la Grande Guerre. Joséphine Cloostermans aurait alors bénéficié d’une reconnaissance légitime des Yprois. A cela peut-être une raison, le manuscrit étant rédigé dans un français très difficile à comprendre au premier abord car n’utilisant aucune ponctuation. Avouons-le, j’ai souvent été découragé devant la retranscription de son texte mais ma persévérance a porté ses fruits. Le journal de Joséphine nous révèle en effet une jeune femme assez extraordinaire. Batelière, elle décide en août 14 de quitter sa famille pour aller servir l’armée belge comme soignante. A cet effet, elle prend un engagement à la Croix-Rouge et part sur les routes à la recherche de l’armée. Elle rejoindra d’abord Hannut où elle coopérera avec une ambulance civile fondée par la famille Flammand, ira jusqu’à Liège où malheureusement elle découvrira que la ville est déjà occupée par l’ennemi, retournera à Hannut pour rejoindra Jodoigne puis Tirlemont, ville dans laquelle elle va pouvoir enfin déployer ses grandes qualités d’infirmière improvisée auprès des soldats Belges. Un peu après, on la retrouve à Montigny-le-Tilleul où elle exerce ses talents dans l’ambulance (hôpital) créé pour les soldats français dans le casino. Quand les Allemands s’emparent des blessés pour les envoyer en Allemagne, Joséphine rejoint Anvers et arrive au moment de l’évacuation de la ville par l’armée belge. Entraînée dans cette fuite, elle se retrouve malgré elle en Hollande et parvint à retourner en Belgique dans un convoi de quelques véhicules d’ambulance de l’armée belge autorisées exceptionnellement à retraverser la frontière. Arrivée sur la côte Belge, elle rejoindra ensuite Ypres ou rapidement, elle rencontre le curé Delaere et se fait aussitôt remarquer comme secouriste. Les Sœurs de Marie lui offrent asile dans leur couvent. Le courant entre ces femmes passe bien et Joséphine considérera le couvent dorénavant comme sa maison. Jusqu’au printemps 1915, on retrouve joséphien absolument partout où on a besoin de secours. Elle est sur place rapidement quand une maison est bombardée, donne les premiers soins et s’en va ensuite dans Ypres pour quérir une ambulance chez les quakers qui tiennent l’hôpital du Sacré-Cœur. Les Yprois apprennent rapidement à connaître cette femme qui n’a peur de rien et, de jour comme de nuit, l’on sonne à sa maison (le couvent des Sœurs Lamotte, rue de Lille) pour solliciter son aide. Ses fréquents déplacements pendant les bombardements lui valut d’échapper à la mort de nombreuses fois. Joséphine ne fut pas toujours récompensée de son audace exceptionnelle. Comme on la retrouvait sur place rapidement à chaque catastrophe, une partie de l’opinion publique la suspecta d’être une espionne. N’était-ce pas elle qui, finalement, indiquait les cibles aux Allemands ? Joséphine qui se dévoua corps et âme aura beaucoup de chagrin de ces calomnies qui dureront durant tout son séjour à Ypres. Elle les supportera parce que quakers, gendarmes belges d’Ypres, le curé Delaere riront de ces rumeurs… Avouons-le, Joséphine avait une personnalité hors du commun qui prêtait facilement aux rumeurs. Toujours en pantalon, guêtres et bottines, son accoutrement n’a rien de féminin. Joséphine a de plus un comportement très viril et n’hésite pas à monter des échelles pour atteindre un toit ou évacuer les livres de la bibliothèque des Halles ou encore les statues et cadres d’une église en feu. Dans ses notes, elle avoue toujours posséder un révolver sur elle. La gendarmerie est d’ailleurs au courant et cette arme semble autorisée car l’on sait Joséphine menacée de mort à plusieurs reprises par un déserteur anglais nommé Findley et qui rode dans Ypres, la plupart du temps saoul mais armé d’un fusil. Joséphine se fait souvent accompagner par un autre soldat anglais dans ses missions de secourisme. Il s’agit du soldat Frederick Harding. Ce soldat anglais avait perdu son unité et restera plusieurs mois à Ypres se rendant extrêmement utile comme aide à Joséphine et au curé Delaere. Il fut finalement repris par l’armée anglaise et jugé pour désertion. Joséphine entreprit alors un voyage en France pour le défendre le 19 décembre 1915 devant le Conseil de Guerre qui le jugea. Grâce à son intervention Harding ne fut pas condamné à mort. Que devint Harding après son jugement ? J’ai entrepris une petite recherche et découvert que dans son unité du Kings Royal Rifle corps, un Frederick Harding mourut le 01 août 1915. Son nom figure sur le Menin Gate (Panel 51 and 53). Un autre homonyme est mentionné comme exécuté pour désertion le 29/06/16 et âgé de 21 ans. Il repose au Carnoy Military Cemetery. Il semble en tout cas que la destinée de ce soldat ait été tragique. Sa vie reste à écrire. L’aventure de Joséphine Cloostermans se termina, le 9 mai 1915 au moment où les Anglais obligèrent les derniers habitants d’Ypres à quitter la ville. Que devint-elle ensuite ? La seule indication mentionnée dans ses mémoires nous dit qu’elle rejoignit Rouen où sa famille de bateliers avait trouvé refuge. Sa destinée ultérieure nous est inconnue. Sur la page de garde de ses mémoires est écrite une adresse : Rycquart-Cloostermans,
Ter Heydelaan 40, 2100 Deurne-Centrum.
Tel 24 73 46 Est-ce elle
ou sa fille ? Peut-être un lecteur pourrait-il
compléter la biographie de cette femme belge hors du commun ? Place maintenant aux passionnantes
mémoires de Joséphine. P.S :
Que les lecteurs me pardonnent mais je ne puis garantir l’orthographie exacte
des noms de personne cités par
Joséphine. Dr Loodts Patrick Récit de ma campagne 1914-1915 par 
2 août 1914. Je n’ai plus le courage de rester au bateau. Je prends la résolution de partir dans la Croix-Rouge. Tout le monde me prie de rester mais une volonté et le désir de secourir et soigner nos pauvres soldats est plus fort que leurs prières. 4 août. Je pars de Pommeroeul, disant adieu à tous mes amis. Je prends le train à Mons. Arrivée à Mons, beaucoup de soldats, surtout des chasseurs à cheval, leurs familles en pleurs, s’embarquent sur mon train, surtout des chasseurs à cheval. Leurs familles sont ici, c’est déchirant à voir, ils pleurent, ils crient. Ils parlent déjà du retour prochain. Ils ne se doutent pas les malheureux de ce qui les attende là car ils partent tous plein de courage et d’espoir. J’arrive enfin à Bruxelles et vais de suite au siège de la Croix-Rouge, rue ducale. Là, il y a une foule immense. Un Allemand se présente mais il est mis à la porte et hué par la foule. J’y entre à mon tour et demande à partir immédiatement pour Liège mais on me répond que ce serait très difficile. Je ne perds pas courage. 6 août. Je pars de Bruxelles en train. En cours de route je suis acclamée partout par les soldats. Nous arrivons à Landen et dépassons la gare de quelques kilomètres quand retentit un cri strident. En arrière, les Allemands sont là. Le train fait demi-tour. Tout le monde dit que les Hollandais ont laissé le passage aux Allemands. Nous repartons sur Tirlemont. Les soldats sont heureux de voir une femme parmi eux. Un « piotte » est tout fier d’avoir tué un colonel allemand dont il tient le Dolman sous le bras. D’autres montent dans le train et nous retournons en direction de Hannut. Enfin nous arrivons à Hannut, la nuit tombe et il pleut toujours. Une ambulance de trouve à côté de la gare dans le magasin de grains de Mr et Mme Flammand. 
Hannut : rue de la Gare J’y rentre et tout le monde est heureux de me voir car deux jeunes filles, Mme Flammand et sa sœur sont exténuées. Je me mets immédiatement à la besogne. Il y a deux grands blessés, un lignard qui souffre beaucoup car il a sa jambe droite cassée mais qui est fier d’avoir tué, dit-il, un général allemand, ce qui le console un peu. L’autre est moins grave, une blessure à la tête. Beaucoup revenaient de Liège et sont tristes à voir. Vers 9 heures, une fusillade éclate, c’est une alerte, tout le monde est prêt et moi-même tiens un fusil pour me défendre car c’est toujours l’ambulance qu’ils visent. Il y a plusieurs tués et faits prisonniers dans le cimetière. La nuit s’achève dans un calme relatif. 8 août. Les troupes partent de Hannut vers Jodoigne. Sur la route nous passons au milieu d’un régiment, le 2ème Chasseur. Je vois quelques amis mais pas Gilbert. Nous arrivons dans le Brabant wallon. Tout le monde m’acclame et me fête, m’apporte du vin de des friandises que je partage avec mes petits soldats qui sont très contents. Nous arrivons le soir à St Remy. Avec grand peine, nous avons obtenu, le docteur, l’infirmier et moi, une petite tranche de pain noir avec du lard très gras et un verre de bière mais pas moyen de loger quelque part. Finalement, nous montons en auto et partons à Jodoigne où enfin à minuit nous trouvons un logement : le docteur et l’infirmier dans une maison juste à côté de la mienne. 9 Août. Nous partons au petit jour. On m’a pris pour un espion habillé en femme. Le docteur avait bien du plaisir avec cette histoire. Dans la matinée, nous repartons à Jodoigne où nous allons dans une ambulance et ensuite dans le couvent des Sœurs de la Providence où je vais à la messe. 
Ecole des Sœurs de la Providence à Jodoigne Une trentaine de télégraphistes de la 5ème division viennent manger matin, midi, soir. Avant de partir, ils me demandent un souvenir. Le soir, dans ma cellule, je fais une petite cocarde belge et le lendemain, j’épingle sur les poitrines nos couleurs bien aimées. Après une cordiale poignée de mains, je pars pour Namur par Bruxelles. Je suis dans le compartiment avec plusieurs officiers. Une familiarité règne bientôt entre nous. Je fais leurs tartines, partage leur chocolat. Tout à coup, c’est le départ. La musique joue le chant du départ. Partout on est acclamé. La ville de Bruxelles est superbe, des drapeaux, des guirlandes partout. Vers 4 heures du soir nous arrivons à Namur et la ville est en fête ; ce sont des cris et des chants militaires partout. A peine arrivée dans la rue, on vient me demander mes papiers car on me prend pour une Allemande. Pour être plus tranquille, je vais au bureau militaire pour faire signer mes papiers. Je fais une petite promenade en ville et, le soir, vais loger dans un hôtel près de la gare. Le 10 Août. Je pars de Namur et passe par Bruxelles. Je vais chez cousin et cousine Oefermans et ensuite chez Mr de Brauwer qui me donne tabac, chocolat, sucre et tout de sortes de provisions. Je reprends le train à 13h 00 pour Hannut par Louvain et Tirlemont. Pendant que je suis à la gare, des taubes passent qui sont mis en fuite par la garde civique. Enfin nous partons pour Waremme. Avant d’arriver à Landen, je me penche à la portière pour causer avec le chef de train. Tout-à-coup, une balle siffle à mes oreilles et je me jette en arrière pendant que le chef de train se jette à terre. Le premier effroi passé, je regarde pour me rendre compte ce qui s’est passé. Pas de doute, ce sont les Allemands qui voyant mon voile et ma Croix Rouge sur le bras croyaient avoir une victoire en m’abattant d’une balle. Leur geste qu’ils croyaient être sur et inaperçu fut cependant remarqué et Dieu me protégea. J’arrive à Landen et tous les passagers se pressent autour de moi pour voir si je ne suis pas blessée. Un cri, un seul retentit « Sauve qui peut ». Les Allemands sont là. Je me redresse et dis : « Les lâches, ils tirent de loin. » Je veux les voir de près. Tout le monde se sauve. Je reste seule près de la gare mais ne vois aucun Allemand. Je vais me coucher dans le Couvent des Sœurs de la Charité où je suis conduite par une vingtaine de personnes. Je suis accueillie à bras ouvert et, après un repas réconfortant, je passe une bonne nuit. 11 août. Je pars à pied pour Hannut distant de 25 à 30 km. J’arrive à l’ambulance Flammand où tout le monde est content de me revoir. Le 12 août. Je repars de Hannut. Je vois deux Uhlans sur la route. Deux femmes viennent à moi, me suppliant de ne pas aller plus loin car une vingtaine d’Allemands sont là, plus loin, qui guettent mon arrivée. Je continue ma route. Les soldats sifflent et rient. L’officier me regarde d’un œil mauvais. Je le regarde également d’un regard hautain, alors il me fait un salut correct. A Lens-Saint-Remy, je vois passer 4 chevaux d’officiers allemands. Je veux courir après pour monter en selle mais trop tard. A Tourinne-la-Chaussée, j’apprends qu’on les a conduits au bourgmestre. Une ferme est là et, en voyant une femme de la Croix-Rouge, tout le monde vient me voir et m’offre du vin, des gâteaux. Une pauvre femme me supplie de rechercher son fils dans les ambulances. J’arrive à Hollogne puis à Limont. Des habitants me font prendre du lait qu’ils vont traire exprès pour moi. J’arrive ensuite à Jeneffe, Momalle, Voroux. Je commence à être fatiguée car voilà déjà 39 kms que je marche et il m’en reste encore 20 à faire. Je me repose un peu tout en causant, bien entendu, de la guerre, avec un conseiller municipal. J’arrive ensuite à Bierset. Je vois Liège devant et entend les canons des forts qui grondent sourdement. Je passe à côté du fort de Hollogne. Quelques soldats montent la garde. Ils sont fatigués mais toujours courageux. Je leur donne quelques cigares et du chocolat. Je continue toujours ma route car j’ai toujours l’intention d’arriver à joindre l’armée belge. Hélas, quelle chimère j’ai fondée ! A l’entrée de la ville, je vois vingt soldats allemands en train de faire une énorme tranchée à l’entrée de la rue Marguerite. 
Liège : rue Ste-Marguerite Je suis tout hébétée car j’ignore complètement qu’il y avait déjà des troupes allemandes à Liège. Plus je rentre en ville, plus j’en vois ; cette fois je suis découragée. Je vais ensuite dans plusieurs ambulances mais je ne connais personne et les Allemands sont les maîtres partout. Tristement, je me mets à la recherche d’un hôtel où loger et j’en trouve un près du pont Léopold « Hôtel de la ville de Namur ». Je vais aussi sur quelques bateaux qui servent de pont pour le passage des troupes allemandes. Le soir, je dîne mais n’ai guère d’appétit. Bientôt des soldats allemands entrent dans le café ; l’un me regarde d’un air moqueur car il se met à rire en voyant mon brassard de la Croix-Rouge. « Vous le portez, dit-il, parce que vous avez peur ». Je rougis de colère et d’un coup brusque j’arrache mon brassard et le met dans une poche. Quelques instants après, d’autres arrivent, il y en a un qui m’offre un verre de liqueur. Je comprends parfaitement ce qu’il me demande « en allemand » mais je fais semblant de rien. Une personne qui parle allemand est là, le soldat l’appelle. « Veuillez, dit-il, demander à Mademoiselle de prendre un verre avec moi. » Je lui réponds « non ». Cette personne qui tient plutôt du côté germanophile me prie d’accepter pour lui faire plaisir. « Jamais, que je réponds, je ne ferai plaisir à un allemand s’il n’est pas blessé. » Mais alors le Prussien se fâche et cherche querelle envers moi mais un autre soldat à qui je n’avais pas fait attention et qui a tout entendu, répond dans un français des plus correct : « Mlle a raison ». Grâce à lui, j’échappe encore une fois à la brutalité d’un monstre allemand. Je me couche ensuite bien fatiguées et troublée après une journée mouvementée pour moi. 14 aout. Je veux quitter la ville, quelques soldats belges qui sont dans une ambulance des Sœurs françaises, me conseillent de ne pas chercher à le faire mais personne ne peut quitter la ville. Je cherche quand même à passer de Liège à Ans. Les rues sont encombrées de soldats boches. Je suis énervée et serre les dents. J’arrive jusqu’à la sortie de Ans. La rue est barricadée de matériaux, de voitures, en fin de tout ce que l’on peut imaginer. Je me dirige vers ce mont peut agréable lorsqu’une voix terrible me crie « Ou allez-vous ? » Sans perdre mon sang, je réponds tranquillement que je cherche après des blessés et il me répond : « Il
n’y a pas te blessés par-là, fenez avec
moi joué
poures parties de Liège. » Il appelle un major qui me demande : « Qui êtes-vous ? – Je suis une ambulancière belge et je cherche et soigne des blessés, dis-je en montrant mes papiers. – D’où êtes-vous venue depuis hier ? dit-il. – D’Hannut. – Ce n’est pas vrai me répondit-il brusquement. » Je réponds de même et il dit à son inférieur : « Emmène cette femme ». Je pense en moi-même que je suis pincée. J’entre dans une maison, trois officiers s’élancent vers moi et me prennent ma valise. Je veux la reprendre mais le major me repousse sans me répondre. Je les vois la tête en feu, la rage au cœur et ils me font rentrer dans une autre maison où se trouve déjà une femme à qui je demande ce qu’ils vont faire de moi. Elle me répond : « C’est la guerre Madame. – Je lui réponds : Ça ne veut rien dire, pourquoi m’ont-ils fait rentrer ici ? – Pour voir si vous êtes un homme ou une femme me dit-elle pendant que je mords sur mes dents à les briser. – Faites-moi voir la poitrine dit-il à la femme. » Je me sens rougir sous leurs regards. « C’est bien », dit-il, et il m’emmène à l’autre maison où je trouve ma valise renversée sur le plancher. Ils se moquent parce qu’il y a des dentelles à mon linge, du chocolat et du tabac. Un oberlieutenant me tend ma valise. « Voilà madame, me dit-il, c’est triste pour vous de ne pas trouver ce que vous cherchez. » Je me croyais sauvée en sortant et me dirige de suite vers la sortie d’Ans. « Non Madame, me dit le major, suivez ces messieurs. » Un soldat et un gradé montent à cheval, ils ont ordre de me conduire à la Kommandantur. Ils veulent prendre le trot à leurs montures mais faisant semblant de rien je prends un pas de promenade. Alors ils s’arrêtent et le gradé me questionne, pensant que les passants regardent : « Vous êtes fatiguée Madame, donnez-moi votre valise, le soldat va la porter ! » Nous voilà partis tous les trois. Enfin, après une demi-heure de marche nous arrivons et je suis introduite dans le bureau du commandant de la place qui commence à poser un tas de questions pour finalement me dire de revenir dans deux jours. Le 16 Août. Je retourne à la Kommandantur et le chef me répond « impossible, restez à Liège ». Ma résolution est prise et je passe par Sclessin, Seraing, Ougrée, Jemeppe. En arrivant à Flémalle, le fort vient de s’être rendu et je vois nos pauvres soldats sales, couverts de poussière ; ils m’arrachent les larmes des yeux. Un soldat allemand en voyant mes larmes se met à rire. Je refoule mes larmes et lui dit : « Lâche, vous pouvez être fier, il n’y a pas de doute de gagner quand on est vingt contre dix. » Il pâlit de rage sous l’affront, baise la tête et part. Je continue ma route avec l’idée d’échapper au plus vite à ces barbares. A Jemeppe, il y a une grande tranchée faite dans la rue, ils sont en train de la remplir. Un officier me demande si je pourrai passer. Je lui réponds à peine tellement je suis contente et saute dedans. A peine passée, un soldat s’élance vers moi : « On ne passe pas Madame. » Je pense que je suis perdue mais me ressaisis aussitôt et lui dit d’un air hautain : « Est-ce de simples soldats où les officiers qui commandent l’armée allemande ? » En m’entendant parler si franchement, il me dit l’air penaud : « Passez madame ! » Décrire ma joie est impossible, je pars immédiatement au pas de gymnastique, entre dans un petit sentier et par là gagne la côte. Je veux partir à nouveau pour Hannut. J’atteins Haneffe à pied à bout de force, me rend chez le bourgmestre et y trouve refuge jusqu’au lendemain. 17 août. Je repars pour Hannut distant de 39 km. J’y arrive vers 3 heures du soir. Toute la journée, le long de la route en passant par Celles, Lens Saint-Remy toujours ces maudits boches…. J’arrive dans la famille Flammand. Tout le monde est désolé car les Allemands ont tout emporté. 18 août. Vers midi, le docteur de la commune vient et dit que ceux qui ont une ambulance doivent rejoindre le champ de bataille. « Vivement, je réponds. – Restez Madame Flammand, je suis votre ambulance et c’est à moi d’y aller. Rajoutais-je ». Le docteur me félicite et me donne quelques conseils et je pars. Arrivée à Opheylissen, c’est rempli de troupes allemandes et mes inquiétudes me reprennent car je crains toujours d’être arrêtée. Je parviens quand même à passer sur la route. Plusieurs maisons sont brûlées par les Allemands. Tout à coup, j’entends le canon du côté de Tirlemont. Quelques kms plus loin, je vois que la ville est incendiée et une sentinelle me dit : « N’allez pas par-là, Fraulein, c’est trop dangereux ! – Je lui réponds : je n’ai pas peur. » Tout à coup je vois tout un régiment d’Allemands qui bat en retraite et suis encerclée entre deux feux. Les Belges à ma droite, les Allemands à ma gauche. Les Belges du 9ème de ligne font marcher leurs mitrailleuses sans relâche et les balles tombent tout autour de moi. J’arrive à la première maison qui fait un carrefour et j’entre. Un soldat entre aussi, il a le pied droit traversé par une balle. Je lui fais vivement un pansement quand, tout d’un coup, les habitants crient « Sauve qui peut », « les Allemands sont là ». Ils se sauvent et m’abandonnent avec mon blessé. Je l’emporte dans l’arrière-cuisine et le met dans un coin. Je me place devant lui en faisant le serment qu’ils n’y toucheront pas sans m’avoir tuée. Au même instant, ils entrent dans la maison, poussant des cris et des hourras comme des sauvages. Le soldat me dit : « ils sont là. » Je pense en moi-même que nous sommes perdus tous les deux. « Taisez-vous », lui dis-je. Je joins les mains en disant « Mon Dieu, St Antoine, protégez cette maison. Sauvez ce pauvre soldat. » Comme par miracle, ils sortent tous ; je me sens soulagée d’un poids énorme. Je me déchausse et fait vivement le tour de la maison. Voyant qu’ils étaient tous partis, je me rechausse et court vivement à l’hôpital. Je vois avec surprise que la maison d’en face avait été complètement saccagée. Je pars ensuite sur le champ de bataille. Je place les blessés sur une brouette, sur des planches, sur des échelles. Je sépare les morts des blessés. J’arrive près d’un blessé qui me dit : « Comme vous êtes courageuse madame, mais je vous en prie, laissez-moi et prenez mon camarade. – Non, lui dis-je, vous d’abord, votre camarade après. » Le malheureux a reçu sept balles et s’appelle Pierre Fournier, natif de Marcinelle. Je regarde le corps couché à côté de lui. « Celui-là, Madame, est mort. Il avait reçu une balle mais un hulan voyant qu’il vivait encore l’a achevé d’un coup de lance. Tout à coup, une balle siffle à mes oreilles. « Vite, vite, Madame, couchez-vous ! On tire. » Alors je me redresse, croisant les bras sur la poitrine. J’attends la mort sans crainte. Encore deux balles, puis c’est le silence de la mort. Je conduis environ 20 blessés à l’hôpital St-Jean. Vers 8 heures du soir, je suis seule en plein champs au milieu des cadavres. J’entends les râles des mourants le bruit sourd des canons, le tic-tac ininterrompu des mitrailleuses. Toute la ville est ( … illisible). Partout des pleurs et des cris et, chose que je verrai et me souviendrai toujours, les Allemands défilant dans la ville au son d’une musique retentissante. Quand tous les blessés sont enlevés, je vais vers une petite colline qui se trouve à 900 mètres car les brancardiers m’ont dit qu’il s’y trouvait deux soldats belges blessés. Là-bas, un monsieur qui avait jusque-là plutôt un peu peur veut m’accompagner. Nous partons, une lanterne à la main. Ah, comme c’était lugubre ! A peine deux cents mètres parcourues qu’une voix forte nous crie « Werda ». Mon compagnon et moi répondons « Red Cruz » « (Croix-Rouge) ». Nous devons avancer les bras en l’air. Un officier se lance vers moi et me met un révolver dans la gorge pendant qu’un autre fait la même chose à mon compagnon. Voyant que nous ne résistons pas, ils remettent leur révolver dans l’étui et nous fouillent pendant qu’une dizaine d’autres épaulent leurs fusils dans notre direction. Après cela, ils nous disent qu’il n’y a plus de blessés et que nous pouvons rentrer tranquillement chez nous. Quelques instants après nous sommes à nouveau arrêtés mais n’étant que deux, ils sont moins francs. Je rentre à l’hôpital, exténuée, à bout de forces. Les bonnes sœurs et l’aumônier militaire qui se trouve là, me force à manger un peu mais je n’ai guère d’appétit. Ils me conduisent dans le fond de l’hôpital. Pendant la nuit, nous entendons quelques balles siffler. 
Artillerie belge quittant Tirlemont en flammes 19 août. Je me lève à 9 heures, déjeune et vers six heures je suis déjà sur le champ de bataille. Je monte sur le remblai du chemin de fer. Quelques soldats prussiens sont en train de fouiller les sacs des soldats belges. L’un deux m’arrête. Je lui dis que je cherche des blessés. Il me salue et me laisse tranquille. Je suis en train d’examiner l’horizon lorsque tout à coup je vis une ferme et un linge blanc qu’on agite. Je me dirige vers la maison. Le passage est difficile, c’est tout ronces et épines et un ruisseau de deux mètres de large me sépare du jardin. Mais comme dans mon métier de batelière, il faut être forte, je ne fis qu’un bond pour y être non sans avoir un peu déchiré ma blouse. L’on me dit alors qu’il y a un soldat blessé chez un de leur voisin. Je m’y rendis aussitôt. Je vis en effet un pauvre petit soldat du 3ème de Ligne couché et trempé dans son sang. J’eus comme un éblouissement en voyant tout ce sang mais cela ne dura qu’un instant. Je me mis aussitôt à faire un pansement et aussi à trouver le moyen de le faire transporter à l’hôpital. Je trouve une petite échelle du grenier avec un peu de paille et un oreiller que ces braves gens veuillent bien me donner. Je fis un brancard et aidée d’un homme de bonne volonté, nous le portâmes à l’hôpital. A peine revenu, j’apprends qu’il y a encore 90 blessés. J’en trouve deux grièvement blessés. L’un réclame sa mère et l’autre sa femme ! C’est triste à entendre et de les voir souffrir. Après les avoir conduits à l’hôpital, je retourne sur le champ de bataille lorsque tout à coup, je vois un soldat arriver, le coude appuyé sur une botte de paille et le menton dans la main. Je me dirige vers lui le croyant blessé mais hélas, il est mort ! Des paysans me voient et me font signe. Dans une maison, tout près, j’y trouve un autre soldat blessé qui n’était pas dans un état très grave mais qui avait échappé à une patrouille d’Hulans en faisant le mort. Après avoir donné quelques soins un peu partout, je rentre à l’hôpital pour dîner. A trois heures, je fais un petit tour dans les salles qui sont maintenant combles. Un petit caporal que j’avais trouvé la veille se meurt. Cela me fait beaucoup de peines au point que je dois sortir de la salle. Après avoir fait quelques prières avec les Sœurs, j’entre dans une autre salle où se trouvent un capitaine et un lieutenant du 3ème de Ligne qui m’ont vu, hier, arriver sur la route en pleine bataille. Le capitaine ne peut croire de ses yeux que je ne sois pas blessée. « J’ai tremblé pour vous dit-il, car je vous voyais toujours tomber. – Que voulez-vous, Monsieur, j’ai un bon ange gardien. – Ils m’ont cassé la jambe » dit le capitaine, et moi le bras », dit le lieutenant. – Nous nous arrangeons, rajouta le capitaine, lui m’apporte le tabac et moi je lui roule ses cigarettes. » J’arrange un peu leurs lits et leur fait quelques petites commissions. Après cela, je repars pour faire une tournée du côté opposé à celui que j’avais fait la veille mais cela m’est plus pénible encore car alors je ne vois plus que des morts. Je parviens quand même à trouver deux blessés dans une usine. Deux autres soldats blessés avaient été jetés dans la rivière ; l’un mourut mais l’autre eut le bonheur d’être retiré vivant par des braves habitants de Tirlemont. L’on commence aussi à enterrer quelques cadavres. La garde civique et quelques personnes de bonne volonté m’aident. Je dis une prière sur chaque tombe avant qu’elle se referme à jamais sur le corps de chaque héros tombé pour le droit et la liberté. 
Tirlemont : Souvenir de l’inauguration du monument des Combattants le 27 mai 1923 Vers 6 heures du soir je regagne l’hôpital, je fais plusieurs lettres pour les familles des blessés. Le 20 août, je quitte Tirlemont après avoir souhaité bonne chance et bon courage à mes chers blessés. La route de Louvain est encombrée de voitures et d’Allemands. J’avais fait quelques kms quand un soldat allemand vient vers moi et, la figure triste et plaintive, me dit « Fraulein, aub Wasser ». Je lui tends ma gourde qu’il vide presque d’un seul trait. Je suis donc privée de boissons car jamais je ne voudrai boire après un boche, si bon soit-il. A Kumtich, plusieurs maisons sont brûlées et les champs ravagés et l’on voit partout des cadavres dont certains sont des civils. On voit aussi des bicyclettes, des sacs de soldats, des fusils. C’est pénible car tout cela est belge. A Korbeekloo, je tombe sur un régiment allemand dont le major se met à crier : « De l’eau, je veux de l’eau pour les hommes ». Tout le monde a peur surtout que les Boches parlent en français, langue que les pauvres gens ne comprennent pas. Je leur explique ce qu’ils veulent et, alors, les gens placent des cuvettes le long des trottoirs pour que ces messieurs puissent boire en passant. Les braves paysans me remercient avant de partir pour Roosbeek. Le Régiment allemand est alors en repos et le major s’avança vers moi et me demanda si j’allais à Louvain. Je répondis oui et il me dit : « C’est rempli de soldats, vous n’avez pas peur ? ». Je lui réponds : « Ils ne me mangeront pas, je l’espère ». A cette répartie, il se mit à rire et dit : « Ça, c’est bien ! » J’arrive enfin à Louvain, mes jambes sont raides et mes pieds me font mal. J’entre dans un café et demande une chambre. J’y prends aussi un bain qui me fait beaucoup de bien. Après avoir mangé un peu, je me rends à l’hôpital militaire, là où se trouvent quelques blessés belges mais assez bien d’Allemands. Je fais la garde de nuit avec une bonne sœur et une demoiselle de Louvain. Les infirmières y sont nombreuses et très gentilles avec moi mais comme il n’y a pas beaucoup de besogne, l’envie me prend de quitter Louvain et de rechercher un peu plus de travail. Le 21 août. Je quitte Louvain vers 3h00 de l’après-midi. Le temps est beau mais il me reste 23 km pour être à Bruxelles. Je fis environ 10 km lorsqu’une voiture allemande arrive au trot ainsi qu’un officier à cheval. Ce dernier s’arrêta et me dit froidement : « Vous allez à Bruxelles ? – Oui répondis-je. – Montez en voiture dit-il. » Je monte ; partout les gens me regardent avec pitié car ils pensent que je suis prisonnière. D’abord c’est le silence complet entre le conducteur et moi. Cependant son orgueil primant tout, il me dit brusquement : « Maintenant que nous sommes en Belgique, nous n’y feront plus aucun mal (…) mais par contre, nous allons démolir la France et écraser l’Angleterre. » Le canard me parut trop grand et je me mis à rire de bon cœur. Voyant que je ne voulais pas le croire, il se mit à rire aussi en disant : « Jaja, alles kaput ? » Nous arrivons à Evere. Les voitures s’arrêtent et se placent derrière les autres. J’en descends vivement car je n’ai pas le cœur d’entrer dans ma chère ville de Bruxelles sur une voiture boche. Les Bruxellois ont l’air triste et plutôt méchant car beaucoup parlent déjà de leur faire payer cher plus tard le mal qu’ils nous font. Je vais chez mon cousin Hefermans et loge chez la famille Kidembergs. Le 22 Août. Je vais dîner chez cousin et cousine. J’ai l’intention de rester quelques jours à Bruxelles mais l’on raconte qu’une terrible bataille se déroule à Waterloo entre Belges, Français, Anglais et Boches. Cela me rend du courage et vivement, je parts pour là-bas car alors, je ne suis plus fatiguée du tout. Après quelques petits achats, je quitte Bruxelles. Je prends le tram jusqu’au Vert Chasseur mais arrivée à Veele, il y a des troupes allemandes et le tram ne va pas plus loin. Je repars à pieds. Je rencontre des vieillards, des femmes avec leurs enfants, tous, des réfugiés venant de Charleroi. Ils me disent : « Madame, Madame, c’est terrible. N’allez pas là-bas car toute la ville est en feu. » J’arrive enfin à Waterloo ou il n’y a aucun soldat. Le lion seul garde la grande plaine. Je passe à l’auberge de la « Belle Alliance » où fut signé le traité avec Napoléon. J’entre et prends un verre de lait qui me remet un peu. Je fais encore quelques kilomètres mais la nuit commence à tomber. 
1914… En observation sur le champ de bataille de Waterloo J’arrive alors à Plancenoit. J’entre dans une maison et demande pour loger. Tout le monde se défie de moi et, moi, qui jusqu’alors n’avait pas encore pleuré, je sens mes yeux s’emplir de larmes. Hélas, elles ne devaient pas être les dernières ! Voyant cela les braves gens me dirent : « Ne pleurez pas, Madame. Nous voyons maintenant à qui nous avons à faire. La botte de paille que vous avez demandée, nous la refusons mais vous allez avoir la chambre de nos enfants. » Je passe une bonne nuit malgré les émotions. Le dimanche 23 août. Après un petit déjeuner, je pars de Plancenoit. Le temps est triste et il a plu assez fort ce qui rend le chemin difficile surtout du côté de Glabais. A Mellet, je tombe à nouveau parmi les Boches et il pleut toujours. J’ai même très froid et quelques officiers sont en train de déboucher des bouteilles de liqueur. Ils me disent alors avec un fort accent : « Chère Madame, fous mériter sa aussi, brenez un petit verre avec nous ». Je fis non de la tête en passant mais un autre s’élance vers moi et me dit : « je fous brie Madam.» Enfin pour être quitte, j’accepte et je dois avouer que cela me fit du bien. J’arrive ensuite à Gosselies. J’y mange deux tartines et boit un verre de limonade. Le village est rempli de soldats mais ils sont raisonnables. Je vais ensuite à Lodelinsart ou beaucoup de maisons ont été incendiées. 
Lodelinsart J’y rencontre aussi un homme qui, la veille, a été pris en otage comme d’autres et attaché aux murs de la maison pendant que les soldats volaient bétail et chevaux. J’arrive à Jumet et là, c’est un désastre complet, toutes les maisons sont brûlées jusqu’à Charleroi. Aucune n’est restée intacte. Je me dirige vers les boulevards. La ville haute est presque complètement incendiée. La gare dans le même état. Là, le boulevard Orban est en ruines et l’on n’y voit qu’une fumée noirâtre. J’entre dans l’école des estropiés. 
Charleroi : Ecole provinciale et ateliers pour estropiés et accidentés du travail Là il y a quelques civils blessés. Ils furent arrêtés par les Boches qui les firent marcher devant eux pour les protéger. Ils furent donc blessés par la lâcheté des Boches. Les Français ont assez bien hésité avant de tirer mais ils y furent contraints et ce fut terrible. C’était encore un exploit de la « Kulture » boche. Je passe la nuit dans l’école et le lendemain 24 août. Je pars vers Montignies par Marchienne. Là, la gare, le bureau de poste, la place, tout cela n’est plus que ruines. Les Allemands, avec leurs petites pièces, s’étaient amusés à tirer. Un peu plus loin, il y a un château superbe appartenant au directeur des usines de Monceau. Il y a là plusieurs blessés français. Le Monsieur et la Dame sont très gentils et me font déjeuner avec eux. Ils me font même accompagner par leur employé jusqu’à la route de Montigny-le-Tilleul. J’arrive au lieu-dit « La Chapelle ». 
Montigny-le-Tilleul : la Chapelle Une auto allemande s’arrête et un capitaine en descend et me dit : « Vous êtes brave pour faire ce que vous fit, Madame, car c’est terrible la guerre et l’artillerie française a fait beaucoup de pertes dans nos régiments car nous avons 25.000 hommes hors de combat. » Pendant ce temps, une pauvre vieille femme, les mains jointes, me dit en pleurant : « Madame, je vois que, si bonne, vous pouvez demander au Monsieur que les soldats ne nous fassent plus de mal. » Je donnerais tout ce que j’ai pour elle, car elle dit cela avec une voix si touchante que le capitaine même en a les larmes aux yeux. Alors ce dernier me répondit d’une voix que l’émotion faisait trembler : « Rentrez chez vous Madame, laisser votre porte ouverte et si les soldats viennent vous demander quelque chose, si vous pouvez la donner, alors donnez car ce n’est pas non plus de leurs fautes s’ils se battent. » Arrive alors un homme qui ne fait que porter des blessés depuis deux jours et qui ne sait plus où se trouvent sa femme et sa fille. Il me dit en patois : « Venez avec moi à Montigny, c’est rempli de blessés. Il y a en effet beaucoup de blessés allemands et aussi 15 Français du 119ème de Cavalerie (Seine). Ils sont tous heureux car pour leur faire plaisir sans qu’ils le sachent, je leur ai dit que je suis française. Alors, ils me disent : « Madame, les Belges sont bien gentils mais nous sommes quand même plus heureux d’avoir une Française parmi nous. » Les blessés français sont placés dans la salle de fête du casino et les Allemands dans la grande buvette, en bas. Après avoir fait quelques pansements, j’accompagne le chef de service sur le champ de bataille et nous y travaillons jusqu’à 8 heures du soir. Jamais je n’ai vu un spectacle aussi horrible : des blessés et des morts par centaines, pêle-mêle à droite et à gauche. Partout je ne vois que du sang et n’entend que des plaintes et des râles. Certaines blessures sont affreuses à voir car presque tous sont blessés par des éclats d’obus. Un petit caporal du 27ème qui avait la moitié de la figure enlevée, entendant que les Allemands veulent lui faire son pansement leur dit tout en colère : « Foutez moi la paix, voilà assez longtemps que vous m’embêtez. » Et les Allemands vinrent vers moi et me dirent : « Madame vous le ferré car il ne veut ba de nous ! » Je m’approche de lui et lui dis : « Et bien mon ami, vous ne voulez pas vous laisser panser ? – Si Madame, par vous mais pas par eux ! » La blessure est affreuse à voir. Le major boche dit quand même : « Terrible la guerre, terrible de voir ces malheureux. » En voyant que je regardais tristement dans mon sac à pansements vide, il me fit donner par ses brancardiers le nécessaire et même leur lampe électrique. M’avançant toujours, j’entends une voix plaintive qui m’appelle : « Madame, je vous prie, soulagez moi, je souffre tant ! » Nous parvenons à le trouver, couché sur le ventre car il a le bas des reins ouverts et c’est une plaie affreuse. Je me baisse pour faire son pansement, je me mets à genoux et alors une odeur me prend à la gorge. Le chef se mit à fumer la pipe et boire une gorgée de vin. Je sentis mon cœur battre et prête à défaillir. Je sens mes forces qui m’abandonnent et alors j’adresse une muette et fervente prière : « Mon Dieu, Saint Antoine, donnez-moi la force de soulager ce malheureux ou sans cela, faites- moi partir d’un seul coup de ce triste endroit. » Enfin le pansement est fini et je ressens un grand soulagement d’avoir reçu les forces nécessaires. Mais ce n’était que le commencement car j’ai vu encore pire en arrivant à l’ambulance. Il est 2 heures passées et je fais la garde de nuit avec deux autres personnes. Le 25 août au matin, après avoir fait les pansements de 15 blessés français, je repars sur le champ de bataille, cette fois avec une petite charrette et le père du chef de service m’accompagne. Il y a toujours beaucoup de blessés. Des braves gens nous accompagnent également avec plusieurs seaux de lait et de l’eau. Ils en donnent un peu à tous. Je fais les pansements de tous les français car je ne sens pas le courage de faire ceux des boches. Je vois un allemand qui pleure à chaudes larmes. Sa figure est noire de poussières et il est couché en plein soleil ne sachant pas bouger car blessé aux jambes et aux bras. Bien malgré moi, je prends mon mouchoir de poche et un gobelet d’eau et lui lave la figure. Il me prend la main et la serre à me la briser en disant « Dank, Dank, fraulein ». Un peu plus loin, je sens mon cœur se serrer, un soldat français a tout le bas de la figure enlevé. La blessure est terrible à voir. Deux Sœurs viennent également d’arriver et nous nous aidons mutuellement car cela n’est pas facile : des vers sortaient de la plaie… Ah que c’est triste… Enfin, nous avons fini, alors Monsieur Lenoir me demande de l’accompagner plus loin sur le champ de bataille. En traversant la forêt, l’on sent une odeur de cadavre. En effet, des soldats allemands sont à peine enterrés sous terre. Au carrefour, nous voyons ensuite un cheval d’officier boche. J’appris quelques temps après que son maître, un capitaine a été enterré avec sept de ses hommes car ils avaient été tous touchés par un 75 français au moment même où ils plaçaient une de leurs pièces. Plus loin, on ne voyait que des fusils, de sacs, des tombes, enfin un vrai désastre. Nous trouvons aussi deux grandes tombes dans lesquelles ont été enterrés des soldats français. C’est une ancienne tranchée et l’on a marqué en allemand : « Hier rustte 94 Franzosein » mais nous apprenons par des civils que les boches regrettant qu’il n’y en avait pas assez, ont doublé, voire triplé le nombre de morts. Nous entendons plusieurs fois des fusillades. Nous sommes enfin presque de retour mourant de soif et bien fatigués car nous venons de faire environ 20 km. Je refais tous les pansements et vers 8 heures du soir, je vais me coucher. 26 août. Je me réveille, il est presque 8 heures. J’ai un peu honte de ma paresse et tout le monde rit de me voir contrariée. Je le fus encore plus quand le chef de service vint me voir pour me demander de faire les pansements dans la salle du bas, chez les blessés boches ! Je m’exclamai : « Oh, Monsieur Lebrun ! – N’oubliez pas que l’insigne que vous portez vous oblige à soigner les blessés des deux camps me dit-il.» Je descends donc et entre dans la salle où on me crie « Bonjour Mamezeel, guten tag Fraulein… » L’un m’offre du champagne, un autre du chocolat en me disant : « Prenez, c’est pour vous. » J’accepte le tout et après avoir fait leurs pansements, je l’emporte et le donne à mes petits Français. L’un me dit : Mlle Josette, si les Boches ne sentent pas bon, je vous assure qu’ils ont du bon chocolat ». Et toute la salle approuve. Leur amitié et leur respect font vraiment plaisir et malgré la triste vie que je mène depuis le début de la campagne, je me sens heureuse car pour tous j’ai été leur sœur. Joyeusement, ils me parlent de leur retour prochain au pays car personne à ce moment ne pouvait penser que cela allait durer des années. Quelques jours après, quelques blessés allemands viennent rendre visite aux blessés français. Ils leur apportent des cigarettes, du champagne et il y a en a un qui sait bien jouer du piano. Après Wach an Rhein et leur Vaterlant, les soldats français dirent : « Vous avez chanté les vôtres, nous allons chanter les nôtres « et tous entamèrent la Marseillaise et puis la Brabançonne. » (…) Le 2 septembre. Il y a un va et vient dans nos ambulances et j’ai le pressentiment que quelque chose va nous arriver. Je n’ose rien dire aux blessés mais une petite infirmière voit que j’ai pleuré et demande toute triste pourquoi : « Mademoiselle, je pense que l’on va nous enlever nos blessés pour les conduire en Allemagne ». Mes pressentiments ne m’ont pas trompée. Dans l’après-midi, un Hauptmann arrive avec un sergent-major et demande le nom et l’adresse de chaque famille des blessés. Je demande pourquoi ils font cela et l’officier me répond qu’ils sont tous prisonniers. A cette réponse, je sens mon cœur battre bien fort et tous nous avons les larmes aux yeux. Je dis à mes protégés : » Je vais faire mon possible pour vous accompagner là-bas ». J’ai alors demandé la permission à la Kommandantur pour rester près de mes blessés mais l’officier se mit à rire et dit ; « Tiens, vous n’avez pas peur des Allemands au point que vous voudriez aller chez nous ? » Je ne réponds pas, alors il me dit : « vous êtes brave mais vous ne pouvez pas y aller. Là-bas, nous aussi avons des bonnes infirmières et vos hommes seront bien soignés comme vous soignez bien les nôtres ». Voyant tous mes efforts inutiles, je repars tristement. 3 septembre. A 3h 00 de l’après-midi, on vient nous dire de nous préparer car les voitures arrivent. Chaque auto emmène 3 Français et trois Allemands et au bout de 7 heures, tous sont partis. Les derniers Français à partir sont André Marrasin de Tarbes et l’autre Albert Levointurier de Lahay Malher. Alors je me sens bien seule et triste dans cette grande salle si gaie encore la veille. La mère du chef de service vint me chercher pour rester quelques jours près d’elle. Le canon des côtes de Maubeuge ne cesse de tonner et nous avons toujours l’espoir de revoir les Français mais hélas, ce fut vain car le lendemain, on n’entendait plus de bruit et on apprit que Maubeuge venait de capituler. Alors, je n’ai plus eu le courage de rester à Montigny et malgré les prières de Mme Lebrun, je partis le 15 septembre après avoir dit un au revoir et à bientôt à tous. Arrivé à Charleroi, j’apprends qu’une voiture part pour Braine L’Alleud. Nous passons par Lodelinsart. A Jumet, une odeur de viande pourrie nous prend à la gorge. C’étaient des cadavres de bétail qui avaient été brûlées dans leur écurie. A Thiméon, l’on fait une petite halte pour se restaurer un peu. Parmi mes compagnons de route se trouvait une famille surprise par la guerre alors qu’ils étaient en vacances. Ils avaient été obligés de vivre en pleine forêt n’ayant pour toute nourriture que des pommes de terre et des betteraves. Nous arrivons enfin à Nivelles où nous prenons le tram pour Bruxelles à Waterloo. Trois autres voyageurs montent. Avec dépit, nous voyons des Allemands qui nous regardent d’un air moqueur, ce qui nous déplait beaucoup. En passant au bois de la Cambre, nous entrons chez Moeder Lambic. 
Bruxelles, bois de la Cambre Cela me rappelle mon enfance quand le dimanche, nous y allions tous en famille faire des parties de plaisir. Bientôt tout le monde se sépare et je prends le tram pour aller dans la famille Kaembergs qui sont très étonnés de me revoir. Ils sont tous contents. Je vais revoir Mr et Mme Le Brouwer ou j’ai la surprise de voir leur frère avec toute sa famille. Ils pleurent tous à chaudes larmes car leurs bateaux ont été incendiés avec tous leur mobilier. Je reste quelques jours à Bruxelles, à seul fin de quitter la ville. 20 septembre. Je parviens à le faire en me cachant dans une voiture qui part à Ninove mais là, il y a beaucoup de patrouilles ennemies. Avant d’entrer en ville, une longue auto grise me dépasse dans laquelle se trouve six officiers. Je suis un peu inquiète. Pourvu, me dis-je qu’ils ne me demandent pas mes papiers. Mais ils vont directement à la gare pour donner l’ordre de ne pas laisser partir le train pour Gand. Après avoir examiné toutes les personnes se trouvant dans la salle d’attente, ils donnent quand même la permission. J’ai été me cacher dans une petite maison et bientôt j’apprends qu’ils sont partis. Je sors alors de ma cachette et me rends à la gare pour prendre le train. Quand il s’éloigne de la gare, un grand soulagement se fait en moi. Nous arrivons enfin à Melle mis aussi loin que je puisse voir, il y a des soldats. Je m’en approche et en voyant que ce sont des Belges, je pousse des cris : « Ce sont des Belges, ce sont des Belges ! » tout le monde me regarde et un monsieur amusé de ma surprise me dit : » Madame, je vois que vous êtes étonnée ». Je répondis : « je l’avoue franchement, Monsieur, je croyais qu'il n’y en avait plus ». A Gand tout le monde descend, il me semble que je rêve quand j’entends les cris. La gare est pleine de monde, il y a des sentinelles françaises. Tout le monde s’embrasse, l’on rit et l’on pleure ! Ne sachant rien de ma famille, je vais chez Mme Pierre Van den Bersen. Elle me dit que son mari est aussi à la guerre mais aussi que mon frère Jean se trouve à Gand ainsi que sa fiancée et toute sa famille. Nos amis Vleminghe sont aussi à Gand. 22 septembre. Je quitte Gand pour la gare St Pierre et viens offrir mes services à l’ambulance de Puurs. 
Puurs – le Couvent Dans le couvent des ursulines qui est abandonné, la besogne ne manque pas et je vais pouvoir regagner le temps perdu. Je vais aussi à Higene (près de Boom) au château du duc d’Ursel où je trouve le bureau de la place. Après avoir laissé viser mes papiers, je reprends le chemin de Puurs. Je suis dans la 5ème DA. Tout le monde y est bien aimable. Elle s’en va mais sera remplacée par la 6ème D.A. Le commandant du 14ème secteur arrive en jour et me demande : « Comment une femme comme vous n’a pas peur dans l’ambulance ? – Je crois que non mon commandant, répondis-je. – Mais ne vous manque-t-il rien ? – Oui, mon commandant, six hommes ! – Et qu’allez-vous en faire ? répliqua-t-il. – Deux pour la cuisine, 2 pour la lessive et, l’un pour la salle et l’autre pour le service de portier. – Pas mal du tout, votre petite
combinaison… Et bien, vous aurez vos hommes, Mademoiselle. Tout ce que j’ai à
vous dire, c’est que vous n’avez pas froid aux yeux ! » – Je ne peux davantage l’être, mon commandant répondis-je. – Ils font tout ce que je veux. – Vous en avez de la chance, je me demande comment cela se peut, s’exclama-t-il. » Et tout le monde se mit à rire de bon cœur. J’apprends également que nous allons avoir la colonne d’ambulance de la 4ème D.A et que tous les médecins doivent loger chez nous. Aussi le travail ne manque pas mais plutôt le linge. Je vais moi-même à la buanderie y donner un coup de main mais le soir à 7 heures, tout le monde est quand même installé. 25 septembre. Je vais au jardin ramasser les poires pour mes blessés et tout-à-coup, j’entends un sifflement et des éclats de shrapnells tomber à mes pieds. Je me retourne et vois un brancardier qui m’a vue partir et qui viens me dire de rentrer car les Allemands commencent à bombarder Puurs. Les forts aussi commencent à donner et l’on entend plus qu’un bruit sourd avec quelques sifflements. Un obus vient de tomber dans une tranchée et plusieurs hommes sont ensevelis. On parvient quand même à les retirer. Trois sont blessés et un a perdu la raison. C’est triste à voir comme il se cache sous ses draps en criant « Cachez-vous, cachez-vous. » Le lendemain, on vint le chercher d’Anvers. Le 26 septembre. Je reçois enfin une lettre de mon frère Jean. Les jours se suivent sans grand changement sauf que les mitrailleurs et les grenadiers sont arrivés à Puurs et les deux docteurs logent au couvent. 6 octobre. Le bombardement recommence en plus fort. Il nous arrive beaucoup de blessés civils, surtout des femmes, sur lesquels les boches ont tiré parce qu’ils s’enfuyaient de leur village d’Oppuurs, petite localité toute proche de Puurs. Bientôt la ville est pleine de réfugiés, tous dans un état lamentable. Je distribue du pain et quelques vêtements. Bientôt les allemands seront dans Puurs et je loge plus de 100 personnes. Le 7 octobre. Le bombardement devient de plus en plus fort et j’écoute les sages conseils des docteurs et loge dans le petit bureau. Vers 11 heures, j’entends que l’on frappe à ma porte en criant : « Mademoiselle, le fort vient de sauter ». Je crois que j’ai fait un cauchemar. Enfin je suis bien réveillée. Heureusement que j’étais toute habillée car j’ai gagné ainsi du temps en n’ayant que mon voile à mettre. Pour moi, c’était impossible que le fort ait sauté car je n’ai rien entendu. « Comment, me dit le docteur, vous n’avez rien ? » mais bientôt on apprend que c’est le pont de Boom et l’on reçoit des ordres pour partir. Une voiture avec cheval vient nous chercher. Un paysan veut bien nous accompagner avec 4 blessés qui ne peuvent pas bien marcher et qui sont couchés dedans. Trois autres marchent avec moi, à côté de la voiture. A 2 heures du matin, nous passons sur le pont de Tamise et l’Escaut me semble bien lugubre et me fait penser au temps où je passais sous ce pont avec mon bateau. Nous faisons une petite halte et nous partons ensuite à Tielrode. Arrivé là, l’on me donne des ordres pour partir avec mes blessés à Anvers. La voiture nous accompagne jusqu’à la gare de Tamise. Là, on place nos blessés sur le tram pour Anvers. Au ponton, une voiture nous attend qui conduit nos blessés à l’hôpital. Sur le quai, je croise un de nos brancardiers à qui je demande ce qui se passe : « La situation est mauvaise, dit-il et sans un sérieux renfort, nous sommes perdus demain. – Comment, dis-je, c’est si grave ? – Hélas, Madame, plus que l’on pense. » Je dus donner plus tard raison à cet homme. Cependant et vous n’allez peut-être pas me croire, le soir, je me rendis chez la famille De Meyer dont les bateaux se trouvaient dans le bassin « Mexico ». Je vais me coucher mais personne n’ose suivre mon exemple et vers minuit, on vint me dire de me lever tellement le bombardement est fort. Je n’en fis rien tellement j’étais trop fatiguée ! Le 8 octobre. Jour inoubliable pour des milliers de Belges. Du côté du sud et de Burcht, tout le monde prend la fuite vers la Hollande. Je conseille à mes amis de faire la même chose et après des adieux touchants, nous nous séparons. Ils partent tous sur un bateau en Hollande. Je me dirige alors vers le pont du génie au Steen et je parviens encore à passer mais il est temps car des milliers de personnes attendent encore de passer pendant que des avions boches survolent la ville et l’Escaut et lancent des bombes. 
Pont construit par le Génie Un espion qui cherchait à faire sauter le pont est pris et presque lynché par la foule. Comme je traverse le pont, je fais connaissance avec deux dames et un officier du 6ème de ligne. L’on fit la route ensemble jusqu’à Beveren Waas. De loin on voit que du feu sur Burcht. Les deux dames ont retrouvé leurs maris qui se trouvent avec leur compagnie à Beveren. Nous parvenons à trouver une petite pièce pour loyer et comme nourriture, l’on ne s’en occupe guère car personne n’a faim. Il y a beaucoup de malheureux couchés à la belle étoile et la place est noire de monde. 9 octobre. L’on se met en route de bonne heure. Un monsieur nous accompagne car ces dames ont l’intention de partir pour l’Angleterre. Nous partons à pied jusqu’à Stekene. La gare est bondée mais nous parvenons quand même à monter dans le train qui part pour Zelzate. Nous sommes à peine installés que j’ai le pressentiment qu’il va nous arriver quelque chose. Je dis alors à mes deux compagnons : « Si vous avez quelque chose de précieux, mettez-le de façon à ne pas devoir le porter à la main. – L’une me dit alors : Vous avez peur Mademoiselle, vous qui ne l’avait jamais été. – Il me semble que nous sommes en danger, dis-je. A peine, j’avais prononcé ce mot que l’on entendit le sifflement de shrapnells. – Voyez-vous, je ne me suis pas trompée, dis-je. La plus jeune se mit alors à pleurer. – Courage, dis-je, rien n’est perdu, mais gardons notre sang froid. » Le train s’arrête et c’est la panique générale. Tous se sauvent vers un bois de sapin. Mes souliers sont plein de sable et la marche est difficile. Je ramasse quelques chargeurs et même le bonnet de police d’un soldat du génie. On s’arrête brusquement car des uniformes inconnus surgissent devant nous et tout le monde pousse des cris désespérés. Nous sommes perdus mais ils nous font des signes et crient : « English men ». Nous voyons alors que c’est l’infanterie de la marine anglaise et l’un des soldats se dévoue même à porter deux valises à ses dames. Bientôt nous voyons le poteau frontière hollandais aussi que quelques soldats. Je vois alors quelque chose de beau : une trentaine de soldats belges s’arrêtent devant le poteau et disent : « Non, nous ne nous rendons pas.» Moi, j’avais déjà passé le poteau mais en voyant cela, je me mis à pleurer. « Ah, mes chères compagnes, dis-je, cela m’est impossible de rester en Hollande. » On trouve un petit paysan qui veut bien nous mener jusqu’à Axel avec sa voiture. Nous y arrivons vers 9 heures du soir. L’on y trouve une chambre pour trois où nous passons la nuit tant bien que mal. Le lendemain, 10 octobre, je me rends au bureau de la Place pour demander la permission de pouvoir rentrer en Belgique. Les officiers me disent que c’est très dangereux car toutes les frontières sont déjà occupées par les Allemands et les trains ne roulent plus jusqu’en Belgique. « Je ne vois alors qu’un moyen, dit-il, c’est de celui de monter dans l’une des trois voitures d’ambulance belges que je crois, nous laisseront repartir, mais je vous le redis, c’est très dangereux. – Je n’ai pas peur Monsieur, dis-je et je vous remercie de tout cœur. » L’on vient nous chercher quelques minutes après et on nous conduisit aux voitures entourées de plus de cent réfugiés belges. Je suis enfin dans la voiture. Alors s’élèvent des cris : « Vive la Belgique, vive la Croix-Rouge ». Mes yeux s’emplissent de larmes. Je dus alors faire connaissance de mes nouveaux compagnons d’infortune. Ils étaient huit, trois voitures et 13 chevaux. Parmi ces derniers se trouvait un petit cheval anglais qu’ils avaient trouvé en cours de route. Après une heure de route nous arrivons à Sluiskil ou beaucoup de réfugiés belges nous apportent des friandises. Après une petite halte, nous repartons pour Philipines, quelques kilomètres plus loin. Arrivés là, on nous photographie, ensuite nous nous restaurons un peu car après ces promenades en plein air, nous avons faim. Avant de partir, le commandant de place vint nous dire bonjour et nous serrer la main. Toujours accompagnés d’un soldat hollandais qui nous fait une escorte pittoresque, nous arrivons vers le soir à Ysendijk. Là également, on est averti de notre arrivée et des centaines de Belges viennent à notre rencontre. Nous devons nous rendre au bureau de la place où le soldat Duchesne et moi, sommes très bien accueillis. Nous sommes conduits vers le docteur de la ville dont la dame s’occupe aussi de la Croix-Rouge. Elle m’a fait préparer une très jolie chambre (un vrai bijou) ainsi qu’un bon dîner tandis que les soldats, chevaux et voitures sont installés à la caserne. Le 11 octobre est un dimanche. Je vais à la messe avec la dame du docteur. Avant de partir, elle voudrait un souvenir de moi. Je ne sais quoi lui offrir sans savoir que je pouvais lui faire grand plaisir en lui offrant le bonnet de police que j’avais ramassé. Je fus obligée de marquer mon nom à l’intérieur. Comme je suis en train de déjeuner avec une dame française, une comtesse qui parait-il désire m’offrir quelques choses pour les soldats. Elle me reconduit même à la voiture avec la dame du docteur et avant de nous séparer, elles m’embrassent toutes les deux. Nous continuons notre odyssée et, en nous approchant d’Oostburg, un motocycliste nous apporte quatre kilos de chocolat. Décidément, on nous gâte en Hollande. Nous arrivons à Waterlankerkje et les officiers nous invitent à prendre un verre avant de quitter la Hollande. (…) Nous arrivons en Belgique et il est sage de prendre des précautions car les Allemands ne sont pas loin. Je dis aux hommes, s’ils ont un couteau, de se tenir prêts en cas d’alerte pour couper les brides des chevaux afin de pouvoir filer en Hollande. Au loin, on entend le canon. Nous ne sommes pas inquiétés mais les soldats partent en éclaireur chacun à leur tour. Nous rentrons à nouveau en Hollande à Sluis où un dîner est préparé pour moi chez un prêtre protestant. Vers 2 heures nous repartons cette fois pour de bon et nous arrivons en Belgique à Westkappele. Il y a peu de soldats de chaque régiment et ils sont mêlés. Nous continuons notre route le long de la mer et arrivons à Zeebrugge où des soldats anglais entourent nos voitures et nous disent : « Sister, please, souvenir pour moi ». D’autres, de leurs bateaux, nous font des gestes d’amitié et agitent des drapeaux. Nous faisons de même. Nous arrivons à Blankenberge où plusieurs soldats que j’ai connus dans les environs de Liège viennent me dire bonjour. Je trouve une chambre dans la Maison Delhaize et les soldats dans un hôtel. Le 12 octobre. Nous repartons au matin à la recherche de notre compagnie de la 2ème D.A. Chaque fois que l’on croit les trouver, ils sont déjà repartis. Finalement, à Ostende, on nous donne des ordres pour aller à Furnes, seulement il se fait tard et nous sommes obligés de passer la nuit à Middelkerke dans la maison du garde-champêtre. Tout le monde est inquiet car on croit voir l’ennemi arriver à tout instant. 13 octobre. Nous partons vers Coxyde et de là à Furnes et au moment où nous arrivons, un de nos chevaux meurt. Je passe la nuit dans une boulangerie tandis que les soldats logent dans un hôtel sur la place. 14 octobre. Nous partons pour Bulskamp et Wulpen et de là à Nieuport. Nous arrivons et retrouvons enfin le régiment. 15 octobre. Je quitte les ambulances car l’on me dit qu’il y a un hôpital dans Nieuport-bain. J’y arrive mais tout le monde est parti. A bout de force, je me dirige vers un garage de canots. J’entre et je vois une charrette abandonnée et je m’y endors profondément jusqu’au lendemain matin, couchée sous une bâche. En sortant le matin, je vois 5 soldats volontaires qui doivent se diriger vers Calais. Le 16, nous passons la nuit dans une villa abandonnée, la villa des sirènes. A cinq heures nous sommes debout car la dame de la villa voisine qui en a la garde vient nous dire que l’on signale des hulans aux environs. Nous marchons le long des dunes, chose peu pratique car le sable entre dans les souliers et me fait mal. Mais chose encore plus triste, nous avons faim et pas moyen de trouver quoi que ce soit pour manger. Nous voyons quelques sentinelles belges qui nous donnent quelques boites de sardines et même du vin mais, hélas, eux non plus n’ont pas de pains. A Coxyde-Bain, nous voyons des réfugiés installés dans une villa abandonnée qui nous donnent enfin un peu même avec du café. C’était même du pain tout chaud et fait sans levure. Nous le mangeons quand même de bon appétit. Nous pouvons enfin monter dans une voiture qui nous conduit à La Panne. Ils nous ont dit de continuer sur Calais après avoir pris un petit repos. La nuit tombe quand nous arrivons à Ghyvelde et après bien des recherches, l’on parvient quand même à se loger, les soldats dans une grange et moi dans une auto qui se trouve sur la Place de l’Eglise. 
Ghyvelde : Route de Furnes – Pont du Chemin de Fer Le 17 octobre. Il m’est impossible de me remettre en route car un mes pieds me font horriblement souffrir et ne sont plus que plaies. J’apprends que mon frère est à Dunkerque chez la famille Depaepe et je pars en voiture jusque Leffrinckoucke et de là dans une voiture d’ambulance jusqu’à Dunkerque. Le 22 octobre, je repars de Dunkerque pour Furnes. J’apprends, au bureau de la place que la 5ème D.A se trouve à Dixmude. Je prends cette direction et, en cours de route, je rencontre beaucoup de blessés et j’an aide même quelques-uns à refaire leurs pansements. Une voiture d’ambulance passe et le chauffeur me dis : « Mme, si vous voulez, vous pouvez monter dans ma voiture car nous avons beaucoup de blessés là-bas et nous les conduirons bientôt à Oostkerke dans une grande ambulance où il y a beaucoup de docteurs et une vingtaine de brancardiers. » Arrivée là, je dis au commandant : « Monsieur, je crois qu’ici je ne puis pas vous être utile car vous avez un grand nombre de personnel. » – « Vous avez raison, Madame, si vous voulez avoir de la besogne, je vais vous faire conduire par un de mes hommes près de l’église où se trouve un petit poste et il n’y a pas de docteur. » 
Ruines de l’église de Oostkerke Arrivée là, je suis bien dans ce poste mais suis aussi triste car je n’ai rien pour offrir à mes blessés. J’y trouve quatre fusiliers français et bientôt une voiture vint les chercher. La nuit tombe noire et lugubre pendant que le canon tonne sans cesse et que les obus continuent à tomber sur Oostkerke. Comme je n’ai pas mangé depuis le matin, la faim commence à se faire sentir mais pas moyen de trouver quoi que ce soit. Toute la nuit je reste éveillée car à tout moment on m’apporte des blessés et comme je n’ai qu’une bougie, il faut l’éteindre après chaque pansement. Le 24 octobre. Au matin, le canon tombe et plus fort que jamais. L’on se demande si on va pouvoir garder nos positions. Plusieurs jours et nuits se passent et je ne sais plus quel jour nous sommes. J’ai recherché dans tous les coins du poste afin de trouver quelque chose pour manger après le départ de mes blessés. Je trouve quelques biscuits et des sardines et même une gourde avec un tout petit peu de vin. La faim et la soif m’aveuglent et manque de tout. Le 26 au matin. Je n’ai pas encore dormi depuis mon arrivée à Oostkerke mais ce jour devait être inoubliable pour moi car je vois des soldats français dans le village. Ils sont fort étonnés de voir une femme et n’osent me causer mais l’un, plus hardi, s’approche de moi et me demande : « Il y a longtemps que vous êtes là, Madame ? – Je réponds : Cinq jours. – Par qui êtes-vous ravitaillée ? me dit-il. – Par personne, je n’ai mangé que ce que j’ai trouvé. – Oh, Madame, permettez-moi de vous offrir, un peu de notre cuisine. Je suis le cuisinier du 19ème bataillon de chasseurs et je crois que vous n’aurez plus faim tant que nous serons ici. » Je le suis dans la cuisine où il me verse un grand quart de litre de vin dans une gamelle. Je le bois presque d’un trait et j’ignore s’il était bon ou mauvais mais il me semble que je n’en ai jamais bu de meilleur. Ils me font également quelques pommes frites avec Beefsteak et l’on me trouve même un camembert comme dessert. Il me semble que je rêve avec un pareil festin. Le soir ils viennent également me chercher pour dîner pendant qu’un chasseur monte la garde à mon poste. Je passe encore une nuit blanche mais vers 4 heures du matin je n’ai plus la force de résister au sommeil qui me terrasse et le m’affale sur un brancard avec un peu de pailles. 27 octobre. Le bombardement redouble d’intensité et il m’arrive beaucoup de blessés. Les pansements me manquent et je ne vois d’autres moyens que de déchirer mon linge que j’ai dans mon sac. Je vois une voiture qui vient deux fois par jour chercher mes blessés. J’ai su après que le brave qui conduisait était Robert de Broqueville. Les obus ne cessent de tomber sur Oostkerke et tout le monde se sauve même un docteur du 2ème chasseur qui est arrivé la veille à mon poste et qui prend la direction de Lampernisse. 
Charleroi Vers 3 heures de l’après-midi, un artilleur arrive et viens me demander si je pouvais m’occuper d’un de ses camarades blessé. Il ne fallait pas me le demander ! Bientôt on m’apporte un grand jeune homme de 23 ans, Léon Gérard de Thuin. Comme moi, il est batelier. Il souffre beaucoup mais ne se plaint pas. Malheureusement je vois qu’il est perdu. Un éclat d’obus a traversé sa poitrine de part en part. Son camarade me demande : « Comment le trouvez-vous ? – Très mal, répondis-je Alors va chercher l’aumônier car je vais mourir dit alors le blessé à son camarade Arthur ! Restez près de lui dis-je, j’irai chercher l’aumônier.» Mais à peine revenue, à peine les huiles saintes reçues, qu’il est mort. Alors ses trois camarades se jetèrent sur son cadavre en pleurant et en criant : « Léon, Léon, je te jure que tu seras vengé». Tous nous avons les larmes aux yeux et nous le transportons dans l’église dans le cas où j’aurais d’autres blessés à recevoir. Le 28 octobre. Le bombardement devient de plus en plus fort et sous une pluie d’obus, nous parvenons quand même à enterrer le malheureux Gérard dans un jardin de maison. Le chef de musique du 2ème chasseur qui viens d’arriver me conseille d’aller avec eux s’abriter près de l’église mais je réponds : « Oh chef, je crois qu’il fait plus dangereux près de l’église que dans notre petit poste car on ne le voit presque pas et puis… Ce n’est pas la peine que je me dérange car mon ange gardien me soigne pour ça. – Je ne comprends pas quelle femme vous êtes dit-il. » Le 29 octobre. Toujours des obus sur obus. C’est terrible de vivre là-dedans. Il m’arrive des blessés toute la nuit. Nuit inoubliable, que j’ai quand même passée à Oostkerke. Le 30 octobre. Des troupes indigènes arrivent en renfort mais bientôt, ils sont reçus par une vraie pluie d’obus et de shrapnells. Un obus tombe sur le poste de secours du 19ème chasseur français et il y a plusieurs tués. Même l’ordonnance du major avec son cheval. Nous transportons tous les blessés dans l’église et presque tous se meurent. L’église paraît bien lugubre. Le 31 octobre. Au matin, je vais cueillir toutes les fleurs qui se trouvent encore dans ce qui reste des jardins à Oostkerke pour ensuite les jeter sur le cercueil des malheureux qui sont morts loin de leur patrie. Après quelques discours prononcés par leurs chefs, la tombe se referme sur eux. « Dormez en paix, chers héros, vous qui avez donné votre sang et votre vie pour une cause juste et sacrée. » Quelques temps après, arrive Mr de Broqueville et comme il a entendu le bombardement sur Oostkerkee, il croyait plus m’y trouver et il me félicite bien fort. 1er Novembre. Toussaint, fête des morts, hélas oui, car nous ne voyons presque rien d’autres. Le service sanitaire du 2ème grenadier que j’ai eu le plaisir de voir à Puurs vient d’arriver. Les frères mineurs Eugene et Marie vont faire la messe à Lampernisse et ils me rapportent du lait et des œufs. 2 novembre. Il arrive de l’artillerie française et bientôt le bombardement recommence. L’on voit des combats d’avions sur Caeskerke. 3 novembre. Il fait un peu plus calme et l’on voit un ballon captif au loin. Un silence lugubre plane sur Oostkerke. 4 novembre. Au matin arrivent des tirailleurs indigènes. Les médecins-majors me demandent l’abri car il pleut. Je les fais rentrer dans ma petite cuisine et je leur fait même une tasse de café avec celui qui m’a été donné par des habitants revenus voir leurs maisons. Vers le soir, ils reçoivent des ordres de partir vers Dixmude. 5 novembre. Ouvrant la porte de mon petit poste, je suis toute surprise de voir un régiment de hussards français dans la plaine. En face un capitaine s’avance vers moi et me demande si c’est vrai que j’en ai assez de toutes les misères comme il l’a appris des officiers des chasseurs. Je répondis : « Cela est vrai, capitaine, mais que voulez-vous c’est la guerre. » Vers midi arrive toute une compagnie de brancardiers dans mon poste et comme je n’ai presque plus de blessés, je demande à Mr de Broqueville quand il arrive, si je peux quitter mon poste pour aller à Dixmude. Une ambulancière anglaise l’accompagne. Nous allons chercher des blessés un peu partout mais Mr de Broqueville et la demoiselle anglaise ne veulent pas me laisser à Dixmude car ils avaient beaucoup de blessés marocains et ils ne voulaient pas me perdre comme cela. La demoiselle me dit de même : « Vous êtes trop précieuse. » Je remonte donc en voiture et traverse la campagne dévastée (Lampernisse, Pervijse, Forthem) et arrivons ensuite à Grognée, là où se trouve un poste de secours des fusiliers marins commandé par le médecin major Petit qui a été blessé à Saint-Jacques Cappelle. 
Fusiliers marins opérant dans le Nord Alors, monsieur de Broqueville me confie à lui et nous y dinons tous ensemble. Les voitures partent ensuite pour Furnes. Le soir, je dîne avec le major qui est tout désolé de ne pouvoir m’offrir qu’un brancard et une couverture pour passer la nuit. Je lui dis alors : « Ce n’est rien Monsieur le Major, je suis habituée à cela. – Oui, dit-il, l’air surpris, alors tout va bien. » Les brancardiers placent alors le brancard tout près du poêle avec une couverture et je me couche toute habillée et m’endors bientôt d’un sommeil profond. Le matin, je suis quand même surprise dans cette grande cuisine et il me semble que je rêve : comme j’avais enlevé mes souliers, je ne les reconnus plus car les soldats les avaient cirés ! J’aide à faire quelques pansements, nous allons à St-Jacques-Oude-Capelle à travers champs rechercher des blessés, un officier, 12 brancardiers et moi-même. Il fait très mauvais, surtout qu’il faut passer plusieurs ruisseaux que nous sommes obligés de sauter. A notre retour, je vais à Dixmude avec le major rechercher les blessés et ensuite le major me charge d’une commission pour les officiers des fusiliers marins qui sont à Forthem. 
Fusiliers marins français en Belgique Sa voiture m’y conduit et alors, il me prend l’envie de retourner à Furnes. En cours de route, sur le tram de Forthem à Furnes, je rencontre des officiers avec qui j’ai travaillé à Puurs. Je revois aussi monsieur de Broqueville auquel je demande un laissez-passer car j’ai appris que l’on bombarde Ypres et que toutes les ambulances sont parties. Le soir, je retourne à la maison où j’ai logé à mon retour de Hollande. Les personnes sont contentes d’encore pouvoir me donner l’hospitalité mais la première nuit, il m’est impossible de dormir. Depuis le 22 octobre, je n’ai plus dormi dans un lit et ne me suis jamais déshabillée. Le lendemain, cela va un peu mieux et, petit à petit, je reprends l’habitude de dormir dans un lit. Je revois aussi le soldat Duchesne, mon ancien compagnon de voyage en Hollande. Je suis heureuse d’apprendre qu’il a été cité à l’ordre du jour du régiment pour avoir ramené les voitures de Hollande et je revois également Henri De Brauwer ainsi que beaucoup d’autres de la 2ème D. A . 18 novembre. Après avoir fait mettre mes papiers en ordre, au matin, je me dirige vers Ypres à pieds. A Elzendamme, deux gendarmes du poste me font prendre du café. J’accepte avec plaisir car il me tombe de la grêle et le vent est très fort. Ma joue gauche est un vrai glaçon, alors, ils ne veulent plus me laisser partir à pieds et dit le chef « Vous monterez dans la première voiture qui va passer. » Une auto arrive, ils l’arrêtent et me font monter dedans. Bientôt, nous arrivons à Ypres. La ville est comme morte et l’on ne voit âme qui vive. Arrivée rue de Lille, je vois deux messieurs qui me demandent si je sais où aller. Je dis : « non. – Je vais vous expliquer, où est l’ambulance, dit-il, seulement il n’y a plus personne. » Comme nous sommes en train de causer, l’on voit deux hommes venir vers nous. La brume commence à tomber et je vois deux soldats anglais qui me disent : « Sister, come wendeer to couvent two sisters or much wemmen . » J’ai su après qu’ils venaient chercher du secours car un obus était tombé sur le couvent des Sœurs Noires. Deux religieuses étaient blessées et le vicaire tué sans compter beaucoup d’autres victimes. Aussi le spectacle est affreux. Les blessés sont presque toutes des vieilles femmes même des folles. Nous les plaçons toutes sous les galeries de l’école des Sœurs de Marie. Nous sommes aidés par les bonnes Sœurs de Marie. Elles sont très aimables pour moi et me prie de prendre un peu de bouillie, chose que j’accepte de bon cœur car depuis le matin, sauf le café offert par les braves gendarmes, je n’ai rien pris. Je fais encore un petit tour dans la ville et nous trouvons plusieurs blessés auxquels nous donnons de bons soins. Vers 7 heures, nous revenons au couvent près des Sœurs qui sont bien contentes de nous revoir. Ce jour ne devra jamais s’effacer de ma mémoire. Les soldats anglais couchent dans le grand corridor et moi avec les Sœurs dans la cave avec quelques réfugiés dont la maison a été détruite. Le bombardement continue aussi fort. Le 12 novembre, vers 5 heures du matin, l’on vient nous demander du secours car un obus est tombé sur la maison Baus. Il y a 6 tués et 7 blessés, tous de la même famille. Je remarque un homme qui y travaille avec ardeur. A ma grande surprise, après le déblaiement, je vois que c’est un prêtre et j’apprends que c’est le curé Delaere de St-Pierre. 
Josephine Cloosterman fut une aide précieuse pour le curé Delaere et sœur Marguerite qui se dévouèrent sans compter pour les habitants d’Ypres. Nous ne parvenons pas à trouver la grand-mère et je vois avec horreur que je marche dessus. Un jeune homme de 17 ans est aussi blessé et je le porte à brancard jusque la Place avec le soldat anglais d’où une voiture d’ambulance l’emmène à Poperinge. Dans l’après-midi, aidé toujours par le soldat anglais Harding, nous portons tous les blessés à l’hospice Ste-Godelieve. Je vais ensuite à la recherche d’une voiture d’ambulance. Sur la route de Menin, des shrapnells éclatent partout et plusieurs soldats français sont blessés. Je leur fait quelques pansements. J’ai enfin trouvé une voiture pour nos blessés qui sont conduits à Poperinge mais ils ne pourront pas tous partir aujourd’hui. Je reviens au couvent comme on va se mettre à table pour dîner avec Monsieur le Curé qui est également venu s’installer, l’on vient à nouveau nous demander de l’aide car un obus est tombé dans la galerie de la brasserie Barre, rue de Lille. Nous y allons de suite, le soldat Harding, Mr le curé et moi. C’est pénible à voir et à entendre. Il y a deux tués, un homme et une femme et quatre autres de blessés. L’on entend des pleurs et des râles. Un jeune homme de 18 ans, fit pitié car il ne cesse de crier : « Maman ; Maman ». C’est le fils de la pauvre femme qui vient d’être tuée (Sophie Torens). Le bombardement ne cesse pas un instant et nous retournons au couvent tristement émus par le pénible spectacle. 13 novembre. L’on voit au matin, à notre réveil, que des obus sont tombés dans l’établissement. Vers 10 heures, je vais à l’hôpital civil où 5 soldats boches sont en traitement et malgré que les Allemands connaissent leur présence, le bâtiment ne cesse pas d’être bombardé. Il y a encore comme personnel, 2 religieuses et 2 domestiques ainsi qu’un major français. Je lui demande quelques pansements que je reçois et il me fait visiter l’hôpital. Nous venons à peine de quitte la pharmacie qu’un obus éclate dedans juste au moment où passe une voiture de ravitaillement anglaise. Les deux conducteurs sont tués ainsi que leurs chevaux et de la voiture, il ne reste plus que quelques morceaux. La servante de l’hôpital est également tuée ainsi que son chien. Pour rentrer dans l’hôpital, il faut maintenant passer au-dessus des murs. Vers 7 heures du soir, il tombe un obus sur l’école d’Aloyse ou s’étaient réfugiées une cinquantaine de personnes. Il y a cinq tués et plusieurs blessés dont un petit garçon et sa mère qui ont les jambes arrachées et projetées à plusieurs mètres d’eux. 14 novembre. Pendant la nuit le bombardement n’a pas arrêté de toute la nuit. A 5 heures du matin, nous sommes brusquement réveillés par un obus qui tombe dans notre jardin. A l’hôpital civil, c’est plus triste encore car ils sont privés d’eau et l’on vient de signaler au Bureau de la Place leur triste situation. Vers la soirée, plusieurs voitures d’ambulance arrivèrent pour évacuer les Sœurs et blessés. Le 15 novembre. Le calme est un peu revenu en ville. Le major français vient nous dire que comme les habitants ont faim, il a une centaine de pains à notre disposition. Nous le remercions bien fort et bientôt les soldats nous apportent le pain que je distribue ensuite. Le soir, au moment de se mettre à table, l’on sonne et je vais ouvrir. Je suis surprise de voir un soldat français qui est blessé et qui demande du secours. Après avoir fait son pansement, on le fait dîner avec nous et on lui fait un petit lit pour pouvoir se reposer jusqu’au matin avec les deux Anglais. Le 16 novembre, au matin, il fait très calme et il tombe seulement quelques shrapnells et deux taubes viennent survoler la ville. Sœur Marguerite et Sr Antoinette ainsi que Mme Maroy, sœur de la Révérende Mère qui avaient quitté Ypres le premier novembre, sont revenues de Poperinge. Le 18 novembre. Je profite de l’accalmie
pour aller faire mes provisions de pansements et d’iode à Brielen.
En revenant, j’apprends qu’il y a de nouveaux blessés. Harding est venu me
rejoindre et nous allons ensemble aux halles dans le poste de gendarmerie où
ils sont couchés. Après avoir fait leurs pansements, nous prenons le chemin de
retour mais à peine dans la rue de Lille, qu’un obus tombe à sept mètres de
nous. Nous recevons une brusque secousse dans les reins et somme projetés
quelques mètres plus loin. « Good
By », dit Harding. A peine cela
dit, qu’un autre tombe et nous sommes remplis de poussières et de petits
éclats. Les gendarmes en entendant les éclats dans la rue de Lille, viennent
voir après nous car ils croyaient que nous étions tués. A peine arrivés à la
maison, un autre blessé français vient nous demander du secours. Nous lui
préparons encore un petit lit où il s’endort bientôt.
Le 19 novembre. On recommence à bombarder la ville mais cette fois ce
sont des obus incendiaires partout et l’on ne voit que du feu. J’aide dans
plusieurs incendies avec mes deux anglais au sauvetage des meubles et de tout
ce qui nous tombe sous les mains.
Le 20 novembre. Un obus tombe sur les Halles. Deux personnes sont tuées
et deux autres blessées. Comme nous allons les panser, un obus tombe à nouveau
sur le côté et nous sommes remplis d’éclats. Je fais le tour de la ville et
fais les pansements des blessés avec le brave Harding. Dieu seul sait combien
de fois nous avons failli être tués en accomplissant nos pénibles rondes la
nuit comme le jour.
Le 21 novembre. Le bombardement redouble d’intensité, toute la ville est
en feu et je suis à nouveau obligée de chercher des médicaments à Brielen. A peine de retour, un gendarme vient me dire que
leur chef, l’adjudant Becharts vient d’être blessé.
J’y cours immédiatement.
En arrivant il dit :
« Mademoiselle Cloostermans, comme je
suis heureux de vous voir ; je croyais que vous n’auriez pas osé venir par
un bombardement pareil. »
Après avoir fait son pansement et lui avoir promis de revenir demain, je
suis rejointe par Harding qui a appris que j’étais aux Halles. La Place n’était
pas un passage tranquille pendant le bombardement et les obus nous environnent
de tous côtés. Nous sommes un peu soulagés quand nous arrivons au couvent mais
nous sommes plutôt des terrassiers que des infirmiers tellement nous sommes
remplis de sable. Vers 7 heures, 4 soldats français arrivent et comme ils n’ont
pas mangé depuis le matin, nous leur préparons un petit souper. Après nous avoir
bien remerciés, ils remontent dans leur tranchée et promette de venir nous
revoir bientôt. Que Dieu les garde sous sa protection !
22 novembre. Jour inoubliable pour moi car les halles et l’église St
Martin prennent feu. La deuxième bombe qui tombe fait fendre la tour des halles
à 9h¼. Elles sont toutes en flammes. Après avoir fait les pansements
nécessaires, je me rends aux Halles et je monte au 1er étage dans la
bibliothèque pour aider les chasseurs alpins qui emportent tous les livres et
archives que j’enlève des rayons qui ont jusqu’à trois mètres de hauteur. J’y
monte par une petite échelle qui, hélas, est bientôt trop courte et alors je
monte sur la planche. Cela est dangereux car je n’ai qu’une main pour me tenir
et les livres sont très grands. Le capitaine des Alpins me les prend et les
passe à ses hommes qui les portent à l’hôtel de la châtelaine. Toutes les
archives portées, je vois un cadre (Vandenperrebom) de l’ancien bourgmestre d’Ypres. Je monte sur
le dos d’un fauteuil soutenu par le capitaine et par un employé de la mairie
qui tiennent le fauteuil en équilibre. Je parviens à l’enlever mais quand il se
décroche, je le reçois en pleine poitrine, ce qui m’étourdit un peu. Un peu
après, on crie que l’on doit descendre car l’escalier prend feu. En effet en
descendant, nos pieds sentent comme dans un four. Quelque chose me frappe
étrangement, ce sont les tableaux peints sur la muraille avec des personnes de
grandeur nature. Ils semblent nous regarder avec des visages souriants et
semblent narguer les flammes qui les entourent. L’église Saint-Martin est
également en feu. Avec Harding qui est venu me rejoindre, nous allons essayer
de sauver encore quelques objets de valeur. Dans le fond de la sacristie, nous
voyons une petite lumière. Croyant avoir à faire à des pilleurs, nous voyons
avec plaisir que c’est Mr le curé qui nous indique que ce sont des antependium
très anciens et que ceux-ci ont une très grande valeur, surtout celui du 12ème
siècle qui est d’un prix inestimable. Nous sauvons également quelques beaux
tapis, des candélabres et aussi quelques statuettes ainsi que celle de Sainte
Barbe. Le tout est parti au Boerenhol. Bientôt, il
nous fut impossible de rentrer dans l’église car n’est plus qu’un immense
brasier. Quelques morceaux de bois sont tombés sur nos épaules et nous sommes
légèrement brulés mais, comme depuis quelques jours je porte une culotte de
gymnase, je suis à mon aise pour faire notre périlleux exercice. Nous avons
enfin fini et comme nous sortions de l’église, l’on voit 3 hommes venir vers
nous et crier d’une forte voix : « Halte là ». 
Ypres : Intérieur de la Cathédrale St-Martin pendant le bombardement
Cela nous surprend un peu, je réponds en anglais et alors, ils portent
la main au képi car c’étaient des officiers français tout en me disant :
« Pardon, Mademoiselle, nous vous avons pris pour des pillards. »
Alors, nous avons ri de bon cœur. Nous portons les derniers objets que l’on
venait de sauver au Boerenhol. Le café se trouve
alors rempli de soldats français et je vois qu’ils se regardent tous surpris et
même commencent à rire. Je leur demande pourquoi ils rient et ils me
disent : « Parce que vous portez des culottes ! On vous a vu au
travail tout-à-l’heure et l’on vous a admiré en nous disant : « Sacré
Nom, voilà un petit pompier qui n’a pas peur » et voilà qu’à notre grande surprise
nous venons de voir que notre fameux pompier est une femme. » Nous
retournons sur la place, là un magasin de mercerie prend feu et je demande des
hommes de bonne volonté et en un instant toutes les marchandises sont enlevées
et portées à l’abri. Je jette tout ce que je prends des rayons dans les mains
des soldats et jamais l’on ne vit pareil sauvetage ! 9h 20, tout et enlevé
mais je sens mes forces m’abandonner car je suis vraiment exténuée quand
j’arrive au couvent.
23 novembre. Au matin, les halles et l’église sont toujours en flammes
et toutes les maisons des environs. Vers le soir, les Cinq Coins sont également
en feu et nous arrivons. Par cinq ou six fois, nous sommes obligés de monter
pour enlever les marchandises mais, pendant que nous sommes là-haut, la moitié
du plancher s’écroule et nous n’avons que le temps de nous lancer du côté de
l’escalier. Quand enfin tout est enlevé, nous continuons à la cave et dans le
magasin. Nous voulons entrer une dernière fois quand l’enseigne de bois tombe à
mes pieds et nous en sommes même un peu brulés et égratignés. Vers 9 heures,
nous rentrons au couvent dans un état pitoyable. A minuit, on vint nous
chercher car un obus est tombé sur l’hospice Sainte-Godelieve. Quel triste
tableau. L’on ne pouvait plus distinguer les lits et plusieurs vieilles petites
femmes étaient mortes. Une avait le pied complètement écrasé et 6 autres
blessées. On enterra les tuées dans le jardin. Le bombardement ne finissant
pas, nous revenons seulement à 3 heures du matin et pouvons enfin prendre un
peu de repos. Vers 5 heures, à peine endormie, on vint à nouveau nous chercher.
Un obus est tombé sur le bureau de poste et il y a deux femmes blessées.
25 novembre. Au matin, je n’ai guère dormi, après avoir fait quelques
pansements, nous allons à l’hospice. Pendant que Mr le Vicaire Roose donne les
Saintes Huiles, un obus de gros calibre, tombe, juste au-dessus de nos têtes,
dans la maison de Madame Roose qui est à quelques pas. Alors on entend des cris
et des appels de toutes ces pauvres petites vieilles :
« Mademoiselle, sauvez-nous aussi. » Je sens mes yeux
s’emplirent de larmes et je songeais à la Ste Catherine de 1913 qui avait été
si gaie pour moi alors qu’aujourd’hui je ne vois que des morts et des blessés.
4 femmes viennent de mourir et la plus âgée a 103 ans ; elle est morte
d’émotion. J’apprends bientôt qu’une femme est restée sous les décombres de la
maison de Madame Roose.
26 novembre. Le temps est assez beau et le bombardement a cessé un peu.
L’on vient chercher les femmes de l’hospice Ste-Godelieve avec des voitures
d’ambulance et Mr Roose vient s’installer chez nous avec sa mère. Quelques obus
sont également tombés chez nous et chez les Sœurs Noires. Quelques maisons sont
en feu.
27 novembre. Après avoir été à la Sainte Messe, je vais soigner un homme
qui vient d’être blessé. C’est tout près (Plaine d’amour). Comme j’arrive à la
maison, un obus tombe à côté. Nouvelle frayeur pour les malheureux surtout que
leur fils est blessé. Après avoir lavé la plaie, je m’aperçois qu’un boulet de
shrapnells est resté dedans. Le soir, je lui renouvelle le pansement et j’en
parle au docteur anglais qui s’est installé au Sacré-Cœur. Il me permet d’aller
le faire chercher pour lui faire une petite opération. En ville il y a encore
quelques tués et blessés.
Le 28 novembre. Départ des dernières petites vieille de Ste-Godelieve.
Je fais quelques pansements en ville comme d’habitude. Je vois avec plaisir que
mon blessé (de la plaine d’amour) va mieux. Dans l’après-midi, le chef du poste
de la gendarmerie me dit : « Savez-vous les nouvelles ?
– Non dis-je.
– Eh bien, l’on vient de me
signaler que je dois vous surveiller de près car on me dit que vous êtes
signalée comme espionne. » En apprenant cela, je sens mon sang se
glacer dans mes veines et mes yeux s’emplissent de larmes. Je souffre
atrocement.
« Ne pleurez pas, Mademoiselle, si nous avions que des espionnes
comme vous, au lieu de les arrêter, l’on devrait les décorer. »
Malgré tout, je ne parviens pas à me remettre de cet affront.
« C’est parce que vous avez tous été dans le danger, dit-il, que l’on
croit cela.
– Mais n’est-ce pas là que je dois être ? »
Comme nous sommes toujours à causer, l’on vient me chercher pour une
femme qui vient d’être blessée rue de
Dixmude, ce qui me fait dire au gendarme que l’on a quand même besoin de mes
services malgré que je sois une espionne ! A 8 heures du soir, je rentre
au couvent et j’y trouve le capitaine Young qui lui aussi dit à Mr le
curé que l’on doit me veiller car je suis très suspecte. A quoi Mr le curé
se mit à rire de bon cœur mais le cœur me manque car j’éclate en sanglots.
« Courage, me dit-il, le Bon dieu n’approuve que les siens. » Mais
hélas, je trouve cela bien dure quand même. Mr le Curé, vers 11 heures de la
nuit nous réveille brusquement à coups de sonnettes et Sœur Marguerite et moi
nous nous levons et à notre grande surprise, nous voyons deux civils qui
habitent les casemates. L’un (Velghe Carlier) s’était
battu avec quelques soldats anglais et avait reçu plusieurs coups de couteau
assez graves. « Décidément, dis-je, si vous avez envie de vous battre,
allez à l’Yser vous battre contre les Allemands. » Après une bonne
réprimande et les soins, ils retournent chez eux.
Le 29 novembre. Pendant que nous sommes à la messe, plusieurs obus
tombent. Nous rentrons à la maison où se trouve le capitaine Young et je lui
montre mes papiers et certificats que je n’avais pas eu le courage de lui montrer
la veille. Il me demande alors pardon de la peine qu’il m’a faite. Après avoir
fait les pansements, je vais revoir mes blessés en ville mais alors le docteur
Rees m’accompagne. Le bombardement a complètement cessé. Quel
soulagement ! Le soir je vais chez
les demoiselles Van Uxem passer la soirée.
Le 1er décembre. Tout au matin, je vais aux casemates retirer
les drains du blessé. Rentré au couvent, les docteurs viennent de commencer à
opérer mon autre blessé et me prient d’assister à l’opération qui se passe très
bien. A peine réveillé, il me réclame. Mr le Curé est amusé par l’explication
du blessé : « Voyez-vous, Mademoiselle est mon ange gardien !
– Croyez-vous, dis-je qu’une espionne peut être un ange gardien ?
– Tatata, dit Mr le curé, ne parlez plus de
cela ! Harding va passer la nuit à son chevet. »
Le 2 décembre. Je reste moi-même près de lui et Harding va faire
quelques pansements en ville. Vers 3 heures, on vint le chercher avec la
voiture pour le conduire au Sacré-Cœur. Après nous finissons les pansements en
ville.
Le 3 décembre. Il tombe un obus sur la maison du docteur Dierckx. 5 personnes sont tuées et trois blessées. Les
autos anglaises viennent chercher les blessés. Je les accompagne jusqu’au
Sacré-Cœur où j’aide même à faire quelques pansements mais il se fait tard et
le chef nous fait reconduire avec la voiture.
Le 4 décembre. Je vois que Sœur Marie est dans la peine. Elle me dit que
son frère qui habite Brielen est blessé. Je lui
demande si elle veut venir avec moi car je ne connais pas la maison. Elle est
bien heureuse et m’accompagne. Sur la route nous rencontrons le docteur
Malabare avec deux autres médecins. Ils nous demandent où nous allons. Je dis
que nous allons soigner le frère de Sœur Marie et ils nous prient de monter en
voiture. En arrivant, nous voyons qu’il est guéri car il y a plus de 25 jours
qu’il a été blessé à la main. Tout le monde en rit et l’auto nous reconduit.
5 décembre. Après la visite des blessés, nous sommes accostés par Thomas
Findlez que Mr le Curé a renvoyé du couvent parce
qu’il est toujours ivre. Nous sommes menacés tous deux et finalement, il donne
un ou deux coups de poings à Harding qui ne comprend rien. Quelques personnes
sont venues les séparer et alors, il me montre son fusil en disant :
« Dat is for you en
four Harding». Je me demande ce qu’il va faire et j’ai encore assez loin pour
aller au couvent, je vais passer la nuit chez les demoiselles Van Uxem.
Le 6 décembre. Je vais à la gendarmerie et je dis à l’adjudant Delattre
que j’ai peur et demande protection.
« De qui ? me demande-t-il.
– D’un soldat anglais qui fit que je n’ose même plus aller en rue.
– Ne craignait rien, dit-il, nous ferons bonne garde et gare à
lui. »
Le 7 décembre. Les obus tombent toujours et vers le soir le bombardement
augmente. A minuit, on vint nous réveiller brusquement car un obus est tombé
sur une maison près de l’église Saint-Pierre. 
Ypres : Eglise St-Pierre avant et après la guerre
Toute la famille est sous les décombres et il y a plusieurs tués et
blessés. L’église Saint-Pierre prend feu à son tour. Nous aidons du mieux mais
nous devons partir près de Place où il y a des blessés pendant que l’abbé Delaere, quelques Sœurs et des hommes de bonne volonté
cherchent à éteindre le feu et à sauver les chaises de l’église. Après avoir
donné les soins nécessaires, nous rentrons à la maison où nous attendaient des
blessés. Ne nous voyant pas revenir, sœur Marguerite avait commencé les
pansements. Je les finis aussitôt et comme ces malheureux n’osaient rentrer
chez eux, je les conduis dans la cave de la brasserie Gillebert.
Nous allons enfin nous recoucher, mais à peine dans mon lit, qu’on vient me
chercher pour des blessés à la rue de Dixmude. J’y trouve en effet 3 blessés
(deux femmes et un homme) et, avec horreur, nous apercevons un homme tué dans
son fauteuil avec les deux jambes coupées jusqu’aux genoux. A 7 heures, nous
rentrons exténués et mouillés car, depuis 3 heures, il a commencé à pleuvoir,
ce qui fait beaucoup de bien à l’église Saint-Pierre.
Le 8 décembre. Nous retournons voir nos blessés. Vers midi, une maison
s’écroule rue des Plates. Le soir, nous sommes à table pour dîner quand le Dr
Malabare vint me chercher pour aller chercher un bébé dont la mère qui est au
Sacré-Cœur ne cesse de réclamer. Je vais de suite avec lui pour satisfaire le
désir de cette pauvre mère. Il me dit aussi qu’il cherche le soldat Thomas Findlez mais qu’il est introuvable.
Le 9 décembre. Je vais en ville chercher les noms de ceux qui veulent partir
en Angleterre. Les officiers anglais cherchent aussi Findlez
qui est enfin arrêté et reconduit à sa compagnie mais le soir j’apprends avec
terreur qu’il s’est sauvé. Je vais le dire à l’adjudant Delattre qui me
dit : « Croyez-moi, nous veillons sur vous et toute la
gendarmerie est à sa recherche. »
Le 10 décembre. Un officier anglais arrive et demande qu’Harding aussi,
retourne à sa compagnie qui est à Merisse. Cela me
fait beaucoup de peine car maintenant je serai seule pour faire ma triste besogne
la nuit et cela sans défense contre Findlez. J’ai mon
petit révolver en poche et je dis à la gendarmerie que si je suis menacée, je
ferai usage de mon arme et le commissaire de police m’en donne la permission.
Le 11 décembre. Rien n’est changé dans la ville et il y fit calme. Je
conduis plusieurs blessés au Sacré-Cœur.
12 décembre. Pendant que nous sommes occupés avec les pansements,
Harding revient me disant qu’il n’a pas retrouvé sa compagnie. Nous retournons
tous au Sacré-Cœur pour trouver une voiture pour le reconduire à Poperinge.
Vers le soir, le bombardement recommence de plus en plus fort et un obus tombe
sur une maison de la rue Basse. Un homme, une femme et leurs trois enfants sont
tués et on a bien du mal à les retirer des décombres. Un autre obus tombe sur
le poste de secours des Zouaves, juste sur la salle des blessés, qui est au
Nazareth. Il y a des tués et beaucoup de blessés. Un troisième obus tombe près
des casemates. Après avoir fait quelques pansements, je reviens chez nous
lorsque j’entends des plaintes mais je ne sais plus rien distinguer car la nuit
est tombée. Je me dirige dans la direction d’où proviennent les gémissements et
je trouve un homme baignant dans son sang. Je sonne vivement et aidé d’une
sœur, je le transporte dans mon petit poste qui est bientôt inondé de sang car
il a 27 blessures et je me demande s’il va en réchapper. J’ai à peine fini de
le panser que l’on vient me dire qu’il y a d’autres blessés aux casemates. Je
trouve en effet une vielle femme, un homme et quelques enfants mais aussi une
jeune femme. J’apprends que c’est la
famille du malheureux qui est chez nous (Velghe
Carlier), mon blessé du 29 novembre à coups de couteau. Son enfant de deux ans
a brûlé vif dans les flammes et sa femme perdra un œil. Il est 7 heures du soir
quand j’arrive à la maison. Je dis à Mr le Curé que je vais au Sacré-Cœur
chercher les voitures. 
Dans les premiers mois de la guerre, l’hospice du Sacré-Cœur fut transformé en hôpital par les Quakers venus soulager la souffrance des Yprois.
Le 13 décembre. La journée est plus calme et il ne tombe que quelques
obus. On vient à nouveau me prier de porter un enfant à sa mère au Sacré-Cœur
mis quand j’arrive là-bas, on le refuse et je suis obligée de revenir avec, ce
qui me fit une promenade de 5 km avec un enfant dans les bras. Vers le soir, le
canon reprend de plus belle ainsi que les mitrailleuses.
Le 14 décembre. L’attaque est générale car il paraît que les Français
prennent l’offensive. Des obus tombent partout. Je suis au cabinet ainsi que
Sœur Marie lorsqu’un obus vient de tomber à 5 mètres du mien. Sans les autres
cabinets qui nous formaient un abri, l’on y était écrasé toutes les deux. Le
plafond me tombe sur la tête et je suis toute remplie de plâtres. L’on se rend
dans la cuisine en criant : « N’y-a-t-il pas des
blessés ? » car l’on ne savait rien distinguer. Je cours dans la
cours de l’école et je vais voir à la classe où un poste de secours français
s’est installé depuis la veille. Cela devait être connu des allemands car les
postes étaient toujours visés car il y avait beaucoup de respects pour la
Croix-Rouge. Depuis la guerre, j’en ai bien des preuves. Quelques secondes
après un deuxième tombe puis un troisième et enfin un quatrième. Entre le 3ème
et 4ème j’étais partie courir ouvrir car on sonnait. Mr le Curé
rentre avec Sœur Livine et Geneviève. Un affreux
spectacle s’offre à mes yeux : quelques soldats français qui s’étaient
sauvés furent blessés ou tués. L’un avait le ventre ouvert et les yeux hors de
la tête. Mr le Curé eut le temps d’administrer l’extrême onction et il meurt
aussitôt. Il y avait aussi quelques civils volontaires, des pompiers
volontaires comme Declercque, grièvement blessé à la
tête et à l’œil qui pendait hors de l’orbite. Il est également blessé aux
jambes. Je le porte comme je peux, plutôt en le traînant et le mène tant bien
que mal jusqu’à la cave Gillebert (Brasserie).
Pendant que je vais chercher des pansements, un 5ème obus tombe sur
le coin du couvent et l’on vint ensuite me chercher car il y a des blessés rue
de Dixmude et sur la Grand-Place puis un jeune homme sur le Marché au Bétail.
Je reviens ensuite à la maison mais un jeune homme vient me dire qu’il y a
encore des blessés dans la classe et qu’il n’est pas possible de les abandonner
ainsi. Je crois donc que les Français ont laissé des blessés chez nous. Nous les
transportons à la cave Gillebert et un major me dit
en arrivant là :
« Mais d’où viennent ces blessés, Madame ? »
– De chez nous, dis-je.
– Pourquoi ne les avoir pas laissés. Ils étaient bien là.
– S’ils étaient si bien, pourquoi vous êtes-vous sauvés ? C’est
honteux que brancardiers et infirmiers aient abandonnés leurs camarades
blessés.
– Alors tous, fort gênés disent : « Nous vous accompagnons
Mademoiselle « et pour le deuxième
blessé, j’avais dix hommes avec
moi ! » A 16 heures, il tombe encore un obus.
Le 15 décembre. Je vais à Woesten par Brielen en ambulance. En revenant nous passons par le canal
et nous allons ensuite chercher Sœur providence qui est malade pour la conduire
à l’hôpital d’Elvervinyk. Nous allons ensuite au
Sacré-Cœur. A 5h du soir, nous retournons aux casemates voir nos blessés et une
femme.
Le 16 décembre. Je vais au Sacré-Cœur et ensuite faire ma ronde
habituelle et je vais aussi voir le pompier qui est dans la cour de l’école
moyenne. Là, le capitaine Young vint me
dire que Harding est aussi pris comme déserteur parce qu’il est resté si
longtemps à Ypres. Je pense alors que je suis forcée d’aller le défendre.
Le 17 décembre. Je pars d’Ypres en voiture jusque Poperinghe.
Je vais à Bailleux. Les routes sont boueuses et très
difficiles. Là on me dit que la 7ème D. A anglaise se trouve à Merisse. Nous y allons mais elle est partie. Une voiture de
ravitaillement passe et le conducteur me dit de monter. Je vais donc à Merville
mais à Vieux Berquin, je vois une ambulance anglaise et vais demander des
renseignements. Le chef me fait conduire à Merville après m’avoir donné un
interprète et me fait prendre le thé avec les nurses et le dîner avec les
officiers.
« C’est un grand honneur que vous nous faites, Mademoiselle, disent-ils,
car les Belges sont très braves. »
Une jeune fille française qui vient toujours apporter des friandises à
l’hôpital, me dit que je dois aller loger chez sa mère quand j’aurai été au
bureau de la place. Au bureau de la Place, je raconte toute la vie d’Harding à
Ypres ainsi que du grand courage qu’il fit preuve. « Madame, me dit le
Major, je crois que votre démarche lui sera très utile car en effet il est
arrêté comme déserteur mais il ne se trouve pas ici mais à Sailly-sur-Lys.
Demain une auto vous y conduira. Je demande alors la permission pour que
l’interprète puisse m’accompagner. »
Le 18 décembre au matin. Après avoir été à la Sainte communion, je pars
à Sailly-sur-Lys accompagné d’un officier et de mon
interprète qui parle très bien le français et qui me demande de lui raconter
comment et pourquoi je vais si loin pour sauver un soldat anglais. Après avoir
raconté ma petite histoire, je lui dis : « vous voyez, Monsieur, je
trouve que tous les soldats souffrent pour que nous-mêmes devons leur faire de la peine. J’aurais beaucoup de
chagrin s’il devait être puni bien sévèrement. » Alors, il me tendit la
main et me dit : « C’est très bien et vous êtes bien
brave ! »
Nous arrivons à Sailly. L’officier va
s’informer mais on vint nous dire qu’il est à Estaire.
Nous y sommes bientôt et l’on va le chercher. On nous dit qu’il va passer le
Conseil de Guerre dans quelques jours. Cela me fait beaucoup de peine et me
fait venir des larmes aux yeux. Harding arrive encadré de sentinelles. Il a
beaucoup changé, est très pâle et a fort maigri. On voit même qu’il a pleuré.
Alors un officier lui dit : « Il y a une dame dans cette voiture qui
vient d’Ypres et qui vous connait. La connaissez-vous ? » Alors, ses
yeux se lèvent sur moi et il dit : « Oh Miss Josy ! »
et s’adressant à ses officiers, il demande si je peux servir de témoin. J’ai
dit « oui » mais le conseil n’allait avoir lieu que dans trois jours.
« Hélas, dis-je, je ne puis rester si longtemps à Merville.» Alors, le
chef me dit qu’il allait activer cette affaire et que je serai avertie de
suite.
Le 19 décembre. Au soir, l’on me fait parvenir un télégramme qui me dit
que je dois être demain à 9 heures à Sailly. Je vais
au bureau de la Place avertir l’officier et il me promet une voiture demain à 8
heures.
Le 20 décembre, à 8h 30 du matin, je suis déjà dans la maison ou va
avoir lieu le jugement et bientôt les officiers arrivent et Harding. Je dois
faire le serment et alors je raconte tout. Lorsque j’ai fini, ils me disent « Merci
Madame pour lui ». Je puis me retirer et Harding vient me serrer la main en
disant : « Tanck you
tanck you, Mis Josy, good by » et, il reprend le chemin de sa Cie. Je
quitte Merville dans une voiture qui me conduit à Poperinge et, de là, je pars
à pieds vers Ypres. Je vois en passant le Sacré-Cœur qui a été bombardé depuis
mon départ et il y a même beaucoup de blessés et même des tués. J’arrive enfin
à notre cher couvent et tout le monde est surpris de me revoir et fort saisi de
mon voyage car j’avais dit que j’allais à Dunkerque voir mon frère.
Le 21 décembre. Je vais à Woesten raconter
l’histoire de Harding aux docteurs
anglais. Ils sont fort saisis et me disent qu’ils vont faire le nécessaire pour
atténuer sa condamnation. Je reviens en auto avec le capitaine Young et je fais
ensuite une lettre au commandant de la 7ème D.A. anglaise que des
officiers vont faire parvenir avec un certificat de Mr le Curé.
Le 24 décembre. A midi, pendant que nous sommes à table pour dîner, une
sœur Noire arrive de Poperinghe (Sœur Lucie) et me
remet une lettre de ma famille. C’est la première fois que je reçois du
courrier de mes parents depuis que je suis en campagne aussi je fus très
heureuse.
Le 25 décembre, jour de Noël. Les Allemands ne nous ont pas oubliés car
pendant la messe, les obus commencent à tomber en vraie rafale sur la ville.
Bientôt, il ne reste plus que Mr le Curé, les Sœurs et moi dans la chapelle. Il
y a plusieurs blessés et même des tués en ce jour de Noël qui avait été si joyeux
l’année dernière.
Le 26 décembre. Le bombardement recommence et comme toujours il y a des
blessés. Nous allons quand même passer l’après-midi chez mon amie Jeanne.
Le 27 décembre. Nous recevons toujours des obus juste derrière nos
voitures que l’on croyait à tout moment prêtes à sauter en l’air.
Le 29 décembre. Le vent a fait quelques dégâts dans les maisons
atteintes par les bombardements et nous avons encore quelques blessés.
Le 30 décembre, cela ne change guère car nous avons toujours quelques
obus.
Le 1er janvier 1915. Cette année sera-t-elle celle de la victoire
et de la paix ? Beaucoup d’habitants sont revenus à Ypres avec l’espoir
que le cauchemar se terminerait bientôt mais, hélas, tout cela est vain car
bientôt les obus recommencent à tomber. Pendant le salut, la chapelle est
d’abord pleine de monde mais elle est bientôt désertée. La première blessée que
je vois est une jeune fille de 10 ans qui a une fracture d’un bras par une
balle de shrapnell. Elle fait pitié à entendre tellement elle souffre. Elle
s’appelle Valentine Waerten. Une autre jeune fille,
Marie Dehollander est également blessée et bientôt
notre petite salle est remplie de blessés. Nous sommes aidés par un médecin
major français. Après avoir fait quelques pansements, je vais au Sacré-Cœur
voir après les voitures. Je reviens avec et bientôt tout le monde est évacué
vers le Sacré-Cœur mais une autre jeune fille est morte. Elle a reçu une balle
de shrapnell à travers la gorge. Triste jour qui sera pour moi inoubliable mais
hélas, pour beaucoup, ce ne sera que du sang et des larmes.
Le 2 janvier. Il tombe toujours des obus mais heureusement pas de
nouveaux blessés.
Le 3 janvier. Il n’y a pas de grands changements à notre triste
situation.
Le 4 janvier. Après avoir fait des pansements dans la ville, je vais au
Sacré-Cœur où arrive le docteur Smerdon qui me dit
qu’une voiture part pour Dunkerque. Comme tous les blessés sont maintenant dans
l’hôpital, il me prend l’envie d’aller voir mon frère à Dunkerque. La
permission m’est accordée et j’arrive à Dunkerque à 6 heures du soir. L’auto me
conduit au bateau qui est toujours dans l’île Gentil. J’apprends que mon frère
Jean va se marier le 9 janvier. Je retourne le lendemain pour demander une
permission pour aller le 9 à Malo-les-Bains. Une voiture me conduit jusque
Bergues et de là je remonte dans une autre jusqu’à Poperinghe.
Je vais loger chez nos sœurs installées chez le père de l’une d’entre elles, Mr
Lallemand. Toutes me questionnent sur ma vie à Ypres. Je suis tellement
fatiguée que je tombe bientôt dans le sommeil le plus profond.
Le 6 janvier. Comme convenu la veille, une auto me conduit à Ypres au
couvent. Tout le monde est content de me revoir surtout mes blessés car
beaucoup croyaient que j’étais partie pour de bon et vraiment je m’en suis
trouvée heureuse malgré ma triste situation. J’apprends aussi, avec peine, que
des gendarmes ont été blessés et un autre tué. Le gendarme Clarisse est tué et
le maréchal des logis grièvement blessé. La journée est assez calme.
Le 7 janvier. Depuis quelques jours, il y a beaucoup de malades qui sont
visités par le Dr Smerdon avec Sœur Marguerite.
Beaucoup doivent être évacués et ce n’est pas toujours facile car ces pauvres
gens ne veulent pas toujours comprendre que nous ne voulons que leur bien. L’on
fait aussi l’enterrement de Mr Clarisse. Mr le Curé l’accompagne jusqu’au
cimetière et se rend ensuite chez le Commandant de la Place pour parler
d’organiser un hôpital pour les cas de typhoïde. Je me rends aussi à la
gendarmerie où l’on me raconte le triste accident qui venait d’arriver.
Le 8 janvier. Je pars pour Dunkerque et promet de revenir bientôt. Je
pars à Woesten où je dîne avec le docteur Malabare
qui me délivre un laissez-passer. Deux docteurs anglais m’accompagnent jusque
Dunkerque car ils se rendent en Angleterre en congé. En passant par Westvleteren et Furnes, des soldats français me demandent
de vouloir emporter des lettres en France et j’en reçois des centaines. Bientôt
nous arrivons à destination et je suis fort contrariée car papa et maman ne
peuvent arriver que le lundi, donc la noce est reportée au 12 janvier, aussi je
m’ennuie beaucoup. Nous recevons un télégramme que maman et ma sœur arrivent au
train de 9 heures du soir et nous allons les attendre à la gare. Nous sommes
tous heureux en bonne santé et le temps est superbe mais bientôt on entend la
sirène et l’on entend partout les bombes tomber et faire beaucoup de victimes.
Une récente dépêche arrive : Papa Louis et Julien vont arriver ce soir et
la famille sera ainsi au complet. Voilà bien longtemps que nous n’avons plus
été réunis comme cela.
Le 12 janvier. La noce a bien lieu et l’on s’amuse assez bien, comme on
peut le faire à une noce de guerre. Moi, j’aspire au lendemain. A 5 heures du
matin, je suis déjà prête et après avoir embrassé tout le monde, je me rends à
la gare. Comme je m’étais piquée en faisant un pansement à Ypres avant de
partir, je vois que ma plaie s’était aggravée et je commence à souffrir. J’ai
beaucoup de fièvre. Enfin, le train arrive à Vlamerthinghe.
De là, je vais à pieds jusqu’à Ypres. En passant devant le Sacré-Cœur, je vais
voir le docteur Smerdon qui me fait une incision, ce
qui me fait très mal mais je n’ose me plaindre. J’ai aussi fort mal de gorge.
Je ne suis pas à mon aise quand le docteur me dit que je dois garder la chambre
et j’en suis toute désolée.
Le 14 janvier, le docteur vient me rendre visite et me défend
strictement de sortir. Le temps me semble bien long, moi qui croyais rattraper
le temps perdu à Dunkerque. Dans la nuit, il tombe une vingtaine de shrapnells
et l’on s’attend à une journée mouvementée. Cela ne manque pas d’arriver et il
tombe une cinquantaine d’obus. Il nous arrive un seul blessé que je parviens
quand même à panser. L’on fait aussi le baptême du petit André Clonkemail dans la chapelle de notre couvent et je suis la
marraine de guerre.
Le 15 janvier. Cela va un peu mieux. Du côté de Brielen,
la propriété de Mr G.Bailleul est en feu ainsi que
plusieurs autres maisons. Le canon anglais tonne et plusieurs avions boches
survolent la ville. Mr le Curé recherche les vieillards impotents pour les
mener en lieu sûr par les Friends (les Quakers).
Le 16 janvier. L’on vient me dire qu’il y a des blessés rue des Plumes.
Alors, c’est plus fort que moi et après m’être habillée, je sors quand même. A
mon retour, je suis fort peinée car l’on vient de porter Mr le Curé au Couvent
car il a été pris subitement d’un vertige pendant qu’il se trouvait dans l’auto
pour aller chercher des vieillards. Il est tombé sur les pavés et est resté une
heure sans connaissance. Il souffre beaucoup de l’épaule gauche et il lui est
impossible de s’habiller et devra garder le lit plusieurs jours. Moi, je me
fais réprimander par le docteur parce que je suis sortie. Je lui ai dit :
« Docteur, je suis guérie et c’est parce que vous m’avez bien
soignée. » Il me répondit : « Vous n’êtes pas raisonnable du
tout, vous êtes une « naughty » (traduction
de infernale) girl et il se mit à rire.
Le 17 janvier. Mr le Curé a eu une mauvaise nuit. Dans la journée, il
fait très calme.
Le 18 janvier. Dans la nuit, un soldat anglais a été tué dans la
brasserie Vermeulen. La maison Leupens a été perforée
mais pas de blessés.
Le 19 janvier. Il tombe cinq obus puis le calme revient peu à peu.
Le 20 janvier. Vers 10 heures, on vint me dire qu’il y a un blessé à la
Plaine d’Amour. Dans la soirée, une terrible canonnade éclate au loin. C’est
effrayant. 
La Plaine d’Amour avant la guerre 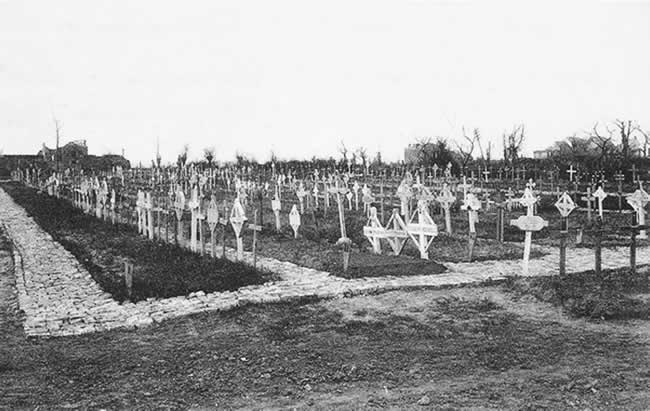
Destin paradoxale de la plaine d’Amour sera transformée….. en cimetière militaire Le 21 janvier. A 2 heures et demie de la
nuit, quelques shrapnells et vers 6 heures, des obus tombent sur l’école de
bienfaisance et six soldats français sont tués. Il pleut toute la journée et il
fait encore plus triste.
Le 22 janvier. Dès le matin, quatre taubes viennent en reconnaissance et
il tombe aussi plusieurs obus. Il y a plusieurs blessés et deux tués chaussée
de Menin.
Le 23 janvier. Plusieurs taubes reviennent surveiller la ville. Ils sont
aussitôt poursuivis. Un tombe à Poperinge.
Le 24 janvier. Journée calme mais beaucoup de pansements à faire.
Le 25 janvier. Il y a plusieurs explosions près de l’usine à gaz et la Kruisstraat. Il parait aussi que les Allemands ont subi de
lourdes pertes près de Zonnebeke.
Le 26 janvier. Les membres du
comité d’Ypres adressent une lettre à Mr Young pour le remercier de tout ce
qu’il a fait pour les Yprois. Il y a encore quelques
explosions. Messieurs du comité propose de désinfecter l’eau des remparts et de
placer des tonneaux d’eau stérilisées à l’usage des habitants et de faire des
injections anti typhoïdes car on constate beaucoup de cas de fièvre typhique
surtout parmi les réfugiés. On tâchera d’évacuer ceux-ci.
Le 27 janvier. Un avis est porté que, à l’occasion de l’anniversaire du
Kaiser, les Allemands se préparent à envoyer des marmites bourrées de pralines.
Les canons se font entendre de tous côtés mais ce sont les alliés qui
gratifient les boches de quelques dragées. Cependant sur les casemates, il
tombe quelques obus. Je vais aussi au Sacré-Cœur chercher un enfant pour aller
le placer en nourrice. Le pauvre petit est orphelin et sa mère est morte à la suite à ses blessures ; on ignore
où se trouve le père. Comme nous passons le canal de l’Yperlee,
un obus tombe quelques mètres derrière la voiture. Il en tombe un peu partout
mais nous n’avons pas de nouveaux blessés.
Le 28 janvier. Il tombe encore quelques obus de shrapnells et il y a
plusieurs blessés, rue d’Elverdinghe et rue St-Jean.
Je reçois aussi une lettre du Commandant de la 7ème D.A qui
m’apprend qu’Harding a été condamné à six mois de travaux forcés. Cela me fait
beaucoup de peine.
Le 29 janvier. Il arrive beaucoup de troupes dans la ville et il s’est
formé un comité pour rechercher les malades de la typhoïde en ville. Il nous
arrive plusieurs nouveaux docteurs anglais qui aidés par les Sœurs Lucie et
Esther vont dans chaque maison. Leur tâche est très difficile car ils ne sont
pas toujours bien reçus et même très souvent les gens ont caché les malades.
Le 30 janvier. Il tombe plusieurs obus sur la maison de Mr Angillis et plusieurs shrapnells sont tombés sur les
casemates. Un habitant de la ville qui se rendait au Sacré-Cœur pour faire
baptiser son enfant est mortellement blessé.
Le 31 janvier. La ville entière reçoit encore des obus et vers 8h 00,
c’est un tapage infernal. Au Sacré-Cœur, on a ouvert une quatrième salle pour
les typhoïques.
Le 1er février. Les Anglais arrivent en ville et une
ambulance s’installe dans l’aile gauche du Sacré-Cœur. Le bombardement se
dirige bientôt de ce côté cependant que notre artillerie lourde nous empêche de
dormir. Les tranchées, prises par les Allemands vendredi, sont reprises mais
ils se sont rapprochés de la ville du côté de St-Eloi et Zillebeke.
Ils ne sont plus qu’à quatre kilomètres.
Le 2 février. Quelques shrapnells et obus brisants viennent retomber sur
la ville. Une ambulance militaire s’installe à l’hospice Saint-Jean. Le soir on
y transporte quelques blessés. Les docteurs commencent les injections du virus
de la fièvre typhoïde. Mr le Curé, l’abbé Declercque
et Mr l’avocat Reynaert ouvrent la série. Le soir, Mr
le docteur Smerdon vint nous injecter au couvent.
Le 3 février. La nuit a été calme, heureusement car personne n’est à
l’aise ; c’est l’effet de l’inoculation. Nous recevons aussi la visite de
la comtesse d’Ursel. L’on sonne vers 5 heures et l’on
va ouvrir. A notre grande surprise, nous voyons toute une compagnie de soldats
anglais qui vient loger chez nous. Ils sont plus de 200. C’est la 2ème
Life Guard de la 3ème A.P. Sœur
Marguerite, Francisca et moi, nous leur donnons de la
paille et de l’eau, notre seule richesse hélas, mais combien ils en sont
heureux de l’avoir ! Sœur Francisca est vraiment
une mère pour les soldats et nous sommes occupées jusqu’à 11 heures de la
nuit.
4 février. Toute la nuit a été agitée car des obus sont tombés.
Le 5 février. La nuit a été très mauvaise surtout pour nous. Notre
chapelle est bombardée et l’on venait justement de bien la réinstaller pour que
Mr le Curé puisse faire la messe chez nous. Vers 2 heures de la nuit, les
gendarmes Verfaille et Henry viennent me demander du
secours pour une maison de la rue de la petite prison, chez les époux Muylle-Pinet. Un obus est entré
dans la chambre et a passé juste au-dessus du lit alors qu’ils étaient tous les
deux couchés. Ils ont été tués par le déplacement d’air. Comme c’est au premier
étage, c’est dangereux d’y rester car le plancher menace de s’effondrer. En effet,
vers six heures, on vint nous dire que tout s’est écroulé. Tragique
tableau ! La Chapelle des Sœurs Noires aussi a été bombardée et, dans
toute la ville, il y a de nouveaux dégâts.
Le 7 février. L’on n’entend rien nulle part. L’on pourrait croire que la
guerre est terminée mais le soir cela recommence un peu partout. Dans l’église
d’Elverdinghe, un prêtre soldat est grièvement blessé
pendant qu’il disait la Sainte Messe. 
Elverdinghe : Ruines de l’église
Le 8 février. La nuit a été assez calme mais vers midi, il y a quelques
obus qui tombent dans l’école de bienfaisance et au château d’Annette. Sœur
Antoinette et Marie Van Uxem aménagent une classe
dans l’école gardienne. S’ouvrira-t-elle demain ?
Le 9 février. Les soldats anglais partent tous aux tranchées mais avant
de partir, ils me demandent tous un souvenir. Bientôt d’autres viennent les
remplacer. Il y a un blessé près de l’église Saint-Pierre. Mr Vianen ? Nous allons, nous aussi, vacciner du côté de Zillebeke.
Le 10 février. Plusieurs bombes sont lancées par les taubes dans la rue
du Lombard mais il n’y a pas de nouveaux blessés.
Le 11 février. Il tombe quelques shrapnells et obus. Il y a
malheureusement beaucoup de blessés et une maison s’est effondrée. C’est
effrayant ; il y a cinq personnes tuées, un homme est grièvement blessé
près du château d’eau. Dans la soirée, on vint sonner pour nous demander
d’aller donner des soins à un blessé, rue des Trèfles. Je suis à peine de
retour que l’on resonne pour aller près des remparts
mais l’on nous apporte des blessés. Ils sont trois. Je fais les pansements et
bientôt, on nous apporte huit morts. Après les avoir fait déposer dans le
préau, je cours chercher de l’aide au Sacré-Cœur et bientôt nos blessés sont
transportés au Sacré-Cœur. Triste course dans la nuit sombre et sur une route
toujours bombardée. L’on ne peut imaginer cela sans l’avoir vécu ! Il
paraît que l’on a été bombardé par un train blindé allemand et l’on apprend
bientôt que les Anglais ont fait sauter les rails.
12 février. Il fait beaucoup plus calme et l’on voit que la pauvre ville
d’Ypres se meurt de plus en plus.
13 février. A 8h 00 service d’enterrement de 8 victimes. La chapelle des
Sœurs Noires est trop petite pour contenir tout le monde. Triste cérémonie.
14 février. Il y a un gendarme
tué, rue de Lille. Il y a beaucoup de malades depuis deux jours et on ne fait
qu’évacuer vers l’hôpital de Saint-Omer.
15 février. 152 personnes sont venues se faire injecter. Nous en avons
déjà 1.100 depuis le 27 janvier.
16 février. Il fait calme en ville. Chaussée de Kemmel, beaucoup de
maisons sont détruites. Un capitaine de l’armée anglaise vient trouver Mr le
Curé pour lui demander des femmes pour laver le linge des soldats. La caserne
Marie-Henriette est choisie pour aller recueillir douze femmes dans le
quartier. Les conditions suivantes sont fixées. Les ouvrières seront des femmes
mariées et il leur est interdit de faire des corvées. Elles entrent à la
caserne les mains et poches vides. Elles recevront 4 centimes par jour et le
repas de midi. Le travail commence à 7h00 du matin et se termine à 16 heures.
Un soldat sera chargé d’apporter l’eau. Aucune ouvrière ne quittera le travail
sans la permission d’un surveillant qui sera un soldat baïonnette au canon.
C’est ce qui s’appelle du travail règle militaire. 
Ypres, la caserne d’infanterie avant la guerre 
Ypres, la caserne d’infanterie après les bombardements du printemps 1915 17 février. Nous avons toujours des soldats chez nous. A la caserne, le travail va à merveille. je reçois aussi des nouvelles de mon frère Joachim. Le 18 février. Nos soldats nous quittent mais vers 18 heures d’autres nous reviennent. Toujours beaucoup de monde pour être vaccinés. Bruit de canon et explosions. On dirait un orage dans le lointain. Je reçois aussi une lettre de mon président de Paris. Le 20 février. J’accompagne les docteurs en ville à la recherche de malades. Nous en trouvons partout et parfois dans un triste état. Tristes choses ! 22 février. Apres avoir fait les pansements, nous retournons finir notre tournée en ville que l’on n’a pas terminé la veille. Les boches ont pris 2 tranchées aux alliés. Nos hôtes qui étaient en repos sont repartis à la rescousse car ils veulent les reprendre à tout prix. Les obus tombent de tous les côtés et il en est un près de la Porte de Lille qui n’a pas explosé. Des imprudents ont cherché à le dévisser et il a explosé en faisant plusieurs tués : Emile Crepel est mis en pièces et Thomas Deriddere est écrasé contre un mur. Le petit Albert Hoornart est blessé grièvement par son imprudence. 23 février. Parmi les civils, nous n’avons pas beaucoup de nouveaux blessés mais les ambulances militaires sont bondées. Vers 11 heures, Mr le Doyen vient dîner chez nous. Le 24 février. Une maison s’est effondrée dans la Kruisstraat. Il neige toute la journée. Pendant la nuit il nous arrive de nouveaux soldats en repos. Le 25 février. Il fait assez calme. Nos hôtes ont trouvé l’endroit où les Sœurs cachent les costumes pour des représentations théâtrales. Les officiers et soldats des environs mais aussi nous toutes, sommes invitées. M. le Brasseur Gilbert leur a fait don d’un tonneau de bière et Mlle Leys leur donne des friandises. Il y aura même du vin. Vers 9 heures, à notre grand regret, nous les quittons. Le 26 février. Le bombardement recommence. Près de la gare, il y a plusieurs tués et blessés. Vers 8 heures du soir, je vais chercher le docteur Thomson pour faire un accouchement (Breilen Poortje). Arrive l’enfant avant que le docteur n’arrive. Il s’occupe de la mère pendant que m’occupe du nouveau-né. La misère de ses pauvres gens est grande. Le docteur et moi, avons un grand tablier sur les genoux et on a l’air plus de fermiers que de docteurs. Mr Thomson rit de bon cœur et me dit : « Vous n’êtes plus infirmière maintenant, mais sage-femme. » Vers 11 heures on me reconduit au couvent où l’on m’y attendait avec une certaine inquiétude car jamais je ne suis partie si longtemps sans motif grave. Le 27 février. Il y a beaucoup de mouvements en ville. Les Halles sont remplies de soldats. Au soir, Mr le Curé demande des Sœurs Marguerite et Berchmans d’aller faire une commission. Elles reviennent et disent qu’il y a un espion derrière la maison Fraipont. Je me rends aussitôt dans cette direction tenant dans ma poche mon révolver. Les soldats français se trouvent là aussi et l’un deux me dit ; « voyez, Madame, cela bouge ! » Il a l’idée qu’un traitre se trouve sur le toit. Je m’énerve et dis : « Il n’y a personne qui monte ? – Oui, Madame mais c’est dangereux ! – C’est vrai, dis-je, mais tout est dangereux en temps de guerre. » Comme j’approche de la porte pour monter on me dit que des soldats et officiers anglais sont montés et bientôt l’on entend des éclats de rire et Mr Vaniveucrie me dit : « Ne vous tourmentez pas Mademoiselle, car le fameux espion n’est autre qu’une toile qui s’est déclouée sur le toit. » Quand j’arrive à la maison, tout le monde est curieux de savoir les nouvelles et tout le monde rit de bon cœur jusqu’à ce que Mr le Curé se moque de ma vivacité. Le 28 février. Pas de nouveaux blessés et je vais passer l’après-midi à l’hôpital Godelieve. 1er mars. La situation ne change pas. Je reçois quelques cartes de ma famille. Quelques obus sont tombés et Mr le Curé reçoit la visite de Mr le comte de Beaumont et de Mr chopart. Il lui offre un château en Normandie pour recueillir les orphelins d’Ypres. Pendant toute la nuit, il tombe des obus mais heureusement dans les ruines. Le 2 mars. Le bombardement continue. Je fais des pansements jusque 11 heures et vais ensuite avec un infirmier dans les maisons qui doivent être désinfectées. Plusieurs taubes survolent la ville dans l’après-midi pendant que nous vaccinons. Nous sommes photographiés : beau mais terrible souvenir. Le 3 mars. L’on évacue tous les réfugiés des environs. Il tombe encore quelques obus. Nous recevons la visite du duc d’Ursel et de sa cousine, la comtesse L. et Ursel. Ils vont nous faire parvenir des dons pour nos pauvres. Le 4 mars. Le quartier est encore fort éprouvé et les obus y tombent de tous les côtés. Le docteur vient me chercher le soir pour aller faire quelques visites à nos malades. Le 5 mars. Les obus ne cessent de tomber ainsi que des shrapnells. Nos soldats reviennent en repos et ils ont un tué et douze blessés. Ils ont fait sauter une tranchée des boches à la dynamite. Le 6 mars. La nuit a été très mouvementée aux tranchées mais dans la ville nous n’avons pas à nous plaindre. Vers 8 heures du matin, Mme la comtesse d’Ursel arrive avec une amie, Mlle Van Hemelrick. Elles aident sœur Marguerite à distribuer des vêtements aux pauvres. Le 7 mars. Il fit assez calme. Les Anglais ont des nouvelles pièces qui vont disent-ils faire de la bonne besogne. Le 8 mars. Nous recevons encore quelques obus et shrapnells. On évacue beaucoup de monde. Madame D’Ursel vient encore une fois nous rendre visite avec deux autres dames. Je vais aussi jusque Vlamertinghe avec les autos reconduire des réfugiés qui partent pour la France. Le 9 mars. L’on évacue toujours les réfugiés et l’on trouve encore des malades. Le 10 mars. La nuit est calme. Mr le Curé part pour St-Omer où il espère trouver des logis pour ses orphelins. Nous avons beaucoup de monde pour être vaccinés et l’on apprend aussi que les anglais ont pénétré dans les lignes boches à Wyschaete. Tout le monde est heureux ! Je reçois aussi une lettre de mon cousin Ernalsteen qui est sergent et se trouve pour le moment à Carteret. Le 11 mars. L’on vaccine toujours. Il tombe bien des obus mais nous n’avons pas de nouveaux blessés. Je reçois aussi une lettre de mes amis de Dunkerque. Le 12 mars. A 7 heures du matin, il m’arrive déjà des blessés à cause des obus tombés la nuit. Toute la journée, il ne cesse de tomber tout de sortes de projectiles. Je reçois aussi une lettre de mon frère Joachim. Le 13 mars. Il tombe encore obus et shrapnells. Il y a encore de nouveaux blessés, cela ne nous change guère. Le 14 mars. On recommence à bombarder plus fort et toujours des blessés. Quand donc finira ce carnage ? 15 mars. Il fait un peu plus calme mais vers 4 heures du soir, le bombardement devient terrible. Du côté de la gare, il y a 15 tués et 20 blessés. C’est horrible à voir, partout il y a des traces d’obus. Le 16 mars. Il fait plus calme. C’est le calme après l’orage. Le 17 mars. Les canons tonnent et cherche à atteindre le ballon captif boche. Je rencontre deux gendarmes, un adjudant et un maréchal des logis qui sont attachés à la 28ème D.A. anglaise et qui me demandent des renseignements sur les ambulances anglaises qui se trouvent dans la ville car ils doivent rechercher une ambulancier soi-disant belge et qui paraît un espion. Je me rappelle l’avoir vu plusieurs fois. Nous sommes mis à sa recherche mais l’oiseau s’est envolé. J’ai quand même le bonheur de le faire arrêter plusieurs mois plus tard lorsque je me trouvais à Rouen. Le 18 mars. La situation n’a pas changé et le soir nous avons des nouveaux soldats pour venir loger. 19 mars. Fête de Saint joseph, patron de notre chère Belgique et qui est aussi le mien. Je reçois quelques petits cadeaux et souvenirs de tout le monde mais j’ai aussi à la suite d’un pansement à une blessure infectée des boutons sur les mains, les jambes et sur mes yeux. A peine je vois clair. Cela me gêne pour faire mes pansements car j’en ai moi-même. Le 20 mars. Une lutte aérienne s’engage entre quatre avions alliés et cinq boches. Ces derniers sont obligés de se retirer dans leurs lignes. Les autres docteurs, sachant que c’était ma fête m’apportent aussi des souvenirs. Les boches aussi m’en envoient car quelques obus éclatent dans notre jardin. Je reçois aussi des cartes de ma famille. Le 21 mars. Il fait un temps superbe. Aussi là-haut, on chasse aux avions. Nous avons aussi des tués et blessés. Au loin on voit, le ballon captif français. C’est la première fois que je le vois. 22 mars. Nous avons beaucoup de malades et de blessés. Je fais une petite opération. J’enlève un petit shrapnell dans la cuisse d’un petit garçon. Le docteur Manny me félicite et, lui aussi, enlève des fragments dans la tête d’un homme. Nous sommes fort occupés quand on vient nous annoncer que nous allons avoir la visite de Mr le Ministre de la Guerre. En effet, peu après, Mr de Broqueville arrive, accompagné de Mr le commandant de Launnoy et du comte de Lichervelde. Le ministre nous sert la main en disant : « jamais nous n’oublierons ce que vous avez fait (à Ypres). Le 23 mars. Il y a beaucoup de mouvements de troupes en ville et j’ai le pressentiment qu’il se prépare quelque chose de grand. Je n’ose le dire aux Sœurs de peur de les inquiéter. De temps à autre, on entend le canon. L’on fait toujours des injections à domicile. Le 24 mars. Les soldats Français nous quittent mais ils sont remplacés par des Anglais. On trouve encore quelques typhoïques. Vers le soir, j’ai la fièvre et je crains à mon tour d’être malade. Voilà qui ne fait pas mon affaire. Le 25 mars. Je me lève comme d’habitude vers 6 heures mais la tête me fait fort mal et quand les docteurs arrivent vers 9 heures, je dois me mettre au lit. 26 mars. Je garde toujours le lit. Maintenant je souffre beaucoup et peut à peine me bouger. Je suis tombée raide et les Sœurs sont à deux pour me soulever pour me donner à boire. De me voir dans cet état, je pleure à chaudes larmes. Le 28 mars. Cela ne va pas beaucoup mieux. Je reçois aussi une lettre de mes parents. J’apprends ainsi que Gilbert Chemez est à dunkerque en traitement sur le navire hôpital « Stad Antwerpen ». Dans la ville, il tombe quelques bombes d’avions boches. Le 29 mars. Je vais un peu mieux. Je reçois quelques lettres, ce qui me fait grand plaisir. Il tombe plusieurs shrapnells et plusieurs chevaux de l’armée anglaise sont tués. Il y a aussi quelques blessés du côté de la Kruisstraat. Le 30 mars. Je vais beaucoup mieux et peut me lever mais ma tête tourne. Je suis comme une femme qui est prise de boissons. Le 31 mars. Les ouvriers ont trouvé en déblayant les ruines du couvent des Sœurs Noires le corps de Céline Pladys, leur servante qui a été tuée le 11 novembre, lors de mon arrivée à Ypres. L’on vient me dire qu’il y a aussi un homme de blessé, rue de la Plume. Après m’être habillée comme si je partais au pôle nord, je vais trouver mon bonhomme. Il est dans un triste état car il souffre beaucoup. Il a reçu un boulet de shrapnells en travers le coude du bras gauche. Je fais son pansement et vais aussi à l’hôpital où on le fait passer au rayon X. Il a l’os complètement brisé. A mon retour, je reçois des nouvelles du Havre. Le 1er avril. L’on ne pense guère aux poissons ! Le bombardement a complètement cessé malgré que la ville soit pleine de troupes anglaises. Le 2 avril. Le temps est superbe. Beaucoup de soldats sont venus s’installer chez nous et nous recevons la visite de Mme la comtesse d’Ursel et de quatre dames amies. Elles nous apportent des tas d’effets et de denrée coloniale pour environ trois mille francs. Le 3 avril. L’on distribue toujours des vêtements. C’est une grande corvée pour Sœur Marguerite. Le 4 avril. Les boches ont enlevé une tranchée aux anglais. Cela va encore nous faire entendre le canon mais la journée est calme. Vers 10 heures de la nuit, je venais à peine de m’endormir, que j’entends un coup formidable. Je me réveille brusquement et me fais la réflexion que j’ai rêvé mais un 2ème 3ème et finalement, je ne les compte plus. Comme depuis que j’ai été malade, je loge au 2ème étage, j’entends encore mieux qu’à la cave. Les murs de ma chambrette tremblent et je suis secouée dans mon lit comme une feuille sur l’arbre. J’entends un bruit de pas dans la maison. Ce sont des soldats qui sont descendus dans nos caves. J’ai envie de faire la même chose mais il fait bien froid et j’ai peur de tomber à nouveau malade. Je me recouche. Le matin les docteurs se moquent de moi en disant que je n’ai pas peur des bombes mais que j’ai peur du froid. Il y a plusieurs tués et blessés dans une ambulance anglaise. 5 avril. Je pars à Dunkerque pour aller toucher un mandat que mes parents viennent de m’envoyer chez Mr Goris car il est impossible de le transmettre à Ypres. Je pars avec les Sœurs Marguerite et Vincente qui vont à Poperinghe. Je passe la nuit avec elles. Le 6 avril. Une voiture arrive d’Ypres et me disent que notre couvent a été bombardé. Il me prend l’envie de retourner à Ypres mais je serai quand même obligée d’aller à Dunkerque. Sœur Marguerite arrive et me dit qu’il y a une trentaine de tués et beaucoup de blessés parmi les soldats qui étaient chez nous. Elle me conseille de me rendre vite à Dunkerque et de revenir vite car tout le monde regrette mon départ. Comme elle se rend à Wisques conduire des orphelins, je monte en voiture jusqu’à Hasbroeck et de là je prends le train pour Dunkerque. J’ai toutes les peines du monde à obtenir un laissez-passer. La commission spéciale de la gare me fait subir un interrogatoire en règle car elle croyait avoir affaire à une espionne. Quand je lui fais voir mes papiers, on me fait des excuses. Pour se faire excuser, on me propose de me présenter à des dames anglaises à la cantine. Elles me demandent des nouvelles de Belgique et quand le train arrive, nous étions les meilleures amies du monde. 7 avril. Après avoir fini mes affaires, je me rends au port pour aller au bateau-hôpital mais on ne me laisse pas passer ! Je vais dans tous les bureaux mais impossible d’obtenir la permission. L’idée me vient d’aller à l’Etat-Major belge et là, je fus bientôt en règle. Quand j’arrive sur le bateau, l’on me dit que Gilbert Chomez a été transporté à l’hôpital, rue du fort Louis pour y être opéré. J’y arrive enfin vers 14h 30. Il a été bien étonné de me voir et me dit qu’il va être opéré le lendemain. Le 9 avril. Je vais voir comment il va. Il est très mal et je lui promets de revenir demain. Rentré chez mes amis, quelque chose me dit que je dois retourner à Ypres. Le 10 avril à 7 heures du matin, je prends le train pour Hazbroeck et de là jusque Vlamertinghe. J’arrive enfin à Ypres. Mes pressentiments ne m’avaient pas trompée. L’on m’avait signalée comme espionne car j’avais quitté le couvent juste avant le bombardement. Des gens disaient même que je faisais des signaux aux allemands en brûlant des pansements. Je vais trouver le lieutenant de gendarmerie Vansluiys et l’adjudant Delattre. Je leur dis les soupçons qui pèsent sur moi et comme j’avais les larmes aux yeux, Mr Vansluiys me dit : « Vous avez bien fait de venir dire cela ; comme cela, nous pourrons faire taire la langue des gens mais surtout ne vous faites pas de peine pour cela.» Les Sœurs et le Curé était contents de me revoir et, en m’ouvrant la porte, ce ne fut qu’un cri : « notre espionne est de retour et donc il n’y a plus de dangers ! » Cela n’empêche pas les taubes de venir nous lancer des bombes mais il y en a un d’abattu à Boesinghe. Le 11 et 12 avril. Le temps est très beau mais rien de nouveau dans la ville sauf les commentaires qui vont bon train car on m’avait dit que j’avais été jetée en prison à Dunkerque. Et même une réfugiée qui ne me connaissait pas me dit : « Vous ne connaissez pas la demoiselle de la Croix-Rouge, rue de Lille ? Il paraît que c’était une espionne mais qu’on l’a arrêtée et qu’elle est en prison à Dunkerque. – Je voudrais savoir, dis-je, par qui vous êtes si bien renseignée, car l’espionne c’est moi et jusqu’à présent je n’ai pas encore été en prison. » Je n’ai jamais vu une femme aussi gênée ! L’on me dit aussi que j’avais fait des aveux. 13 avril. Les taubes reviennent survoler la ville et nous lancent quelques bombes. Ils ne viennent jamais les mains vides, ces Messieurs. Tous les réfugiés qui vont partir pour la France sont dans notre ouvroir en attendant les voitures. Je suis occupée à faire les pansements quand un obus tombe près de la maison. Tout le monde se sauve et nous avons, Mr le Curé, les Sœurs et moi, toutes les peines du monde pour les calmer. Enfin les voitures arrivent et tout le monde part quand on vient me dire qu’il y a un blessé aux casemates. Je vais le panser et faire une tournée en ville. Je reçois aussi une lettre de mes parents. 14 avril. Il nous arrive un nouveau docteur, Mr Rees. Le docteur Foch va aller en ville et le Dr Manny à Poperinghe. C’est tout un changement même que les visites vont se faire dans l’après-midi. Pendant la nuit un zeppelin passe sur Vlamertinghe. Je reçois une lettre de mon Président. Le 15 avril. Il y a plusieurs bombes qui tombent sur la ville. Un imprudent nommé Michel Ossier a eu les jambes enlevées et mourut peu après. Quand auront-ils assez d’intelligence pour ne plus toucher à ces dangereux engins qui ont déjà fait tant de victimes ? 17 avril. Tous nos soldats nous ont quittés sauf les postiers. Ils me disent que je ne dois pas avoir peur mais, qu’à 7 heures, l’on va faire une attaque générale. En effet, juste à 7 heures, le signal est donné et les canons tonnent tandis que le train blindé et les mitrailleuses font un vacarme épouvantable. Dans la cuisine, pendant que nous dînons, il nous est impossible de nous entendre. Les Anglais lancent une trentaine de projectiles au moment où je suis juste dans mon lit. 18 avril. Il fait plus calme mais vers 8 heures, cela recommence encore plus fort que la veille et nous apprenons que les alliés ont repris cinq tranchées vers Ghehuvelt. Vers 7 heures du soir, il tombe encore quelques obus et shrapnells jusqu’à minuit. Le 19 avril. Nouvelle attaque mais cette fois, les Allemands veulent nous faire payer bien cher leur défaite d’hier. Le premier obus tombe près de l’école de bienfaisance et il y a plusieurs tués et blessés. Vers midi, c’est notre quartier qui reçoit sa part. Il en est un tombé rue Basse et il y a plusieurs blessés et tués, presque tous des enfants. Bientôt un autre tombe rue de Lille et là il y a un jeune homme grièvement blessé. Je cours de suite et je suis seule dans une cave avec lui et il rend son dernier soupir. Il y a également une femme et un enfant blessé dans la même maison. J’ai à peine fini les pansements qu’on vient de nouveau me demander du secours pour un obus tombé près de la brasserie Boone. Melle Van Uxem est blessée, une femme et plusieurs enfants aussi, ainsi que deux officiers anglais dont l’un meurt bientôt dans l’ambulance française de la 81ème D.A. Il y a beaucoup de nouveaux blessés et malheureusement de nombreux tués. Pauvres soldats ! Malgré leurs blessures reçues au front, ils sont encore tués dans les ambulances. Le 20 avril. Le grand bombardement d’hier provoque des départs parmi les Sœurs. Sœur Jeanne et Sœur Vincenta ainsi que les Sœurs de l’école St-Joseph partent pour Poperinghe. Vers 9 heures, c’est terrible, il y a des morts et des blessés partout et nous recevons jusqu’à 150 obus en une demi-heure. Les Sœurs les comptent sur les grains de leurs chapelets. Je me rends au bureau de patrie chercher un laissez-passer pour Mme Levys. Pendant que j’attends mon tour, j’entends un coup formidable de la grand Place. Tout le monde se sauve et je cours vers la Grand-Place. Là un affreux spectacle s’offre à mes yeux. Un obus de gros calibre (un autrichien) est tombé sur l’hôtel de la Châtellenie et l’a complètement détruit. Beaucoup de civils qui se trouvaient sur la place sont blessés et même tués. Je fais transporter les blessés à l’Ambulance militaire anglaise installée in den Bel… Pendant que je fais leurs pansements, un obus tombe dans la cours alors, la panique est générale. Aidé par quelques infirmiers anglais, j’ai toutes les peines du monde à tenir nos blessés en place et il y en a même un qui est tellement saisi qu’il en perd la raison. Je me dépêche de finir leurs pansements. J’ai hâte d’aller voir après mes amis les gendarmes qui se trouvaient près de la Châtellenie. Au moment où je voulais y aller, un autre obus tombe sur une seconde ambulance anglaise qui est installée dans l’école Ste-Elisabeth. J’y trouve plusieurs blessés et bientôt des soldats viennent à mon aide. Pendant que je fais les pansements, un obus tombe sur la maison et nous roulons l’un sur l’autre, ce qui nous fait rire après avoir fait pareille culbute mais, sur le moment, j’ai cru ma dernière heure arrivée. J’apprends bientôt que les gendarmes venaient de quitter l’hôtel cinq minutes avant que l’obus ne tombe. Je suis toute heureuse de l’apprendre et remets donc ma visite et m’occupe de mes blessés. Je cours au Sacré-Cœur demander des voitures sous une vraie pluie d’obus. J’y retourne ensuite en voiture avec des blessés. Ce sont des enfants. J’en tiens un sur mes genoux et un autre dans mon bras. Des larmes me montent aux yeux de me voir impuissante pour calmer la douleur de ces pauvres petits qui ne cessent de réclamer leur mère, elle aussi, blessée. Je retourne à la Place où je vois un képi de loin. Ils font signe et quand ils me voient, ils sont surpris de ma pâleur : « Grand dieu, qu’avez-vous me disent-ils. – J’ai eu peur. – Vous peur ? me répond le chef. – Oui chef, J’ai cru que vous étiez tous les quatre tués. – Vous savez bien qu’on ne peut pas nous toucher. Les boches le savent bien et (…). » Le bombardement n’arrête pas une minute même de toute la nuit et malgré mon insouciance, je déménage et reviens loger dans la cave près de nos bonnes petites Sœurs qui ne veulent plus que je loge là-haut. Vers minuit il faut quand même un peu plus calme. 21 avril. Vers 4 heures du matin, l’on recommence plus fort que jamais. Je vais conduire des réfugiés à Poperinge. Quand je reviens, je fais plusieurs pansements en ville car j’ai conseillé à mes blessés de rester dans leurs caves pour ne pas avoir d’autres blessures. J’ai beaucoup de besogne car je suis seule maintenant pour faire les pansements. Le 22 avril. Il fait un peu plus calme. Je retourne à Poperinge avec des réfugiés. Je vais aussi à l’hôpital Elisabeth et dîne avec sœur Lucie. Je reviens ensuite à Ypres avec une voiture et des commissions à apporter à Vlamertinghe. Je suis à peine de retour en ville que l’on recommence à bombarder. Il faut croire qu’ils attendaient mon retour et plusieurs obus tombent dans la rue de Lille et il y a plusieurs blessés. Bientôt le collège ainsi que le couvent des Sœurs de charité prennent feu. Dans la ville, l’on ne voit que des incendies partout et l’on se croit à nouveau dans le terrible mois de novembre dernier. L’on reçoit aussi des gaz asphyxiant et ce n’est pas cela qui va nous remettre de l’air car bientôt tout le monde se plaint des yeux et de la gorge. Il nous arrive quelques soldats français et anglais atteints par les gaz. Nous leur donnons du lait chaud avec du sel pour pouvoir vomir. 23 avril. Tout au matin, je me rends au Sacré-Cœur pour chercher des voitures. Le bombardement est toujours très fort. En route j’entends un appel au secours et je vois alors un monsieur qui a plusieurs blessures au bras et sur la tête. Je reconnais que c’est le greffier du tribunal. Il a aussi plusieurs dents cassées dans la bouche. Je l’aide et entré sous la grande porte de la prison, je fais un pansement quand un obus tombe dans la cour et nous sommes environnés d’éclats de toutes sortes. Après le dîner, Mr le Curé, Sœur Livine, Sœur Marie Berghmans et moi allons enlever les objets de valeur qui sont restés dans le couvent des Sœurs de Saint-Joseph. J’y trouve une petite échelle qui fait mon affaire et j’enlève tout le chemin de croix que les Sœurs portent ensuite en lieu sûr. Après avoir enlevé tout ce qui se trouve dans la chapelle, nous montons au premier étage et nous enlevons tout ce que nous pouvons des chambres. Je suis encore toute seule en haut et Mr le curé est parti éteindre le feu avec son ouvrier, joseph Cottenier, lorsque je vois sur un bahut qui se trouve sur un petit palier un grand Saint Joseph. Je dis lors tout haut comme si il pouvait me comprendre : « Mon petit bonhomme, toi tu ne vas pas rester là ». Je le prends et veux le soulever mais il ne bouge pas. Je le reprends et c’est la même chose, alors je m’énerve et le prend à plein bras et c’est alors qu’il bouge et je sens que je ne pourrai le mettre à terre. Je me sens partir et me vois déjà la tête cassée au bas de l’escalier alors je dis : « Mon Saint Joseph, épargnez-vous mais moi aussi car à Ypres, il y a encore beaucoup de malheureux qui ont besoin de moi. » Alors tout doucement, je tombe par terre sans me faire aucun mal avec mon Saint Joseph toujours dans les bras. Mais il m’est impossible de bouger et je me mis à crier. Mr le Curé arrive bientôt et me voyant dans une telle position se mit à rire en me disant : « Mademoiselle, qu’avez-vous encore fait ? » D’un mot je lui explique ce qui vient de m’arriver. « Alors, dit-il, nous porteront à deux Saint-Joseph en lieu sûr. » Cela fait, quand tout fut placé dans la cave, nous retournons à la maison. Nous y sommes à peine, que l’on vient me chercher pour un homme blessé rue de Dixmude. Quand je reviens, on me dit que le feu est dans la tour de l’église Saint-Jacques. L’ouvrier de Mr le Curé et moi, nous y montons mais nous sommes obligés de redescendre car la fumée nous prend à la gorge et nous ne savons plus respirer. De temps à autre, nous sommes même secoués comme une barque en mer par les vagues. 24 avril. A 6 heures du matin, on m’apporte déjà des blessés. Je fais leurs pansements puis je vais ensuite chercher une voiture mais je marche sous un vrai orage d’obus qui éclatent à 30 ou 50 mètres de moi. Près du pont, ils tombent de chaque côté et je croyais ma dernière minute arrivée. Arrivée au Sacré-Cœur, tout le monde est parti. Les docteurs ont fait un poste de secours 2 kilomètres plus loin à St-Augustinus. Là, ils sont bien surpris de me voir à cette heure et par un tel bombardement. Les docteurs me dirent que de rester chez eux pendant le bombardement. Je leur dis « non » car je dois retourner coûte que coûte. Ils me répondent que je vais me faire tuer mais n’écoutant rien de ce qu’ils me disent, je pars. Devant, derrière, à gauche, à droite, je suis entourée par les obus et plus d’une fois je dis mon acte de contrition et pense alors à tous ceux qui me sont chers et que je ne verrai plus. Quand j’arrive à la maison, il me semble que j’ai fait un affreux cauchemar et je ne peux croire tout ce que j’ai vu. Les Sœurs me dirent : « comme nous avons eu peur pour vous ! Et comme nous avons prié pour vous ! » – « Chères Sœurs, répondis-je, sans vous, je ne serais plus ici ! » Toutes avaient les larmes aux yeux. A 7h 30, je vais à la messe et à la Ste communion. Quelques instants après, l’on vient le demander d’aller panser 2 personnes qui viennent d’être blessées dans la cave de la brasserie Gillebert. Je vais ensuite à la maison Boone faire des pansements. Vers le soir, quand je rentre, j’apprends que nous n’avons plus de pain. « Voilà qui est fort, dis-je, donnez-moi un filet, sœur Marie, et dans 20 minutes, je suis de retour ! » Sœur Marguerite veut m’accompagner mais à peine arrivés rue du Verger, elle veut faire demi-tour. Je lui conseille de le faire car le tableau est tragique. Toute la rue de la gare est en feu. – Si vous avez peur, retournez ma sœur,
lui dis-je. – Pas sans vous – Pas
avant d’avoir du pain dis-je, je suis seule et vous êtes six! – Puisque c’est ainsi, risquons notre
vie à deux, conclut sœur Marguerite. Nous filons au pas de course. En passant devant la gare, nous voyons les cadavres de 7 personnes qui ont été tuées au matin. En revenant à la maison sous une pluie d’obus, j’y trouve trois petits gosses blessés. Après avoir fait leurs pansements, je cours à Saint-Augustinus chercher une voiture sous une vraie rafale de mitrailles et j’entends le bombardement se diriger vers la gare. Personne le croyait encore pouvoir me voir vivante à la maison. Jamais je n’oublierai cette course tragique et, souvent, je sentais mes cheveux se dresser sur ma tête et un froid passer dans le dos. Je crois même que l’on peut appeler cela le frisson de la mort. En rentrant en ville, je vois deux gendarmes qui ne veulent pas croire d’où je viens (St Augustinus). L’adjudant Delattre me dit : « Madame, je ne vous vois pas sortir vivante de la ville ; il faut vous épargner un peu. Vous n’êtes pas raisonnable car vous allez vous faire tuer. – Ce qui me console, c’est qu’ils ne me tueront pas deux fois, dis-je. » Comme les voitures ne sont pas encore arrivées, je porte un enfant à bras jusqu’aux casemates et un homme en porte un deuxième. L’église Saint-Jacques prend entièrement feu et les obus incendiaires tombent partout en ville. L’on ne voit plus que des gerbes en feu. A 8 heures du soir, je rentre enfin à la maison. Je me suis fatiguée depuis 05 heures du matin et je n’ai fait que courir. 25 avril. A peine, si je sais marcher car mes jambes sont raides et mes pieds gonflés et pourtant je veux continuer ma triste besogne. Les obus continuent de tomber de tous côtés et pendant que j’écris ces quelques lignes, les éclats volent sur la table dans notre salle de visite. Le Palais de Justice prend feu à son tour et Ypres n’est plus qu’un immense brasier. A midi, Mr le Curé me demande si je veux aller ramasser les morts avec Joseph et Rodolph, ses deux ouvriers et inscrire les lieux où on les a trouvés. Partout il y a des cadavres de chevaux. Partout l’on voit aussi les maisons effondrées qui obstruent les rues. Nous trouvons le cadavre d’une femme au coin de la rue de Dixmude que je fais porter sous les portes des halles. La malheureuse avait encore dans sa main sa pelote de dentelière. Derrière l’église Saint-Martin, nous trouvons encore une femme. Au coin de la rue des Halles, nous trouvons le cadavre d’un soldat anglais, c’est un caporal du Royal Engineers et il s’appelle Walters. Il passe beaucoup de voitures de ravitaillement anglaises, chose qui doit être connue des boches car le bombardement redouble du côté de la Porte de Menin. 
Ypres : Porte de Menin
Un obus tombe sur nous et nous sommes couverts de poussières et d’éclats
et nous devons nous mettre à l’abri. Peu après, nous recommençons notre triste
besogne et nous trouvons le corps d’une femme qui a été tuée dans son fauteuil.
Nous rentrons à la maison mais à peine arrivés que l’on vient nous appeler, le
curé et moi, pour des blessés et tués dans la rue du Marché aux vieux Bois.
Nous y trouvons une vieille femme qui a presque la tête enlevée et une autre le
ventre ouvert. Un homme a une main enlevée et un bras arraché. C’est horrible à
voir. Nous repartons vers la maison mais à peine dans la rue Cour de Thourotte,
un obus tombe sur la maison d’en face et nous sommes couverts d’éclats. Mr le
Curé a son chapeau traversé de plusieurs morceaux. J’en reçois aussi un assez
grand tout brûlant sur mon pied mais grâce à mes guêtres, il ne me blesse pas
et je dis à Mr le curé : » Je crois que les Allemands veulent nous
faire goûter de leur mitraille… ». J’ai à peine dis le dernier mot qu’un
autre obus tombe sur le coin de la rue. Nous sommes fort indécis. Je demande à Mr
le Curé si nous allons par la place d’…. « Non, dit-il, cela serait
la mort certaine ».
– Je crois qu’en ce moment, la mort est partout répondis-je.
– Allons par la petite rue
Saint-Jacques dit Mr le Curé. »
A peine entrés, un obus tombe à 8 mètres et nous sommes projetés contre
une porte. Nous nous ne voyons plus l’un l’autre à cause d’un voile bleu.
Finalement, Mr le curé me distingue à
quelques pas de lui. Nous sommes à peine partis de quelques mètres qu’un autre
obus vient de tomber sur la place que nous venons de quitter. Mr le Curé me dit
que ce serait peut-être plus prudent de courir un peu. Il
ajouta :
« Mais ne m’attendez pas car je n’ai plus les jambes de vingt ans.
– Mr le Curé, dis-je, je sais
courir mais aussi ralentir. »
Ce fut encore gaiement que nous rentrons ainsi à la maison mais dans
quel état ! Les deux Sœurs ne nous reconnaissaient pas et nous avions
l’air plutôt de deux terrassiers que d’un curé et d’une infirmière ! Malgré tout, nous mangeâmes de bon appétit.
Pendant la nuit, plusieurs obus tombèrent dans notre chapelle ainsi que dans
celle des Sœurs Noires mais je n’entends rien de toute la nuit tellement je
suis fatiguée. 
Winthrop Young était le commandant de l’unité des ambulanciers et médecins quakers qui fournirent une aide essentielle à la population d’Ypres jusqu’au printemps 1915. 26 avril. Je vais faire mes pansements en ville car je suis toute seule. J’ai environ vingt blessés dans les caves un peu partout. Pendant que je vais à Vlamertinghe chercher des voitures, dans la rue du Beurre, je suis vraiment prise sous une rafale d’obus. J’entends un obus arriver et je n’ai presque pas le temps de me lancer sous la porte voutée qui sert de passage pour aller rue du verger. Je me dis que je dois pourtant m’en aller près de l’église Saint-Nicolas mais la rue est obstruée par des maisons écroulées et je suis obligée de passer par les murs de plusieurs maisons. Je suis enfin dans la rue d’Elverdinghem et j’y vois plusieurs cadavres et aussi quelques blessés. Avant d’arriver au pont du canal, je vois plusieurs obus tomber dedans. Je me dis « Joséphine, tu ne passeras pas. » A 30 mètres, un obus tombe moitié sur le pont, moitié dans l’eau. Quand je suis sur le pont, un obus y tombe également et je suis projetée quelques mètres plus loin par le déplacement d’air mais heureusement, il n’éclate pas, Dieu Merci ! Mon bon ange gardien a bien du mal pour me protéger, si bien que quand j’arrive à la maison, les Sœurs me conseillent de rester un peu chez moi mais, bientôt, on vient me chercher pour aller donner des soins à un blessé. Pendant que je passe près de l’école D’Aloyse, un obus tombe sur le coin. Je suis lancée sur les pavés. Je ne suis pas blessée mais j’ai mal partout. Comme j’arrive dans la rue de Lille tout en boitant, je vois des personnes qui me font signe. Je vois que c’est Mr Stoffel qui me demande de faire un pansement à son domestique qui vient d’être blessé. Il m’aide à le porter dans la cave. L’on vient bientôt à ma recherche car il y a de nouveaux blessés rue de Thourotte et je cours de droite à gauche avec mon sac de pansement sur le dos. Avec la permission de Mr le curé et du Lieutenant Vandensluys, j’installe un poste de secours dans la caserne. En me voyant avec deux filets, Mr Delattre me dit : « Ou allez-vous ? – Mais je vais chercher du pain, adjudant dis-je – Ou ça ? – Rue du Commerce, répondis-je ! – Mais mon enfant, vous allez vous faire tuer, il faut quand même vous épargner un peu ! – Pas la peine, adjudant, j’ai mon ange gardien pour cela et puis j’aime mieux mourir par un obus que par la faim, c’est moins long et puis j’ai Mr le Curé et les Sœurs à soigner. Ma réponse les fit rire. – Terrible enfant ! » Il tombe maintenant plusieurs obus près des étangs et dedans et je suis toute aspergée ainsi que mon pain. Les gendarmes occupés à prendre de l’eau me crient d’aller plus vite et de me mettre à l’abri chez eux. Je fais signe que c’est impossible, alors le maréchal de logis Thorelle vient à ma rencontre et me dit : « Vous allez vous faire tuer. Vous allez voir Mademoiselle ! – Vous voulez me faire peur, mon petit gendarme mais vous ne réussirez pas. – Je dirai comme les Anglais que vous êtes une terrible Mamzelle. » En arrivant à la maison, sœur Marguerite me dit que l’homme qui devait aller chercher la voiture pour les enfants qui étaient blessés chez nous n’a pas osé aller plus loin que la Grand-Place. J’en tombe en colère et comme il y a également une Sœur de Nazareth de blessée, je vais la chercher moi-même. Il y a autre chose : le commandant Young ne veut pas forcer ses hommes à venir dans un tel bombardement. Voyant cela, je sens les larmes me monter aux yeux, alors les chauffeurs qui étaient des braves me dirent : « Miss, montez en voiture, nous venons. » Le commandant vint même avec. Bientôt plusieurs de mes blessés partent à Poperinghe. L’on vint encore me chercher pour aller voir la femme du sous-commissaire qui vient d’être blessée. A sept heures du soir, j’ai enfin fini ; j’ai eu 25 blessés ! 27 avril. Tout au matin, l’on vient me chercher pour un blessé rue de Lille. J’ai à peine fini que vient me dire qu’il y en a un autre aux casemates et puis un autre Porte de Lille et un autre rue Saint-Jean. La journée commence ainsi bien tragiquement. Je suis obligée d’aller encore trois fois à St-Augustinus. Le 28 avril. Il fait un peu plus calme mais on reçoit quand même plus de 100 obus dans la journée. Mr le Docteur Faets est venu en ville voir mes blessés. Je suis photographié à plusieurs reprises près des blessés. « Souvenirs » dit-il ! Je vais ensuite chez Mr Vanvreem faire un pansement. Nous faisons un brin de causette et même une femme raconte que lorsqu’elle s’est sauvée de chez elle, tellement elle avait peur elle ouvrit son parapluie pour traverser la Grand-Place. Tout le monde rit de bon cœur. L’on entend tout d’un coup de grands cris. Je vais dehors et je vois un homme qui vient d’être grièvement blessé ainsi qu’une femme qui est dans un état pitoyable. Des lambeaux de chair tombent de ses cuisses et jambes et elle a tous les doigts de la main gauche enlevés. Dans son agonie, elle me dit : « je ne sais pas ce que j’ai, mais j’ai une soif terrible. » Je vais chercher Mr le Curé et bientôt elle rendit le dernier soupir. L’on vient me chercher pour une jeune fille de 18 ans qui a une jambe enlevée et la douleur de la mère faisait peine à voir. Alors je pense à la mienne qui ne me verra peut-être plus car j’ai le pressentiment que je vais être atteinte à mon tour. 29 avril au matin, à 4 heures, on vint sonner. Un obus est tombé sur la maison Baelde, rue des Trèfles. La femme est tuée ainsi qu’un enfant. Un autre est blessé ainsi que sa belle-sœur. La femme Baratte est également tuée. Les hommes Baelde et Baratte sont grièvement blessés. Apres avoir fait leurs pansements, je vais à Sint-Augustinus mais j’ai une grande déception car tous les docteurs sont partis à Poperinghe. En revenant je repasse par la rue de la Slabuises pour aller demander au lieutenant Vansluys que, si un gendarme va à Poperinge, il puisse y demander une voiture. La chose faite, je ne vois partout que des cadavres de civils et de militaires. Je trouve également une femme blessée près de la maison de Mr Leparcy. Quand j’arrive à la maison, les Sœurs me disent que l’on est venu me demander pour aller rue de Thourotte. J’y trouve un pauvre vieillard déjà malade qui vient de recevoir 8 blessures. Je reviens et comme je passe à la maison Hoflach, des personnes se trouvent sur le pas de la porte et me disent : « Vous n’avez pas encore fini et vous devez être bien fatiguée. – Oui, dis-je, ma journée est finie et je serai bien heureuse de pouvoir me reposer. » J’ai à peine prononcé ces paroles qu’un shrapnell arrive et éclate juste en face de la maison. Je crois être rentrée trop tard car je suis entourée de flammes et je sens une piqure dans ma cuisse et dans le mollet. « Godferdek », dis-je en rejoignant, remplie de colère le couvent. Mr le Curé me dit alors : « Qu’avez-vous pour être si fâchée ? – Mr le curé, les boches viennent de m’attraper. » Les Sœurs me font à mon tour un pansement et avec stupeur je vois que ma jupe est trouée à 8 places. Sans ma culotte de gymnase et mes molletières, mes blessures auraient été plus graves. A la gendarmerie, l’on a appris que Mr Delattre aurait dit : « Cela devait arriver, elle est trop audacieuse ». 30 avril. Toute la nuit, le bombardement a été terrible et au matin en me levant, ma jambe est toute raide et me fait beaucoup souffrir à tel point que les larmes me viennent aux yeux. Les Sœurs me conseillent alors de ne pas sortir aujourd’hui mais j’ai trop de blessés à soigner que pour songer à mes blessures. Je vais rue de Dixmude, rue Jansenius, faire quelques pansements pour aller ensuite sur la Place. Je voudrais courir mais cela ne m’est pas possible car ma jambe me fait trop mal. Les obus et shrapnells continuent à voler autour de moi comme des hirondelles. Sur la place Vanden Perreboom, un obus est tombé et il y a cinq personnes tuées, deux maisons éventrées par un trou de vingt mètres causé par un obus d’un petit Autrichien. Quand j’arrive à la maison, je vois une voiture d’ambulance qui m’attend pour aller chercher la dame du sous-commissaire. En revenant à la maison, je vois avec surprise les docteurs Fo… et Thomson qui sont venus nous voir avec leurs chauffeurs. Ils me félicitent et me disent qu’ils viennent m’opérer car ils avaient appris que j’avais été blessée. « Ma jupe, dis-je, mérite plus d’être opérée que moi, car elle a 8 blessures et moi je n’en ai que deux. » Je vais à la caserne et tout le monde est surpris de me revoir en me disant qu’on leur avait dit que j’étais grièvement blessée. Le 1er mai. Au matin nous allons à la messe dans la chapelle des Sœurs de Nazareth et cela sous une vraie rafale de shrapnells et d’obus. L’après-midi, je fais faire mon installation à la caserne. Je reçois les grands blessés et je demande à Mr Delattre si on peut aller chercher une voiture. C’est le gendarme Verfielle qui part de suite et bientôt l’on vint chercher les trois moins atteints car le plus mal ne peut être transporté. Je reste près de lui jusqu’à 10 heures du soir, alors les gendarmes prennent le relai chacun à leur tour. Le 2 mai. Je vais à la caserne voir mon blessé qui est un peu mieux dans la matinée. Miss Fybe, l’ambulancière anglaise vient chercher quelques vieillards et me demande de l’accompagner en ville quelques instants. Quand je rentre, on m’avait apporté trois blessés que Miss Fyfe emmène après que j’ai fait leurs pansements. Vers le soir, il m’arrive un nouveau blessé qui passe la nuit dans la caserne. Le 3 mai. Tout est calme dans la ville. Il n’y a pas de nouveaux blessés et il m’arrive un petit accident qui me fait bien de la peine car je viens de perdre ma jolie broche que j’ai reçue de mon frère quand j’ai été décorée à Bruxelles. Dans l’après-midi, la ville est bombardée avec du gaz asphyxiant qui empêche tout le monde de respirer et j’ai les yeux tout gonflés. Il ne manque que ça ! De 6 heures à 8 heures, je ne vois pas clair. Le 4 mai. Le temps est superbe mais il tombe encore quelques obus. Nous recevons la visite de Sœur Jeanne et l’on nous dit que tout le monde doit quitter la ville. Les voitures viennent d’abord chercher les vieillards qui se trouvent encore et ce sont les plus farouches pour ne pas quitter leur chère ville où ils sont nés et où ils veulent mourir. Je vais demander à Mr Vansluys si c’est vrai que tout le monde doit partir. Il me fait voir le télégramme qu’il vient de recevoir du Ministère et me dit que cela me forcera à me reposer et à me soigner à mon tour. Comme je sors de la caserne, un obus tombe à quelques mètres de moi et je suis projetée à terre. Un pompier qui se trouvait à quelques pas de moi est tué. Des gendarmes à qui je fais signe viennent alors m’aider à le transporter dans une cave. Je suis exténuée quand je rentre à la maison mais, à peine couchée, l’on vient me chercher pour retourner à la caserne où un homme se trouve grièvement blessé. Pendant que je fais les pansements, je suis remplie de sang et je suis plutôt une bouchère qu’une infirmière. Les gendarmes me proposent ensuite de me raccompagner chez moi mais je leur dit que ce n’est pas la peine car l’on pourrait périr tous les trois au lieu que ce soit moi seule. 5 mai. Le bombardement est plus fort que jamais et pendant que nous sommes dans la chapelle, il tombe plusieurs shrapnells dans la cave et plusieurs bombes viennent tomber à nos pieds. Je vais ensuite à la caserne et j’apprends que mon blessé est mort pendant la nuit. En passant sur la place, je vois un cavalier anglais qui vient d’être blessé au genou. Je lui fais vite un pansement. Vers le soir, Mr Stoffel vient me remettre les clés de sa maison ainsi que celle du bureau de la Croix-Rouge. 6 mai. Les voitures viennent toujours. Nous avons du mal, les gendarmes et moi pour décider les derniers à partir. Quand j’arrive à la caserne, j’y trouve un soldat anglais atteint par les gaz. Je lui fais boire du lait avec du sel et il vomit beaucoup. Bientôt il va un peu mieux et on le transporte à Poperinghe. L’église Saint-Nicolas prend également feu. Le 7 mai. L’église a complètement brûlé. Tôt au matin, je vais avec deux gendarmes à la recherche de pauvres gens qui se cachent dans leur cave pour ne pas devoir quitter la ville. Nous en trouvons un peu partout. Le 8 mai. Les Anglais font une attaque générale. Pendant que je suis dans la caserne, un obus tombe en face de la fenêtre. Les barreaux sont arrachés, le plâtre du plafond tombe sur ma tête et je suis projetée contre la porte. Je sens une douleur dans les reins et un gendarme accourt. Je puis juste dire …. Et je tombe évanouie. L’on me donne un verre de cognac qui me remet bien et j’ai honte de ma faiblesse. Un peu après, nous allons voir ma salle, elle est méconnaissable. Tout y est brisé et renversé. Quand j’arrive à la maison, j’y vois un officier anglais, le lieutenant Maclair, qui vient vers nous dire que nous devons tous partir demain matin par ordre du Ministre de la Guerre. L’adjudant Delattre confirme ces propos et nous montre le télégramme que le colonel Tremblay a reçu du Ministère. Nous étions tous tristes et avec des larmes aux yeux, car après avoir tant enduré, il faut quitter la ville. 
Le Couvent des Sœurs de Marie où Joséphine trouva asile et soigna nombre de blessés. Le couvent fut réduit à l’état de ruines par les bombardements. Le 9 mai 1915. Au matin, jour que je n’oublierai jamais, je vais dire au revoir
et peut-être adieu à mes biens braves amis les gendarmes. Tous me conseillent
de retourner dans ma famille car il est vrai que j’ai l’air bien malade mais je
suis plus triste que malade. A 11 heures, les autos arrivent et je vais
peut-être quitter à jamais Ypres où j’ai tant aimé mais aussi où j’ai tant
souffert. On vient me demander si je suis prête et je ne peux pas répondre car
comme les Sœurs, j’ai les larmes aux yeux. Avant de partir nous sommes toutes
photographiées. Arrivée à Poperinge, je vais à l’hôpital voir quelques blessés
que j’ai soignés à Ypres. J’y trouve Mr Valke qui me
dit : « Mademoiselle, Mademoiselle, comme je suis heureuse de
vous voir saine et sauve car j’ai bien pensé à vous ces jours-ci. » L’on
vient me dire qu’une voiture part pour Abeelle. Je
pars avec deux carmélites à la gare avant de prendre le train j’ai le plaisir
de voir le colonel Tremblay qui avant de monter dans le train me félicite et me
serre vigoureusement la main en disant : « Allez-vous reposer mon
enfant car vous êtes exténuées et si jamais vous avez besoin de quelque chose,
pensez à moi. » Je ne croyais pas à ce moment que j’aurais recours à lui
si tôt. Je vais jusque Hazebrouck et là je change de train pour Calais et là
pour Paris. A Amiens, nous devons attendre plusieurs heures et je vais visiter
la cathédrale. Enfin à 16 heures j’arrive à Paris mais à peine suis-je
descendue du train qu’il me fallut l’aide d’une dame de la Croix-Rouge qui se
trouvait dans notre compartiment pour descendre. Je vais aussitôt chez Mr Hardigne, le président du comité qui a été bien saisi de me
voir car depuis un mois, il n’avait plus reçu de mes nouvelles et il me croyait
tuée. Je vais chez Mr Ophof m’informer de mes parents
et j’apprends qu’ils sont à Rouen. Le lendemain 11 mai, Maman vint me rejoindre.
Elle est bien heureuse car depuis plus d’un mois, ils étaient sans nouvelles de
moi. Le lendemain 12 mai, lors d’une petite réunion, je reçois la médaille de
mérite ainsi qu’un diplôme d’honneur des sauveteurs ambulanciers de France. En
arrivant à Rouen, nous partîmes le lendemain pour Le Havre. A peine arrivée, la
police vint me chercher au bateau et disant que j’étais signalée comme espionne
et que tout ce que j’avais fait n’était pas dévouement mis bien par intérêt et
que mes médailles, je n’avais aucun droit de les porter. Je souffre alors plus
en ce seul jour que pendant les neuf mois de campagne que je venais de passer
si tragiquement. Je compris alors que ici il n’y avait pas de vraie justice et
que la seule était là-haut celle de dieu. Bientôt, télégrammes sur télégrammes
arrivèrent au Ministre de la Justice et connut alors quelques heures de repos
mais le coup avait été trop brusque et bientôt je tombai malade, non de maladie
mais de chagrin mais j’espère en Dieu pour qu’il me rende justice malgré la
méchanceté du monde. Voici fini le récit
de ma vie de campagne 1914-1915. Josephine Cloostermans Ex infirmière
militaire. 
Josephine Cloostermans reçut un diplôme en 1915 pour le traitement des blessés lors des premiers actes de guerre. (Privéarchief André Gysel, Diksmuide) Les décorations
de Joséphine Cloostermans – Médaille de sauvetage de première classe
par sa Majesté la reine le 22 juillet 1914 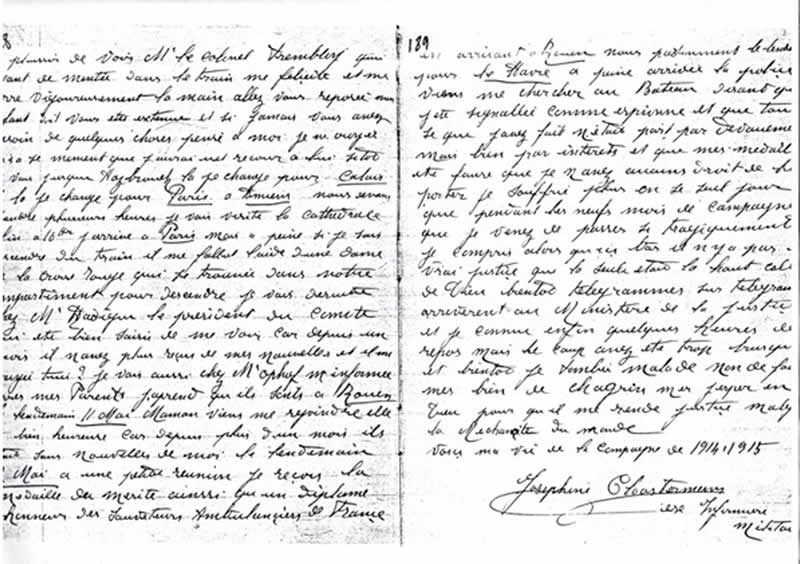
La dernière page du récit de Joséphine Cloostermans
|
© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©