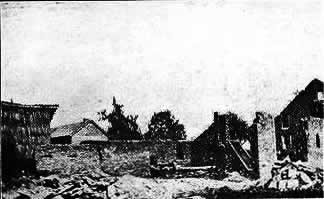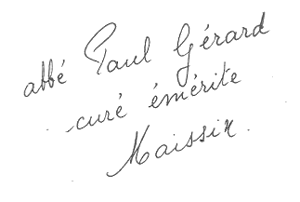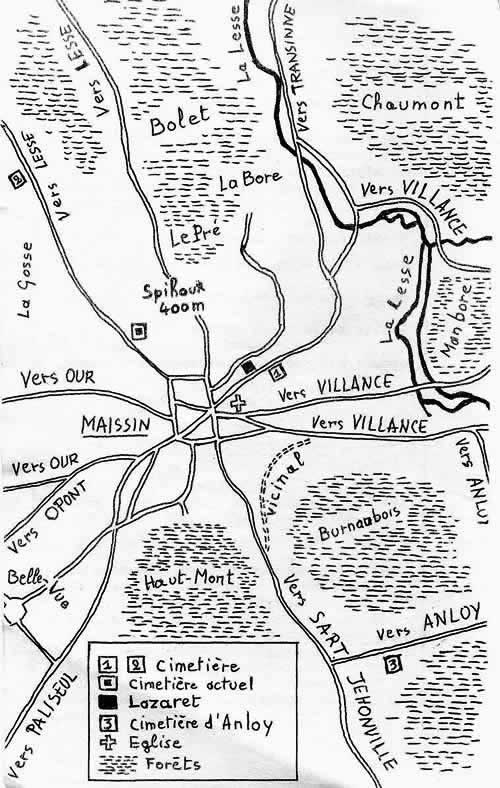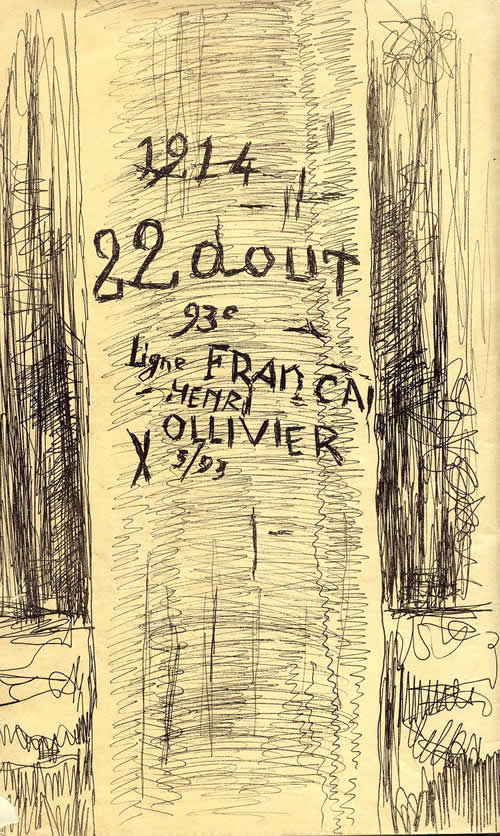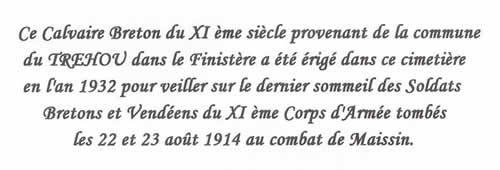Le calvaire des habitants du village ardennais de Maissin.
 [article]
[article]
|
 Jean-Baptiste Eugène Ponsard, 54 ans, tué à Maissin.
Jean-Baptiste Eugène Ponsard, 54 ans, tué à Maissin.
|
|
 Monsieur l’abbé Alphonse Maréchal,25 ans, tué à Maissin.
Monsieur l’abbé Alphonse Maréchal,25 ans, tué à Maissin.
|
|
 Armand Maréchal, 23 ans, tué à Maissin.
Armand Maréchal, 23 ans, tué à Maissin.
|
|
 Maissin – Maisons incendiées sur la route de Lesse-Redu, le long de laquelle se livra un sanglant combat à la baïonnette.
Maissin – Maisons incendiées sur la route de Lesse-Redu, le long de laquelle se livra un sanglant combat à la baïonnette.
|
|
 Maissin – Cimetière dans son état primitif.
Maissin – Cimetière dans son état primitif.
|
|
 Couverture du fascicule, écrit par l’abbé Paul Gérard, sur laquelle se trouve le « Calvaire Breton ».
Couverture du fascicule, écrit par l’abbé Paul Gérard, sur laquelle se trouve le « Calvaire Breton ».
|
|
 L’origine du Calvaire Breton.
L’origine du Calvaire Breton.
|
|
 Tronc d’arbre gravé.
Tronc d’arbre gravé.
|
|
 Explication de la gravure sur le tronc d’arbre.
Explication de la gravure sur le tronc d’arbre.
|
|
 Croquis du village de Maissin.
Croquis du village de Maissin.
|
|
 Publicité de l’hôtel « Relais de la Lesse » incendié en 1914 et pillé en 1940.
Publicité de l’hôtel « Relais de la Lesse » incendié en 1914 et pillé en 1940.
|
|
 Croquis représentant l’hôtel « Relais de la Lesse ».
Croquis représentant l’hôtel « Relais de la Lesse ».
|
| | | |
|
La journée du 22 août 1914
Le 22 août ,150 uhlans faisaient leur apparition au village. L'armée
allemande occupant les alentours et les hauteurs de Villance, avait braqué ses
canons et ses mitrailleuses sur Maissin. Les Français, de leur côté, venant
par la route de Paliseul, avaient pris position du côté de la ferme de
Belle-Vue, face à l'ennemi, sur la route d'Our, de Jéhonville et dans les bois
de Haumont pour leur aile droite tandis que leur aile gauche s'étendait vers
les Raulys, du côté de Lesse. Bientôt l'infanterie allemande s'établit dans
le village. A 14 h. 40, ordre est donné d'engager la bataille. Après un vif
combat sur la gauche de la route d'Our, les Français rentrent à Maissin. Il
est 17 h. 30; le régiment perd son chef, le commandant Guillaumet. C'est la
mêlée générale. Après une lutte de six heures et plusieurs charges à la
baïonnette, les Français sont maîtres de la situation à 19 h.00.
Pendant qu'une grêle de balles et d'obus s'abattait sur
Maissin, une
partie de ses habitants au péril de leur vie, s'enfuyaient dans les champs et
les bois pour y chercher un abri; les autres se cachaient dans les caves. Au fur
et à mesure de leur arrivée dans les maisons, les Allemands chassaient
les habitants au dehors, en les bousculant, retenaient les hommes, et mettaient
le feu. Trente-six maisons furent réduites en cendres au cours de cette
journée. Voici quelques témoignages:

Croquis représentant l’hôtel « Relais de la Lesse ».
Les frères Gérard
L' hôtel Gérard-Dury avait été aménagé en ambulance, 30 lits
attendaient les blessés et le drapeau de la Croix- Rouge était arboré. Les
soldats enfoncent portes et fenêtres et envahissent la maison. Joseph
Gérard remonte de la cave pour se mettre à leur disposition, ils le mettent
en joue et le suivent en poussant des hurlements. L' abbé Gérard, son frère,
exhibe les pièces officielles de la Croix-Rouge,: les soldats les lui
arrachent et les mettent en pièces, puis se font servir à boire. Tout à coup
on constate que le feu est dans la grange. Les jeunes gens essaient de
l'éteindre mais les soldats les en empêchent et rallument l'incendie une
seconde fois. On l'éteint de nouveau. Ils le remettent une troisième fois.
Seize personnes qui se sont abritées dans la cave doivent alors s'éloigner de
la maison en feu, escaladent les haies et prennent le chemin de la Lesse. Les
campagnes sont remplies d'Allemands, les balles sifflent de toutes parts: l'un
deux est atteint à la jambe par une balle. A la tombée de la nuit, ils
parviennent enfin à atteindre la Lesse. L'abbé Gérard, lui n'a pas pu fuir: il
est pris en otage et de 14 h à 18 h 00, il sert de bouclier vivant à un soldat
qui lui place son fusil sur l'épaule et s'en sert comme appui.
Enfermés dans la cave de leur maison en feu
Chez Honoré
Lambin où sont réfugiées les familles de Gustave Pirot et de Henri Baudart, les Allemands pénètrent dans la cave, mettent le
revolver au front
à Gustave Pirot, puis le dévêtent totalement. Bientôt la maison est en feu
et les soldats repoussent dans la cave les habitants qui tentaient de
s'échapper aux flammes. Grâce à un outil de fer, le soupirail est élargi et
de justesse, les habitants peuvent fuir en emmenant les quelques femmes qui
déjà s'étaient évanouies.
Joseph, torturé par des ulhans
A 14 heures, au moment du recul des Allemands dans la rue qu'il habite,
Josepf Chaudrel essaie d'éteindre le feu à sa grange: deux uhlans le
saisissent et lui entourent la ceinture d'une grosse corde, dont ils
attachent les bouts à leurs chevaux. Puis ils l'entraînent derrière eux
vers Villance, lui faisant traverser à la course les haies, les fossés , les
ravins et la Lesse elle-même. Arrivé au hameau de Lesse; Joseph Chaudrel qui
compte 67 ans est laissé à demi-mort sur la route.
Tuée par une balle perdue
Plusieurs personnes moururent tragiquement pendant la journée du 22 août:
Julia Godart, 24 ans parvint à fuir de sa maison en feu en sautant par une
fenêtre, malheureusement réfugiée chez Janson, elle est atteinte sur l'heure
de midi d'une balle qui avait traversé la fenêtre.
Louis meurt à la place d'Anna
Louis Willième, 22 ans, s'était réfugié avec sa famille dans la cave de Mme veuve Nicolas Gérard.
Bientôt on se rendit compte que la maison étai en feu. Au moment où ses
occupants tentent de fuit, et où Anna Gérard arrivait sur le seuil, un
Allemand tira sur elle: elle fit un brusque mouvement qui lui sauva la vie;
malheureusement la balle atteignit à la tête Louis Willième. Il fit encore
quelques mouvements et alla s'affaisser au pied d'un mur voisin. Des flammèches
mirent le feu à son corps. Quand on l'inhuma le 25 août, on ne retrouva qu'un
amas de chairs carbonisées.
Jean- Baptiste, père de huit enfants, abattu devant les siens
Jean-Baptiste Ponsard, 54 ans, père de 8 enfants,
était au milieu des siens quand trois Allemands vinrent briser les vitres à
coups de baïonnette vers 11h 30. Comme il gagnait la cave, un soldat tira sur
lui à bout portant; atteint au cœur, il tomba dans l'escalier et ne tarda pas
à succomber. Les soldats tirèrent aussi sur sa belle-fille, Germaine Liban,
qui tenait dans ses bras un petit enfant et la blessèrent à la jambe.
Quand aux religieuses qui tenaient l'école elle racontèrent: "Il
était 11 heures quand les Allemands nous amenèrent leur premier blessé. A ce
moment, ils avaient déjà mis le feu à la vieille brasserie et à la maison
Gérard. Les Français s'avancèrent alors jusqu'à proximité du presbytère. A
12 h 30, la maison Joseph Gérard - Grandjean brûlait et les habitants après
s'être évadés par une lucarne, se cachaient sous une caisse derrière la
cure. Bientôt l'ennemi s'avançait pas à pas jusqu'au centre du village et
incendiait le magasin Degive, après avoir sauvagement expulsé les
civils. C'est à 14 heures 30 que les Allemands ont commencé à reculer et que,
de dépit, sur un signal donné par un officier, ils ont mis le feu à notre
quartier (maisons Omer Borre, Clément Lefevre, Paul Crasset, Léon Lebutte et
Joseph Yante). A 15 heures, c'était le tour d'une autre rue comprenant l'
hôtel Gérard-Dury, les maisons Poncelet-Lefevre, Augustin Lefèvre, Alphose Gillet, Jules
Coulon, Eugène Gruslin, Henrion et Joseph Crasset. Poursuivis par
les Français, les allemands se retirèrent dans les campagnes, où il y eut des
charges à la baïonnette, puis dans les bois. Il était 18 h. 30 quand nous
vîmes arriver l'infanterie française. Des soldats exténués, mais très
courageux vinrent nous demander un morceau de pain. Ils firent 40 prisonniers
à la gare, qu'ils gardèrent dans la remise de la boulangerie Golinvaux, mais
qui leur furent repris le lendemain. Tandis que les Allemands emmenaient leurs
blessés vers Transinne, les Français déposaient les leurs à l'école -nous
en avons reçu plus de cent- et dans des maisons particulières."
Le curé de Maissin quant à lui, parcourut la campagne pour donner les
secours religieux aux soldats dont bon nombre portaient au cou le
chapelet...
Une vision dantesque
En soirée, Maissin offrait un spectacle effrayant. La sinistre lumière
des incendies, les nombreux cadavres d'hommes et d'animaux qui jonchaient les
rues et dont la vue épouvantaient les vivants, la désolation des pauvres gens
sans abri, les cris et les plaintes de blessés et des moribonds, tout cela
semait dans les cœurs l'horreur et la consternation. Bon nombre d'habitants,
environ 120 prirent la nuit le chemin de la France, tandis que d'autres fuyaient
vers les villages voisins, mal vêtus, mal chaussés, sans nourriture et sans
argent
Le 23 août
Le 23 août, les Allemands ayant reçu du renfort, ils tentent de reprendre
le village. Dés l' aurore, c'est le torrent guerrier qui passe à nouveau sur le
village. Les incendies se rallument , l'église est bombardée, les mitrailleuses
ennemies tirent sur les maisons intactes et sur la Croix-Rouge.37 maisons sont
incendiées. A 9 heures, les Français battent en retraite et vers midi on peut
dire que la bataille est vraiment terminée. A 15 heures, les habitants quittent
leurs abris et constatent les dégâts. Que de ruines! Que de cadavres de
soldats! Quelle infection s'exhalait déjà des corps d'hommes et d'animaux qui
gisaient le long des routes! A la ferme Castus les blessés français périrent
carbonisés: Paul Crasset a vu ces malheureux passer la tête à travers une
lucarne d'écurie et on y a retrouvé leurs ossements calcinés. Chez Edmond
Etienne, deux blessés ont pu gagner la cave, d'où ils sont retirés en vie le
25. Les religieuses ont vu les Allemands mettre le feu à une meule près de la
maison Chenot pour y brûler un soldat français, dont on retrouva les restes.
C'est la fin du monde, s'écriaient les vieilles gens. Et comment consoler tant
d'âmes désolées? L'émoi fut grand quand on apprit qu'il y avait de nouvelles
victimes parmi les civils.
La mort de Constant Haniset
Une scène atroce s'était passée au café de Joseph Lebutte, la première
maison en venant de Villance. En y arrivant à 5 heures du matin, les Allemands
chassent brutalement en dehors les sept personnes qui sont découvertes à la
cave et les alignent , hommes, femmes, enfants, sur le chemin, pour les
fusiller. L'un deux dit à Mme Lebutte: " Toi venir avec ton enfant, avec
moi, et si un français caché dans la maison, toi percée avec baïonnette!". Trois officiers viennent remplir leur gourde d'alcool, de
nombreux soldats vont boire abondamment à un fût de genièvre, puis amoncelant
meubles et literies, ils les arrosent d'essence et y mettent le feu. La fumée
envahit la cave, les gens se précipitent vers le soupirail et peuvent
sortir à peu près sains et saufs; mais quand passe Constant Haniset, 34
ans, époux de Céline Chaudrel, les Allemands lui arrachent des bras sa petite
fille de 3 ans et, sans provocation d'aucune sorte, le forcent à se mettre à
genoux, puis à se coucher à plat ventre sur la route et le tuent de deux coups de
revolver. Pendant ce temps les autres civils ont été écartés et
c'est l'enfant de trois ans qui court se jeter dans les bras de sa mère en
criant "Maman, ils ont tué papa!".
Un gendarme pensionné assassiné
Constant Hubert, gendarme retraité, 47 ans, était descendu dans la cave de
sa maison avec son épouse Marie Bauwens, au moment de l'arrivée de l'ennemi
vers 9h. 30. Entendant un vacarme affreux au rez-de-chaussée, il dit à son
épouse : "Nous sommes perdus, faisons notre acte de contrition!" .
Deux soldats pénètrent à la cave en criant: " Ah! nous les
tenons!". Les pauvres gens se mettent à genoux, joignent les mains, et
demandent grâce. "Pas de grâce! ", telle est la réponse. Constant
Hubert reçoit une balle dans la tête et tombe raide mort. Pendant que les
assassins s'éloignaient, Mme Hubert s'étendit sous quelques planches, où elle
resta sans bouger jusqu'au lendemain à 11 heures.
Sorti de sa maison incendiée, la tête en bas sur une échelle
François Giot, 80 ans, se voyant entouré de flammes sortit de son lit et
parut à la fenêtre, en criant secours. Après l'avoir tourné en dérision,
des Allemands appliquèrent une échelle au mur et le descendirent tête en bas;
puis ils l'abandonnèrent le long d'un chemin, où il resta jusqu'à ce qu'il
fut découvert par sa fille le 24 août. Il mourut quelques semaines plus tard.
Un revolver sur la poitrine
Ainsi qu'il a été dit, le combat cessa vers midi, mais la traque de civils
n'avait pas pris fin . Arrivant à 16 heures chez Jules Willième, les Allemands
mirent le feu à la maison. Puis expulsant les deux familles qui s'y trouvaient,
ils leur firent traverser le village, s'abritant derrière elles, "pour
éviter, disaient-ils, les balles des français". Ces gens furent mis en
joue et frappées à coups de crosse. Clarisse Chaudrel, épouse Willième, fut
blessé au bras. "Où est le curé? lui criait un soldat
haineux; il a mis des français au clocher pour tirer sur nous !" Et lui
mettant le revolver sur la poitrine: "A ton âme ! Où est le curé?"
Une mère perd ses deux fils
L'abbé Alphonse Maréchal, 24 ans, étudiant en théologie au séminaire de
Namur, fut tué, ainsi que son frère, dans l'après-midi du 23 août. Leur
maison ayant été incendiée la veille, ils s'étaient d'abord réfugiés, avec
leurs parents, dans la cave de Séraphin Dermain, leur voisin. Comme les
Allemands venaient tirer des coups de feu par le soupirail, ils se cachèrent à
13 heures dans un fournil attenant aux ruines de leur maison, où, blottis
dans un coin, ils récitèrent le chapelet. A 14h. 30, des Allemands
remontèrent le village et se dispersèrent dans les jardins en faisant du
vacarme. A ce moment, l'abbé Maréchal parut sur le seuil et se rendit compte
qu'un soldat le mettait en joue, à une distance de 50 mètres ; il leva
les bras, pour montrer qu'il était sans arme, mais déjà une balle l'avait
atteint à l'abdomen. Il chancela et vint tomber dans les bras de sa mère en
criant : "Maman, maman!" On l'étendit sur un matelas. en allant
chercher à boire pour le blessé, sa mère découvrit dans la cour de sa maison
le cadavre de son autre fils, Armand Maréchal, 25 ans, le cou transpercé d'une
balle. M. le curé, qui se trouvait à la Croix-Rouge, fut mandé d'urgence et
l'abbé blessé lui dit : "donnez-moi l'absolution". Transporté à
l'ambulance, il fut examiné le soir par un médecin français. Le lendemain
matin, ayant été mis à sa demande devant le cadavre de son frère, il dit :
"Je serai bientôt comme lui!". Il mourut vers midi.
Amélie, criblée de balle à l' âge de 75 ans
Amélie Thémans, 75 ans, prit la fuite quand elle vit le feu aux maisons
voisines et alla se blottir dans une carrière. Dans la soirée du 24 août, des
passants entendirent les appels plaintifs d'Amélie. On la retrouva criblée de
balles, ramenée au village, elle mourut le 6 septembre.
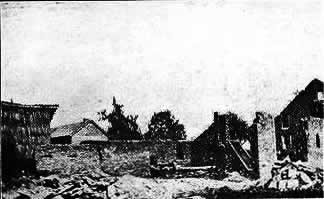
Maissin – Maisons incendiées sur la route de Lesse-Redu, le long de laquelle se livra un sanglant combat à la baïonnette.
Et après ces deux jours...
Les témoins du drame de Maissin attestent que l'aspect du village après ce
combat était indescriptible. On ne pouvait pour ainsi dire se tourner d'aucun
côté sans apercevoir des cadavres, parfois amoncelés. On marchait dans des
flaques de sang humain. Ce fut bientôt une pestilence qui croissait d'heure en
heure. Le 24 août, l'air en était vicié et la plupart des cadavres étaient
noirs. Les animaux des étables hurlaient de détresse et de faim. Les gens
étaient hébétés et s'abordaient en pleurant. A peine avaient-ils la force
d'échanger leurs réflexions sur les scènes tragiques qu'ils avaient vécues.
Le capitaine Cremer réquisitionna les hommes à vingt kilomètres à la ronde
pour la sépulture des cadavres. Plus de 500 civils, venus de Villance, de Libin, de
transinne, de Redu, de Sechery, de Sart et même de Chanly et d'Hatrival furent employés à cette sinistre besogne, qui se continua du 24 au
30 août. Les chevaux et les bêtes à cornes furent transportés, à l'aide de
chariots et de traîneaux, dans une carrière abandonnée de la route de
Sart. Malgré le vif désir des civils, l'identification des soldats français
se fit sans soin ni scrupule. Quant aux blessés, ils furent transportés dans
les quelques maisons restées debout et dans un lazaret créé à l'entrée du
village, sur le chemin de Transinne. Des jeunes filles et des femmes dévouées,
sous la direction des religieuses de la Providence, pansèrent les plaies du
corps, tandis que le curé et M. l'abbé Paul Gérard administraient les secours
spirituels. Après le combat, 800 allemands séjournèrent au village une dizaine
de jours.
Et dans les villages avoisinants?
A Transinne, une ambulance fut installée et fonctionna pendant plusieurs
semaines. A Redu, le 24, une cinquantaine de blessés français appartenant au
64° régiment d'infanterie. L'un deux, Pierre Lelièvre, 2° compagnie, 64°
régiment d' infanterie, mourut le 25 août et fut inhumé au cimetière
paroissial. Il fut impossible de trouver un médecin pour soigner ces nombreux
blessés; ce ne fut que le 27 qu'ils furent visités par le chef du lazaret de
Libin, qui les fit emmener à Libin, Roumont, Libramont. Ceux qui étaient
dirigés vers Libramont furent laissés sur des véhicules par une pluie
battante jusque vers 2 heures du matin, puis furent chargés sur des wagons à
bestiaux et emmenés en Alllemagne. A Our, dans la journée du 22 août, les
Français organisèrent la Croix-Rouge à l'école communale et chez Mme veuve
Martin. Bientôt 3.000 blessés du 11° corps, venant du combat de Maissin, y
reçurent des soins. Le 23, vers 2 heures du matin, les troupes en déroute
venant de Maissin traversèrent le village et emmenèrent la plupart des
blessés. Il n'en resta qu'une quinzaine, plus gravement atteints, qui furent
transportés au couvent d'Abys, puis dirigés vers l' Allemagne. Le capitaine
Tournai, l'adjudant d'artillerie Fontaine et un simple soldat moururent à Our
et y restèrent inhumés au cimetière, jusqu'à ce
qu'ils furent transférés au cimetière général de Nollevaux, en juillet
1918, avec deux soldats, blessés à Maissin, que les habitants avaient trouvés
morts dans les campagnes.
Et aujourd'hui...
En décembre 2.000, nous avons retrouvé les descendants d'une famille de
Maissin. C. M. se souvient de sa grand-mère. Son premier mari fut un
de ces hommes qui furent réquisitionnés pour ensevelir les soldats. On l'a vu
plus haut, les conditions dans lesquels dut s'effectuer ce travail furent
catastrophiques et provoquèrent rapidement une épidémie de typhoïde
qui sema à nouveau la mort parmi les civils comme si la guerre n'avait pas
encore suffit à cette tâche. Le premier mari de la grand-mère de C. M.
ramena une baïonnette trouvée sur le champ de bataille à la maison. Peu
après, il succomba de la typhoïde entraînant dans la mort sa petite fille. La
baïonnette française, ramassée sur le champ de bataille fut longtemps
accusée d'avoir amené la maladie dans le foyer. On la remisa dans l'endroit le
plus obscur du grenier. Longtemps après, on redécouvrit ce témoin silencieux
d'un drame lointain.
Combien de civils succombèrent de la typhoïde après la bataille? Une
enquête dans les registres des paroisses devrait être effectuée pour
répondre à cette question. On peut présumer que l'épidémie fut une
catastrophe mais jamais nulle part, on n'en fit mention... Que représentait
finalement le sacrifice de quelques villages dans une guerre de quatre ans faite
d' épisodes se surpassant à chaque fois en horreur et en
cruauté?
Dr Loodts P.
Sources : - Chanoine Jean Schmitz et dom Norbert Nieuwland: Documents pour
servir à l'histoire de l'invasion allemande dans les provinces de Namur et de
Luxembourg, sixième partie, tome 7, La bataille de Neufchateau et de Maissin,
G. Van Oest et Cie Editeurs, 1924.
Souvenirs d’un témoin en premières lignes allemandes

Couverture du fascicule, écrit par l’abbé Paul Gérard, sur laquelle se trouve le « Calvaire Breton ».
Avant propos.
Depuis mon retour à Maissin et même avant, j’ai été souvent interrogé sur les événements de
1914 ; en conclusion de ces conversations, plusieurs personnes m’ont quitté en disant :
" Vous devriez publier vos souvenirs ". – J’ai toujours répondu par un " oui " évasif.
Au début de juin dernier un interlocuteur auquel j’avais montré ma documentation m’encouragea
avec insistance à la publier.
- Mais, dis-je, sachez que cela, aux yeux de beaucoup, tient de la légende.
- Précisément, répondit-il, c’est cela qu’il faut combattre. Vous, un témoin qui vous trouviez dans les premières lignes allemandes, vous devriez placer le flambeau de la vérité bien haut sur le candélabre. – Maissin serait mieux connu.
Mes hésitations se sont évanouies.
Avouerais-je que toute ma vie, j’ai caressé le rêve d’écrire une " plaquette " :
- qui rappellerait l’héroïsme déployé par les Bretons et les Vendéens,
- mais surtout qui garderait le souvenir de mes neuf concitoyens tombés sous les balles
allemandes,
- enfin, qui remettrait en mémoire les souffrances endurées par tous les Maissinois au cours de
ces journées à la fois glorieuses et douloureuses.
Aujourd’hui ce rêve est devenu une réalité. – Ce modeste travail a pu être mené à bonne fin
grâce à la collaboration de quelques amis que je remercie.
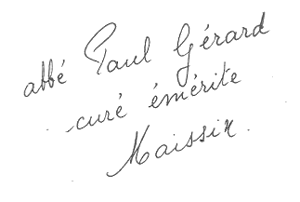
Chapitre I
Avant les 22 et 23 août 1914.
I. Déclaration de guerre – La cavalerie Sordet à Maissin.
Le 4 août 1914, au mépris de sa signature apposée au bas d’un traité solennel conclu en 1839,
l’Allemagne violait la neutralité belge.
En apprenant cet outrage infligé au Droit international par la force germanique, le monde a
tressailli d’horreur : une guerre mondiale dont on ne pourrait mesurer le désastre, allait
éclater.
L’Angleterre et la France, garantes de notre indépendance, donnaient aussitôt au Roi Albert I
l’assurance qu’elles combattraient à ses côtés.
Le 5 août, le Grand Quartier Général Français informait le gouvernement belge : qu’en vue
de déterminer l’importance des troupes allemandes massées à la frontière Est, le corps de
cavalerie Sordet se porterait dès le 6 août au nord de Neufchâteau.
Un escadron de cette cavalerie arrivait à Maissin le 7 dans la matinée : la population lui fit
un accueil délirant. Un poste de T.S.F. muni d’une antenne haute de 5 mètres est monté dans un
verger au centre du village. Nous, les jeunes curieux, nous ne comprenions rien aux
communications échangées.
Le lendemain cet escadron se dirigea vers Rochefort avec la mission d’explorer cette région.
Il nous revint deux jours après, ayant parcouru plus de 170 km par une chaleur accablante. Le
11, il nous quitta, disant : Nous nous rendons dans la région de Beauraing-Hastière en vue de
garder la rive droite de la Meuse : nous cédons cette place au gros de l’armée.
II. La IVème Armée Française : le 11ème Corps.
Il s’agit de la IVème Armée Française commandée par le général de Langle de Cary.
Concentrée au sud de Sedan sur la rive droite de la Chiers, le 16 août cette armée a reçu
l’ordre " de s’établir de manière à pouvoir prendre position, l’heure venue, sur le front
Rossignol-Neufchâteau-Maissin. "
Le 20 août, lui parvient l’ordre de " marcher en avant et d’attaquer l’ennemi partout où on
le rencontrera ".
Le 11ème corps doit occuper la région de Maissin ; il comprend deux divisions :
La 21ème Division composée de 4 R.I., les 64ème, 65ème, 93ème, 137ème ; le 5ème escadron du
2ème chasseur, le 51 R.A.C., une compagnie de génie.
La 22ème Division composée de 4 R.I., les 19ème, 118ème, 62ème, 116ème ; le 6ème escadron du
2ème chasseur, le 35 R.A.C., une compagnie de génie.
Au total, ces deux divisions comptent environ 30.000 hommes venant de Bretagne et de Vendée.
Pour les Français, les préparatifs lointains de la bataille de Maissin sont terminés. Le 21
au soir, ils sont à Bellevaux, Noirefontaine, etc. à environ 15 km de Maissin.
III. Les Uhlans à Maissin.
Voyons maintenant ce qui se passe chez les Allemands.
Dès les premiers jours d’août, la IVème Armée Allemande, sous le commandement du prince de
Wurtemberg, s’était massée dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Le 11 août, des uhlans paraissent à Libin. Dans la nuit du 12 au 13, l’un d’eux traverse
Maissin ; il revient en arrière et demande le chemin des Abys.
Le 13, vers 7 heures, ils sont trois ; ils examinent le village. Au cours de la nuit du 13
au 14, il en vient plusieurs qui vont camper près de Framont.
A partir du 14, ils passent de plus en plus nombreux. Le révolver au poing, ils
réquisitionnent vivres et boisson, se restaurant ainsi gratuitement.
Le 15 août, fête de l’assomption, pendant la grand-messe, un officier pénètre à cheval dans
l’église. L’épouvante se lisait sur tous les visages surtout sur celui des enfants.
Le 19, à Villance et à Maissin, ils détruisent le téléphone public. Le 20, une escarmouche a
lieu à Paliseul entre uhlans et chasseurs français. Le 21, nouvelle escarmouche à l’Almoine :
un Français est tué, un Allemand blessé est ramené chez les religieuses, puis évacué vers
Poix-Saint-Hubert.
IV. La IVème Armée Allemande en marche.
Entre-temps l’armée allemande s’est mise en marche : à partir du 18 août, toutes les routes
de la province de Luxembourg se couvrent d’interminables colonnes d’infanterie, d’artillerie,
de munitions.
Le 21 après-midi, plus de 30.000 hommes sont massés à Smuid, Libin, Transinne, Villance ;
ici, 24 canons sont mis en batterie vers Maissin. Un contingent d’environ cent hommes est venu
à Maissin piller le quartier de la gare et y semer la terreur.
Les Allemands sont, si je puis dire, à pied d’œuvre, attendant l’ennemi. A ne considérer que
le nombre de combattants, les forces des deux antagonistes s’équilibrent, mais la position
occupée par les Allemands est de beaucoup supérieure à celle des Français.
Une brève description de la topographie de Maissin le fera comprendre.
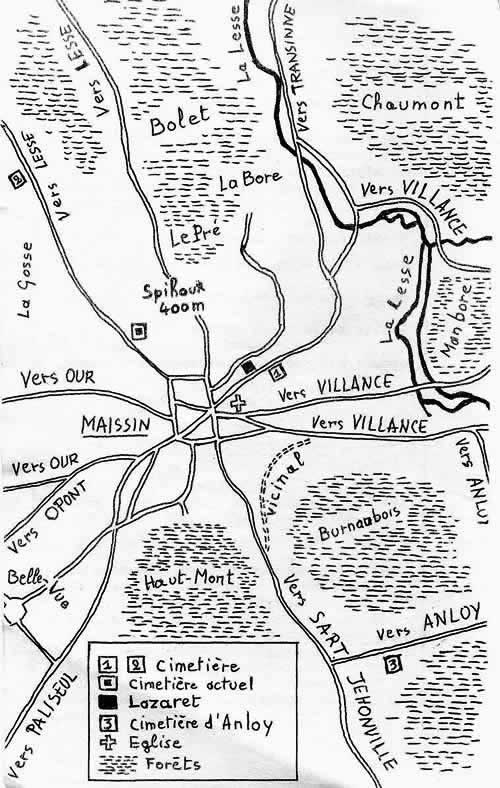
Croquis du village de Maissin.
V. Topographie de Maissin.
Ce joli village est bâti sur le flanc sud d’une colline qui, au Spihoux, atteint l’altitude
de 400 mètres. Au centre du village se réunissent deux grand-routes, l’une venant de Saint-Hubert,
l’autre de Rochefort : elles offrent aux Allemands une grande facilité d’investissement de la
localité. A partir de Maissin, ces deux voies n’en forment plus qu’une seule vers Paliseul,
Bouillon, Sedan.
Au nord, à l’est et au sud, Maissin est entouré d’un vallon dont la profondeur varie de 20 à
50 mètres. A ce vallon succède la forêt : le Bolet, Champmont, la Membore, Burnobois. Les
Allemands peuvent parvenir à Maissin sans être aperçus par l’adversaire.
De plus, de Villance, les Allemands découvrent la vaste plaine s’étendant à l’ouest de Maissin
vers Paliseul (Bellevue) et Our.
Au sud, la forêt d’Homont cache la vue du village aux Français venant par la route de
Jéhonville et de Paliseul. A la Bellevue, ils sont sous le feu direct de l’ennemi.
Chapitre II.
La journée du 22 août.
I. Les éclaireurs allemands quittent Maissin.
Grande fut l’activité de la cavalerie allemande pendant la nuit du 21 au 22. C’est un va et
vient continuel vers Jéhonville, Paliseul et Our.
A l’aube, environ 150 uhlans sont réunis au centre du village ; deux éclaireurs français se
montrent à la lisière de Bernobois, derrière le moulin. Les uhlans détallent vers Villance au
galop.
II. La cavalerie française occupe le village.
A 8 heures ½, arrive un escadron du 2ème chasseur français. On met pied à terre. Les chevaux
sont rangés autour de la vieille école (aujourd’hui la place des combattants) et devant l’église.
Un officier nous annonce la mort de S.S. Pie X qui, dit-il," a offert sa vie pour la paix
du monde ". Il ajoute" Aujourd’hui, on se bat à Namur, Dinant, ici et jusqu’à Metz. Nous avons
ordre de tenir pendant 24 heures. "
Arrivent deux éclaireurs par la route de Villance :" Chef, disent-ils, ils sont là sur la
rivière, leur artillerie est placée derrière la butte (Membore).
Arrive un autre éclaireur par la route di" Pré " ; son cheval est blessé." Chef, dit-il,
ils sont dans le ravin, en rang serrés ; de sa main il désigne La Core.
" Mes amis, s’écrie le chef, barricadez cette route (Transinne) ". – Chariots, tombereaux
sont amenés au-delà de l’école des filles.
Le commandant paraît impatient : " Et notre infanterie qui n’arrive pas ! Et notre
artillerie qui ne donne pas ! – Mes amis aux barricades ! Et ouvrez le feu ! – Et vous les
civils, rentrez chez vous et cachez-vous !"
III. Le déclenchement de la bataille par les Allemands.
Les canons allemands commencent à tonner, les obus sifflent au-dessus du village et éclatent
vers Hautmont et le Bellevue. Le lutte est engagée entre chasseurs français et fantassins
allemands : les balles pleuvent sur la place et sur les toits.
Après une demi-heure, menacée d’encerclement, la cavalerie française se replie vers Paliseul.
Les Allemands envahissent le village par les routes de Villance, de Transinne, du Pré et de
Lesse. Il y avait " tout gris tout partout ", m’ont rappelé les deux sœurs Marie et Céline
Chaudrel.
Ils prennent position derrière les maisons, les haies, dans l’ancien cimetière (actuellement
" Hôtel de ville "), dans les vergers. Ils ont, si je puis dire, établi une ligne de combat
partant de la lisière ouest de Bernobois, passant par le talus du vicinal, la nouvelle rue
(ruelle bordée d’une haie), la Nau, le verger Rossion, la route de Lesse.
L’artillerie allemande intensifie son tir, les premiers incendies sont allumés au bas du
village.
IV. Avance meurtrière de la 22ème Division française.
Les Allemands perdent du terrain.
Voici qu’arrive par la route de Paliseul et de Jéhonville la 22ème division française. Le 19
R.I. marche en tête ; il prend position dans Hautmont.
Deux tentatives d’aborder le village sont repoussées. Un détachement parvient à l’extrémité
du village. Les Allemands sont sous son feu ; les tambours battent, une fanfare résonne, les
clairons sonnent la charge ; les 300 mètres séparant Houtmont du village sont franchis sous un
tir meurtrier. Un obus allemand anéantit la fanfare. Toute la 22ème division est engagée ;
l’artillerie française répond enfin à l’artillerie allemande. Conduite par le commandant de
Lahage de Meuse, une colonne traverse le bois Bernobois et parvient jusqu’au grand moulin. Le
commandant est tué, la colonne doit battre en retraite.
Au village la bataille bat son plein sur toute la ligne indiquée plus haut. Poursuivis à la
baïonnette, les gris, traqués de toutes parts, hurlent comme des fauves ; ils reculent jusqu’au
centre du village et incendient toutes les maisons bordant la grand-route. Les balles frappent
les façades des maisons, pleuvent sur les toits ; les hurlements redoublent.
Les Français, toujours à l’arme blanche, gagnent du terrain peu à peu. Nous entendons un
ordre :" Plus haut, les amis, plus haut ". Tout notre quartier est incendié.
Chez nous, les Allemands, brisant portes et fenêtres envahissent la maison en hurlant :
" Franzous heraus ".
Mon frère et moi leur montrons le drapeau de la Croix Rouge, les lits installés dans les
salles à manger. Je montre les autorisations de la Croix Rouge ; ils les déchirent, hurlant
sans cesse :" Franzousen heraux ".
Mes sœurs arrivent en larmes :" Ils ont mis le feu à la grange, disent-elles, nous l’avons
éteint deux fois." Elles ont dû fuir, poursuivies par cette soldatesque déchaînée, le révolver
au poing. Quelques uns passent dans les campagnes remplies d’Allemands pour se rendre au bois
" Bolet ".
Des scènes analogues se sont déroulées un peu partout dans le village.
V. La 21ème division relève la 22ème.
Il est 14 heures, la 21ème division vient relever la 22ème qui souffre beaucoup devant
Maissin. Cette division venue par Opont et Our prend position à la sortie du
bois " Ban ".
VI. Un malheureux incident français.
Monsieur l’abbé Joubaud, curé à Doingt Flamicourt, écrit :
"« J’étais soldat au 65 R.I., faisant partie de la 41ème brigade. C’est par de petites routes et
des chemins de terre (vieille route d’Our, les Butes) que nous arrivons dans un ravin où les
premières balles allemandes sifflent à nos oreilles (derrière le sart Jean). Il s’agissait
d’atteindre en gravissant une colline par des champs d’avoine, l’orée d’un bois (Bolet) d’où
partaient les balles de l’ennemi. – Nous montions par bonds courts et rapides vers le bois. Un
incident malheureux se produisit à mi-chemin. Le 64ème R.I. nous suivait à une certaine distance.
Il n’était pas prévenu de notre présence en première ligne. Il nous prit pour des Allemands qui
se sauvaient devant lui et il se mit à nous tirer dans le dos. Il fut difficile de convaincre
nos camarades de leur erreur. – Sonneries du cessez-le-feu n’aboutissaient qu’à nous faire
mitrailler de plus belle. Il fallut nous mettre carrément debout dans le champ d’avoine et nous
avancer vers eux pour faire cesser leur tir. – Nous repartîmes tous en avant comme un seul
homme ; peu avant la nuit, nous délogions les fantassins ennemis de leur position. Les clairons
français sonnèrent le cessez-le-feu.
Le chef de notre 3ème bataillon, commandant de Saint-Exupéry était tombé au cours du
combat. "
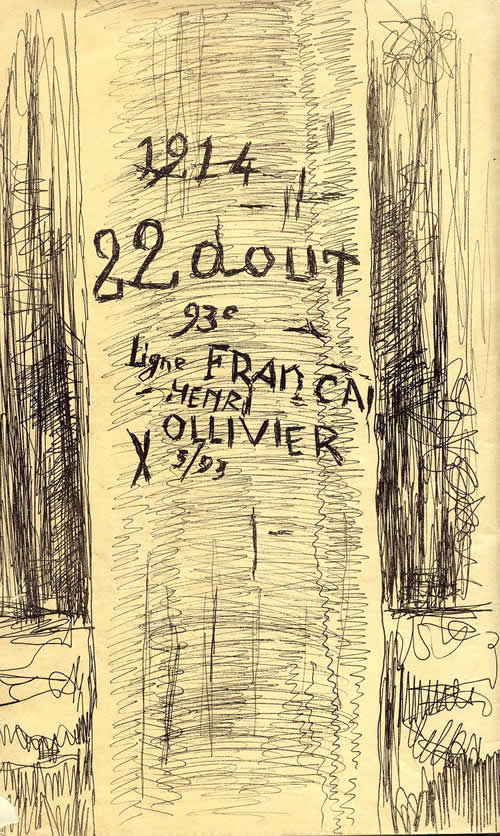
Tronc d’arbre gravé.
VII. La 42ème brigade au village : Assaut général du 11ème corps.
La 42ème brigade, composée des 93ème et 137ème R.I., est parvenue à Maissin par la vieille
route d’Opont, dans la plaine de la Belle-vue. Vers 14 heures, après un vif combat, cette
brigade entre dans le village.
Le 137ème arrive par la vieille route d’Our, perd son chef, le commandant Guillaumet. Une
compagnie de mitrailleurs gagne la route de Lesse et anéantit une colonne allemande embusquée
derrière la haie bordant cette route.
Depuis 14 heures, je suis dans la première ligne allemande ; je ne parle pas de " l’aménité
germanique " à mon égard. Deux fantassins tombent à mes pieds, raides morts ; des blessés
reculent, ils se rendent vers l’arrière ; les autres mettent baïonnette au canon.
Vers 16 heures, c’est un véritable ouragan de fer qui se déchaîne. Un avion nous survole.
– Au risque d’être abattu, je m’échappe et me trouve après quelques bonds au milieu des Français
rangés en tirailleurs, baïonnette au canon. Au son du clairon, ils partent à l’assaut du Spihoux.
Les hurlements redoublent, les hommes tombent les uns sur les autres, embrochés par leurs
armes.
Les hurlements s’affaiblissent peu à peu, les Allemands sont en fuite vers Villance et
Transinne. Les Français vainqueurs, occupent tout le champ de bataille que la nuit tombante
couvre de son ombre.
VIII. La nuit : Ordre de retraite.
Maissin et son territoire sont comme un immense calvaire sur lequel des milliers de jeunes
gens souffrent, agonisent et meurent.
-" Maman… j’ai soif… ! A boire… ! Maman, où es-tu ?... Priez pour moi !... " N’est-ce pas là
l’écho lointain des plaintes du Sauveur du monde expirant près de Jérusalem !
Monsieur le curé Joubaud nous dit encore :
" Quelques camarades, grisés par le succès, s’engagèrent dans le bois où les baïonnettes
fonctionnèrent. Plusieurs ne revinrent pas… Nous nous disions" On va sans doute passer la nuit
sur la position et demain matin nous reprendrons la marche en avant vers… Berlin. " Cette
illusion fut de courte durée. Vers minuit un agent de liaison vint nous prévenir à voix basse
de nous replier dans le plus grand silence : notre division était menacée d’encerclement par la
gauche. "
Il s’agit de Porcheresse, village à 8 km au nord ouest de Maissin où deux bataillons français
ont été surpris à 10 heures du soir par une brigade allemande.
Cet ordre de repli n’est pas parvenu aux troupes se trouvant dans le village et ses abords
immédiats. A la lueur des maisons incendiées, ces troupes se préparent à reprendre la lutte à
l’aube. Ces soldats appartenant aux deux divisions engagées la veille, se rangent en ordre de
bataille, fusil à l’épaule, le long des routes de Villance, de Transinne, dans les vergers,
derrière les murs calcinés, un peu partout.
Leur attente ne sera pas longue.
Chapitre III.
La journée du 23 août.
I. Reprise du combat.
En effet, le duc de Wurtemberg, menacé sur sa droite, a demandé du renfort d’urgence, parce
que, dit-il," il piétine devant Maissin ".
Ce renfort (VIII R.) lui est parvenu au milieu de la nuit.
Vers 2 heures, des coups de feu espacés éclatent dans toutes les directions. A l’aube, le
village est bombardé ; un obus s’abat sur l’église. – Les vociférations allemandes se mêlent à
la fusillade. Les Allemands mitraillent l’école des religieuses où plus de cent blessés français
et civils sont réfugiés. Les colonnes allemandes parviennent aux abords du village et sur les
hauteurs.
Vers 9 heures, les Français, non soutenus par leur artillerie, se retirent peu à peu. Un
officier allemand arrive à l’école, il interpelle Sœur Adélaïde, lui déclarant qu’ils vont
incendier les maisons n’ayant pas de croix rouge.
Jusqu’à midi, nous assistons à des combats entre avant-garde allemande et tirailleurs
français.
Les Hessois arrivent furibonds, se soûlent chez Joseph Lebutte (gare) et se mettent à tuer,
martyriser les habitants, à piller, incendier les maisons qui restent.
A midi, ils défilent en rangs serrés chantant le " Deuchland uber alles ", le
" God mit Uns ", le" Victoria, Victoria ".
Malgré notre dégoût, en moi-même, je me disais :" Pauvres jeunes gens, auxquels des
maîtres ont enseigné qu’en temps de guerre tout était permis ; et dont les chefs orgueilleux
considéraient un traité comme un chiffon de papier ! "
En fin de cette journée du 23 août, un Allemand me disait " Hir groos bataille, malheur,
malheur, la guerre ! "
Chapitre IV.
Après la bataille.
I. Horreur du champ de bataille.
Pour décrire cet aspect, les mots me manquent tellement il est horrible. Partout des morts et
des blessés. Sur la plaine devant Haumont, les Français sont si nombreux qu’ils paraissent
tombés coude à coude. – Tel au temps de la moisson un champ de blé parsemé de bluets et de
coquelicots, telle après le combat apparaissait la plaine devant Haumont, jonchée d’uniformes
français.
Dans les rues, près des maisons en ruine, dans les vergers, Français et Allemands sont
entremêlés. D’aucuns sont tombés empalés sur leurs armes.
Sur la plaine de la Bellevue et vers Our : des morts des deux camps. A l’orée du bois Bolet,
une compagnie française anéantie. – A la route de Lesse, une longue lignée d’Allemands entassés
les uns sur les autres. – La crête du Spihoux est couverte d’Allemands mais aussi de Français
tombés dans des corps à corps d’une violence inouïe.
Des fusils, des munitions, des havresacs sans nombre, des équipements de toutes espèces ont
été abandonnés.
Le village de Maissin, peut-on dire, n’existe plus, 75 maisons ont été incendiées, il en
reste 25, dispersées çà et là, gravement endommagées. – Le bétail est décimé ; les récoltes
piétinées. – C’est la ruine totale ; c’est la désolation la plus navrante.
II. La beauté du sacrifice.
Cependant cet horrible champ de bataille reflète aussi la beauté du sacrifice consenti pour
une noble cause.
Le dimanche 30 août, dans l’église bombardée, menaçant ruine, Monsieur le curé Lambert
disait :
" Qu’ils étaient beaux, ces enfants de Vendée et de Bretagne ! Sacrifiés pour tous, ils
allaient à la mort, le sourire aux lèvres. Pourquoi ? Parce qu’ils avaient un idéal : défendre
le droit contre la Force.
Qu’ils étaient beaux figés dans la mort, les bras étendus, les yeux larges ouverts fixant la
voûte céleste !
Qu’ils étaient beaux, le chapelet enroulé au poignet ou passé au cou, invoquant Notre-Dame
d’Auray, patronne de la Bretagne !
Avec quelle résignation, ils faisaient le sacrifice de leurs vingt ans et avec quelle confiance
ils recevaient l’absolution !
Tout cela uni à nos souffrances, à nos larmes, à nos deuils, au sang de nos morts, pèse lourd
sur les plateaux de la Justice divine : Dieu nous donnera la victoire, il sauvera la Belgique
et la France. "
Les deux " « casques à pointe »" se trouvant dans le porche disparurent
aussitôt.
III. Le sort des habitants.
A. Les victimes.
Dix de nos concitoyens sont morts au cours de ces journées. En voici la liste avec un bref
aperçu des circonstances de leur trépas.
1. Monsieur l’abbé Alphonse Maréchal (24 ans)

Monsieur l’abbé Alphonse Maréchal,25 ans, tué à Maissin.
Il devait être ordonné prêtre le 10 août ; ordination qui n’eut pas lieu à cause de la guerre.
Voyant les Allemands, il lève les bras. Une balle l’atteint à l’abdomen. Il s’écroule sous les
yeux de sa mère. Transporté au presbytère, il expire le lendemain après avoir pardonné à son
meurtrier.
2. Armand Maréchal (23 ans)

Armand Maréchal, 23 ans, tué à Maissin.
Cherchant du secours pour relever l’abbé, Mr Maréchal voit Armand tomber raide mort, la
tempe perforée par une balle.
3. Constant Hubert (47 ans)
Gendarme retraité, il est abattu dans sa cave sous les yeux de son épouse dissimulée
derrière une caisse.
4. Constant Hanezel (34 ans)
Il portait sa petite fille âgée de 3 ans dans ses bras : les Allemands la lui arrachent et
lui ordonnent de se coucher. Ils le tuent de deux coups de révolver. La petite fille s’écrie :
" Maman, ils ont tué papa ".
5. Eugène Ponsard (54 ans)

Jean-Baptiste Eugène Ponsard, 54 ans, tué à Maissin.
Père de huit enfants. Trois Allemands l’aperçoivent dans sa cuisine ; ils l’abattent ;
celui-ci tombe dans l’escalier de la cave et expire presque aussitôt.
6. Louis Willième (22 ans)
S’était réfugié chez Gérard Poncelet. Il est abattu au moment où il sort de la maison
incendiée par les Allemands. Son corps a été découvert à demi-carbonisé.
7. Julia Godart (24 ans)
Quitte sa maison en feu ; se réfugie en face chez Janson où elle est atteinte par une balle
perdue. Sa sœur Anna fut blessée au bras.
8 et 9. Jean-Baptiste Lebutte (80 ans) et son épouse Amélie Thémans (75 ans)
Ils ont été retrouvés au Routy. Voyant le danger, ils tâchaient de se rendre à Gembes chez
un frère.
10. François Giot (80 ans)
Impotent. Entouré de flammes, il crie au secours. Après l’avoir tourné en dérision, les
Allemands le descendent la tête en bas et l’abandonnent le long du chemin ; il mourut quelques
jours plus tard.
Pitié, Seigneur, pour ceux qui pour la Patrie sont morts !
B. Les rescapés.
Au début du combat, les habitants s’étaient réfugiés dans les caves et dans des abris de
fortune. Ils durent bientôt les quitter pour se soustraire, soit à l’asphyxie, soit au menaces
des Allemands.
Sous le bombardement et la mitraille, ils ont dû, non sans risque, gagner la forêt et les
localités voisines. C’est ainsi que des gens de Maissin se trouvaient à Porcheresse la nuit de
l’incendie de ce village par les Allemands. – De nouveau, ils durent fuir, mais cette fois vers
la France. La même nuit, environ 200 personnes sont parties vers Paliseul : elles ont aussi dû
gagner la France d’où elles ne sont revenues qu’après l’armistice de 1918. Plusieurs s’y sont
même installées définitivement.
Un visiteur de la première heure du champ de bataille a écrit :
"« Après le combat, les quelques habitants restés à Maissin étaient méconnaissables ; les yeux
hagards, le visage hébété, ils paraissaient en proie à un affreux cauchemar ; les yeux pleins
de larmes, ils fouillaient les cendres de leurs immeubles à la recherche d’un objet précieux.
Mais tout était anéanti. »"
Nul ne le contestera, Maissin, petit village d’Ardennes, a payé une très lourde rançon pour
sauver l’Indépendance belge et l’intégrité française.
IV. L’enterrement des morts.
Après les journées tragiques des 22 et 23 août, 800 Allemands sont restés au village, sous
prétexte d’identifier les morts. Le petit nombre d’identifiés nous montre avec quel soin ils se
sont acquittés de ce devoir. – Leur grand souci était de dépouiller les cadavres français de
leurs ceintures cousues de pièces d’or (ils en auraient récupéré plusieurs kilogrammes).
Henri Rulmond, garde champêtre, s’est dévoué pour inhumer dans l’ancien cimetière (maison
communale) nos concitoyens tombés sous les balles allemandes. – Il prit aussi l’initiative
d’évacuer dans une carrière abandonnée, route du Sart, les nombreux cadavres des animaux en
putréfaction. Ensuite, tout en exerçant une surveillance active, il prit part à l’enterrement
des soldats.
A. Création de 3 cimetières militaires.

Maissin – Cimetière dans son état primitif.
Joseph Gérard, mon frère, seul représentant de l’autorité communale présent dans la localité,
fut chargé par l’autorité allemande, d’organiser l’enterrement des soldats.
Il a dû faire appel aux hommes et aux moyens de transport des localités voisines : Libin,
Transinne, Villance, Redu, Smuid, Hatrival et Chanly.
Trois cimetières ont été créés :
N° 1 : au " Courtil à Spines " (route de Transinne)
N° 2 : à la fosse du Baulet
N° 3 : au Spihoux.
Dans ces cimetières, plus de 500 hommes sont occupés à creuser des fosses dans lesquelles
sont entassés 20, 30, 40 cadavres.
" On s’allait à Maissin tchèriè aux moirs " (patois) " On allait à Maissin charrier les
morts ", comme à la moisson, on charrie les gerbes de blé : ainsi s’exprimaient les voituriers.
Ce travail s’est poursuivi pendant huit jours.
Des tombes isolées ont été creusées dans la campagne : il fallait se hâter car l’air
devenait chaque jour de plus en plus irrespirable.
En 1957, tous ces morts ont été rassemblés au cimetière du Spihoux, où ils dorment à l’ombre
d’un calvaire breton qu’on avait édifié en 1932.
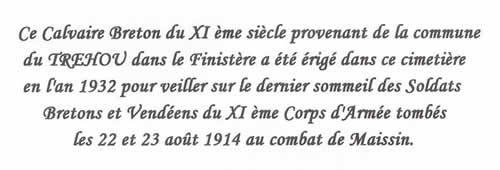
L’origine du Calvaire Breton.
N.B. : Au cimetière d’Anloy sont encore inhumés des soldats des 64ème, 65ème, 93ème, 19ème,
118ème, 62ème régiments qui ont combattu à Maissin.
B. Combien sont-ils ?
Au cimetière de Maissin, il y a pour les soldats français deux fosses communes renfermant
respectivement 1542 et 1459 corps ; donc au total 3001 soldats français inconnus ; il faut y
ajouter 960 tombes de Français identifiés.
Les Allemands, tous identifiés, sont au nombre de 513 + 343 = 856. – Les nombreux visiteurs
qui ont parcouru le champ de bataille étaient unanimes à dire que les pertes subies de part et
d’autre étaient sensiblement égales. – Nous savons aussi que les Allemands ont évacué et
incinéré un certain nombre de leurs morts.
V. Hospitalisation des blessés.
A. Dans les villages voisins.
Pendant les combats, les deux belligérants ont évacué un grand nombre de blessés.
La Croix-Rouge établie à Our en a reçu 3000 celle de Les Abys en a reçu 300.
A Opont, les Français, malgré eux en laissèrent une multitude.
A Redu, le patronage est rempli de Français et d’Allemands.
A Transinne, les blessés allemands, venant de Maissin, étaient recueillis dans une ambulance
qui a subsisté pendant plusieurs semaines.
A Libin, le 22, les Allemands rassemblent leurs blessés dans les écoles des Frères, des
Religieuses, au Patronage, dans les bâtiments communaux et dans vingt maisons ; il y en avait
plus de 2000.
Ces renseignements m’ont été donnés par les curés de ces paroisses.
B. A Maissin : Le Lazaret.
Ici, dans les écoles, dans l’église, dans les maisons non incendiées, Français et Allemands
s’entassent pêle-mêle dans des mares de sang ; un immense lazaret a été établi dans la prairie
face au cimetière n° 1 entre les deux routes de Transinne.
Ces milliers de blessés, sans distinction de nationalité ont été secourus avec un dévouement
au dessus de tout éloge par Sœur Adélaïde et quelques jeunes filles, notamment les Rossion Douny,
les Gérard Poncelet, les Castus Foubert, les Gérard Dury, etc.
Tenant compte des morts, des blessés et des égarés dans la forêt, il n’est pas exagéré de
dire qu’au cours de ces journées tragiques, chaque antagoniste a perdu environ 10 000 hommes.
Chapitre V.
La victoire Française.
Bien qu’il ait dû se replier, il est incontestable que le XIème corps a remporté une victoire
importante.
Retenons ces différents témoignages :
Le duc de Wurtemberg ne s’est-il pas avoué lorsque, le 22 août, il réclamait " d’urgence du
renfort parce qu’il piétinait devant Maissin " ?
Le général de Langle de Cary témoigne de cette victoire lorsque le 22 vers 16 heures, il
informe de G.Q.F." « que retraitant sur toute la ligne, il craint de ne pouvoir maintenir
l’avantage remporté à Maissin »".
En janvier 1915, Monsieur le chanoine Schmitz, auteur de 7 volumes sur " l’invasion allemande "
me disait :" A Maissin a été livrée la plus grande bataille en rase campagne. Les Français y
ont remporté une victoire dont l’importance ne sera connue que plus tard. "
En mai de la même année, un officier du service d’espionnage français m’a dit :
" Maissin est une cause lointaine de la victoire de la Marne. En y bloquant pendant plus de 24
heures les Allemands, notre XIème corps a permis à notre IVème Armée de se regrouper sur la
Haute Meuse, de faire sa jonction avec la Vème et ainsi d’amorcer la grande manœuvre qui nous
a donné la magnifique victoire de la Marne. "
Cette opinion me paraît confirmée par Réginal Kann, critique militaire français qui a écrit :
" On a si souvent répété depuis 1914 que le plan de campagne allemand a échoué sur la Marne,
qu’on a fini par le croire ; on se trompe ; c’est en Lorraine et en Belgique qu’il s’est
effondré ".
Maissin est en Belgique, alors…
Honneur et Gloire aux Bretons et Vendéens qui ont remporté cette victoire ! N’oublions pas
non plus, Nos Concitoyens qui furent les victimes innocentes de la fureur germanique !
Conclusion.
Ne voulant pas raviver un vieux ferment de rancune, je n’ai rappelé ici que quelques
cruautés dont nous avons été les victimes innocentes ; cela suffira, je l’espère, pour exciter
dans le cœur des fils et des petits-fils de nos ennemis d’hier et dans celui de nos jeunes gens
l’horreur profonde de la guerre et un désir sincère de la paix.
Après cinquante ans, pour nous qui les avons vécues, ces journées restent inoubliables ;
elles sont sacrées : autrefois journée de larmes et de deuil, d’héroïsme et de gloire,
- qu’elles soient désormais des journées de prière et de recueillement.
Après cinquante ans, nous n’avons pas perdu de vue la dette de reconnaissance que nous
devons :
- Adieu qui nous a protégés.
- Aux militaires morts ou vivants qui nous ont défendus.
- Et aussi à nos concitoyens tombés au cours de ces journées tragiques.
Désormais, cette dette que le temps ne peut éteindre, devra être payée par la jeunesse,
héritière de notre indépendance reconquise.
Après cinquante ans, la terre de Maissin, pétrie du sang de la jeunesse française, du sang
et des larmes de nos concitoyens doit rester une terre sacrée !
De cette terre s’exhale comme un parfum de fidélité, de générosité et de piété patriotiques.
Puisse notre jeunesse humer ce parfum avec ivresse !
Qu’à cette époque " où l’on n’a plus confiance en personne ", elle reste, à l’exemple des
jeunes Bretons et Vendéens, toujours et partout fidèle à la parole donnée !
Que, par une vie vertueuse, elle mérite que Dieu lui épargne les horreurs d’une guerre
nouvelle et donne enfin au monde " La Paix tant désirée et que les Hommes ne peuvent
édifier ".
Le Vieux Calvaire,
Le vieux Calvaire sur la route,
A tout passant disait : Ecoute
- La voix des pierres d’autrefois ;
- Car mon granit vêtu de lierre,
- Dans ce carrefour solitaire
- A compté cent ans quatre fois.
- Durant mon humble et longue histoire,
- Je fus le modeste oratoire
- Où paysans, grands et petits,
- Venaient, dans leur rude langage,
- M’apporter le naïf hommage
- De leurs bonheurs, de leurs soucis.
- Pendant les mornes saisons grises
- Me glaçaient les nuits, et les brises
- Quand elles soufflaient de la mer ;
- L’été réchauffait ma misère.
- Et le tout tissait sur ma pierre
- Un manteau d’or bordé de vert.
- Ainsi passait mon existence…
- Un jour, cependant, la souffrance
- Sembla près de moi se porter ;
- Quatre ans mon douloureux calvaire
- Fut celui de combien de mères !
- Que de peines à consoler !
- Hélas ! La tâche était trop dure ;
- Alors, voyant que les blessures
- Restaient ouvertes dans les cœurs,
- J’ai résolu d’aller moi-même
- Veiller près de ceux que l’on aime,
- Pour tenter de tarir les pleurs.
- Un cimetière est, en Belgique,
- Devenu terre d’Armorique
- Puisque nos enfants l’ont peuplé.
- Je veux, là-bas, que l’on me dresse ;
- Et tous les siècles de tendresse
- En mon granit accumulés
- Baiseront ces tombes premières
- Où viennent chaque anniversaire
- Prier nos amis de toujours ;
- Comme dans nos moindres villages
- L’on porte aux morts le témoignage
- Du Souvenir et de l’Amour.
- Et près de tous ceux qui reposent
- Je deviendrai ces douces choses
- Qu’on ne peut jamais oublier ;
- Les invocations d’une mère,
- Et l’ombre apaisante et légère
- Qui tourne autour de nos clochers.
Pierre Massé.
Le Tréhou, septembre 1931.
Quelques souvenirs d'un enfant du siècle.
Maissin 1914 – 1918.
Par
L'ABBÉ P. PIRSON
Aumônier Pr Hre
2ème Lanciers 1939-40
1er Lanciers 1946-1964
ETBL 1964
En août 1914, au moment où cette histoire commence, j'avais cinq ans. J'habitais, avec mes
parents, dans un petit village des bords de la Haute-Lesse, à Maissin.
Vous connaissez ? Ca m'étonnerait. Pourtant, c'est un patelin-carrefour. S'y rejoignent deux
grand-routes, l'une venant de Dinant, l'autre de Saint-Hubert.
Pour atteindre Sedan, il fallait aux Allemands passer par Maissin, carrefour stratégique.
Hélas! La Lesse bouillonne au bas du village, traversée de trois ponts dont le plus ancien,
très beau, date du XVIIIème siècle. Les deux autres sont des moyens de passage, sans plus.
Les 22 et 23 août 1914, ces trois ponts furent l'enjeu d'une bataille sauvage. C'est sur la
Lesse, en effet, que se sont affrontés, quasi à l'improviste, Français et Allemands.
Le 4 août avait éclaté la "Grande
Guerre''.
Regarde la carte, cher lecteur (si tu existes...) ou plutôt si possible, viens sur place. Viens à
Maissin (excellents hôtels) et prends la route montante et souvent malaisée de Redu, (Redu, le
village du livre !). Parcours environs 200 mètres après la dernière maison. Fais bien attention
et tu découvriras, sur ta droite, une belle double porte grillagée, une lourde porte en bronze,
ouvrable en permanence.
Pousse cette porte, tu entreras dans un autre monde. Tu en auras, du moins, l'impression.
Tu es, en effet, dans un cimetière militaire. Ici, pas de fantaisie funéraire. Dès l'abord,
ton attention sera attirée par deux monuments sévères. Le premier est un calvaire breton qui
semble un peu perdu dans cet espace sans relief.
Plus loin, en plein milieu, le monument allemand, vaste et imposante rotonde en pierre du pays,
percée de quatre baies orientées pour accueillir la lumière à toute heure du jour.
Mais quittons, si tu veux bien, le monumental. Abaissons nos regards vers le sol. Quelle belle
pelouse ! L'herbe en est si dense, si verte. Des croix en jaillissent, bien en ordre, comme au
"garde à vous". Croix latines pour les Français, croix de Malte pour les Allemands.
Elles rayonnent de sérénité. On dirait qu'elles fraternisent, qu'elles veulent abolir, dans
l'éternité, les horreurs perpétrées dans le temps. Les croix latines sont les plus nombreuses,
mais elles ne portent qu'un seul nom (parfois réduit à une syllabe ou à des initiales). Tandis
que, sur les croix allemandes sont gravés deux ou trois noms.
Tout ici, tout jusqu'ici inspire le sentiment d'un éternel repos dans la paix et la sérénité.
On s'en laisse doucement envahir jusqu'au moment où, figé de stupeur, on n'en croit pas ses
yeux. Au fond du cimetière, tout à fait à l'arrière, dans l'espoir, sans doute, qu'elles
échapperont aux regards des visiteurs, gisent deux grandes dalles.
A l'avant de chacune d'elles, une plaque de bronze porte une inscription qui fait frémir: "Ici
reposent, mille cinq cents soldats français inconnus" !
Je cite ce nombre de mémoire, sachant qu'il est inférieur à celui qui est mentionné. Ajoutons
y ceux qui sont morts de leurs blessures, sans oublier ceux dont nous avons vu les croix. Et
les estropiés, les invalides, les mutilés !
Quelle inimaginable boucherie où furent sacrifiés, en quelques heures, par la bêtise de leurs
chefs, des régiments entiers de Vendéens et de Bretons.
"Un vrai Français ne se bat qu'à l'arme blanche" !
Génial, diraient persifleurs, les jeunes d'aujourd'hui. Stupide, disons-nous, cette consigne,
secrétée par la cervelle mégalomane et imbécile de chefs qui, eux, sont à l'abri.
Ces jours-là, les Allemands n'avaient qu'à faucher à la mitrailleuse. Ils ne s'en sont pas
privés !
Eh bien, malgré cette hécatombe, le soir du 22, chose à peine croyable, les héroïques
trouffions français avaient repoussé sur la rive droite, des Allemands qui avaient déjà
conquis près de la moitié du village.
Glorieux fait d'armes, bien sûr, mais à quel prix ! Glorieux et inutile, hélas ! Dès le
lendemain, au milieu du jour, les Français survivants devaient fuir, en pleine déroute.
C'est ainsi que se termina la bataille de Maissin.
Il est probable, sinon certain, que je suis le seul survivant, témoin de ces jours horribles.
C'est pourquoi, sur la suggestion de Paul-Henri Gendebien, j'ai pris la plume et voilà ce qui
en est sorti.
Bruit et fureur.
Maintenant, si vous voulez bien, venons en à mes souvenirs personnels. Ce jour-là, le 22 août,
un curieux tapage me réveille. Que peut bien signifier ce bruit infernal, jamais entendu ?
J'eus à peine le temps de ne poser la question que la porte de ma chambre s'ouvrit brusquement.
Je vis mon père se précipiter vers moi, m'envelopper dans une couverture et m'emporter. Où ?
Je n'en sais plus rien ?
Sans doute, petit inconscient, me suis-je rendormi. Je profite de ce vide dans ma mémoire pour
raconter de précédents souvenirs d'événements et de choses capables de faire impression sur un
gosse de cinq ans.
D'abord, les dragons. Ah ça c'est inoubliable pour un enfant de cet âge. Depuis quelle date,
je ne sais pas mais presque tous les jours, mon père et moi sortions en vitesse de la maison.
Une belle maison, que j'aimais bien. Elle est toujours là, reconstruite, toujours plantée le
long de la route de Saint-Hubert, un peu en retrait.
Et sur cette ajoute, quel spectacle! Des êtres vivants, rarement sortis d'un autre monde et
qui montaient des chevaux comme je n'en avais jamais vus. Fins, élégants, lustrés, équipés,
harnachés et surtout montés par des créatures étranges. Leur casque luisait au soleil et à
l'arrière, comme une sorte de crinière, une touffe de poils pendait jusqu'à leur col. Et quelle
merveille que cette tunique bleue chamarrée et cette culotte rouge plongeant dans des bottes
noires luisantes dont les talons se prolongeaient par des objets pointus qui lançaient des
éclairs.
Aucun spectacle ne m'a jamais ravi comme celui-là. Ces êtres merveilleux descendaient
majestueusement, par groupe de six, depuis le haut du village, et se dirigeaient vers la Lesse.
Mon père leur criait : Vive la France ! "Mais eux ne bronchaient pas". Pourtant, parfois, l'un
ou l'autre s'est retourné et a crié: "Vive la Belgique".
Après leur premier passage, j'espérais les voir remonter mais mon père m'a expliqué qu'ils
devaient visiter les trois ponts de la Lesse et rentrer dans leur grande maison sur la route de
Transinne.
Tant pis ! J'attendrai demain ou après car ces êtres surnaturels n'apparaissaient pas tous les
jours.
C'était le temps des vacances, le temps des jeux. Le plus proche voisin de mon âge était Léon
Lebutte, fils des petits hôteliers installés en face de la gare du tram. Nous jouions tantôt
chez moi, tantôt chez lui. Chez moi, on faisait surtout du cheval ... à bascule ! Chez lui,
très souvent, on jouait aux quilles ou on construisait une cabane en briques avec le matériel
du papa Lebutte qui était un peu entrepreneur.
Mais un jour, là, derrière la haie, au bout du jeu de quilles, nous découvrîmes le fruit
défendu. Mal défendu par une haie qu'il serait si amusant de percer ... Pas en une fois, bien
sur, cela serait trop long et nous serions attrapés par "Nénenne", la grande soeur commise à
notre surveillance, heureusement, assez relâchée.
Toutefois, on enlève quelques feuilles par-ci, quelques branchettes par là, puis une branche
un peu plus grosse, puis une poignée de feuilles, puis, puis ... Bien sûr, prudence car il
s'agit de n'être pas surpris. Après quelques minutes, on revient au jeu de quilles. Ni vu, ni
connu...
Mais le troisième jour, victoire! On est passé ! En s'aplatissant, naturellement mais
qu'importe ; nous voilà dans la place.
Vite, malgré les guêpes, on cueille ou on ramasse ce fruit mal défendu à qui on a donné le nom
de la Reine Claude. Délicieux, juteux, sucré !
Mais la nuit, quel désastre!
Eh bien, tant pis ! On recommence. On passe, on revient et peu à peu le trou s'agrandit. Nous
ne pouvions pas savoir qu'il allait sauver la vie, à nous et à plus de dix de nos voisins.
C'est pourquoi, j'ai raconté cette histoire.
En recueillant mes souvenirs, je me rappelle quelque chose de moins amusant. Dans le jardin à
côté de notre maison, j'aidais mon père à je ne sais plus quoi. Soudain retentit un bruit de
cavalcade sauvage. C'étaient, sur la route, deux cavaliers au galop, l'un poursuivant l'autre.
Le premier, les cheveux au vent, vêtu de gris, sans arme, était pâle de terreur. L'autre, tout
en bleu, le képi retenu par une jugulaire, brandissait un couteau énorme (un sabre, disait mon
père), En quelques secondes, ils disparurent à nos yeux. Quelques instants plus tard (pas même
5 minutes, d'après mon père), le "bleu" revint au pas de son cheval. Il avait remis son grand
couteau dans une sorte de: fourreau qui pendait à sa selle. Il avait l'air tout fier. "Je l'ai
eu le salaud" clamait-il bien fort.
J'ai su par après que c'était un chasseur à cheval français qui avait embroché un uhlan
allemand, pris de panique, qui avait bêtement sauté dans un wagon du tram. Mais un événement
inattendu allait fixer mon destin. C'est Léon qui m'avertit : "Il y a une automobile devant ta
maison".
Je pouvais à peine en croire mes yeux. Une automobile devant chez nous ! J'avais déjà vu des
automobiles. Peut-être bien dix, mais jamais à l'arrêt. Et en voilà une devant notre porte !
Je n'étais pas bon à la course à pied ... mais cette fois-là ! J'entre en coup de vent et qui
vois-je ? Mon grand-père. Il m'a bien embrassé mais n'avait pas l'air tellement joyeux.
Devant lui, mon père semblait plutôt contrarié, ma mère indécise. "Pourquoi dès maintenant",
disait mon père.
"Mais, répliquait mon grand- père, parce qu'à Bruxelles, il ne se passera rien, tandis qu'ici,
vous êtes sur le passage des troupes, Il ne croyait pas si bien dire.
Toujours est-il que mon père, à bout d'arguments, finit par acquiescer.
C'est ainsi que ma mère nous quitta dans l'heure. Nous avions tous les larmes aux yeux. Mon
frère est né un mois plus tard. Quant à moi j'avais pu choisir. Partir ou rester ? Aller à
Bruxelles ? Dans cette grande maison (avenue Demolder, 19). A Bruxelles, pas de Léon Lebutte,
pas de Léon Pirotte, pas de sinsin …, pas de ... pas de camarades pour jouer ... ou se battre !
Ah non ! Je reste. J'allai contempler l'automobile ... et son chauffeur. Quel curieux
accoutrement ! Quelle drôle de casquette ! Mais l'auto elle-même, quelle stupéfiante merveille !
D'abord une marche pour monter dedans. On voyait devant soi à travers une grande vitre. Et à
quoi servaient cette espèce de roue et ces bâtons en fer ? Et puis, comme ça brillait là
devant avec tous ces cuivres bien astiqués. Sa mise en marche avec une manivelle, c'était
terrifiant.
Le coeur gros, nous la vîmes partir, emportant maman et grand-papa. Une sorte de pressentiment
nous avertissait que nous serions long à nous revoir. Mais il faisait si beau en ce mois d'août
14 ! On aimait vivre en plein air, travailler au jardin (travailler ? hum !) jouer, baguenauder,
attendre le spectacle des dragons. Les dragons ! Splendides, bien sûr, mais ils se déplaçaient
sur terre... Il y avait encore plus miraculeux : les aéroplanes!
On en voyait tous les jours. Un beau matin, stupéfiante nouvelle: un de ces grands oiseaux
s'est posé dans une prairie.
C'était à l'autre bout du village mais qu'importe. La curiosité fortifie les jambes. Tout le
village accourait.
Ah ! Le voir de près, lui et son pilote ... son pilote qui s'était perdu ! Quelqu'un, je ne
sais plus qui, lui indiquait sa position sur la carte. L'homme remit son chapeau de cuir et
remonta dans son engin. Son moteur était à l'arrêt.
Quelqu'un a fait tourner l'hélice et, béat d'admiration, je l'ai vu s'envoler et disparaître
dans le ciel. Quelques jours plus tard se passa un événement prémonitoire. Mon père et moi
voulions monter au village pour acheter, des chaussettes. Nous ne sommes pas montés au village,
nous n'avons pas acheté de chaussettes...Voilà qui est passionnant, pensez vous peut-être ? Je
vous comprends mais attendez. A peine avons nous fait dix pas sur la route que nous avons
stoppé net. Cette route, en ces temps lointains, était bordée d'arbres. Ce jour-là, derrière
chaque arbre, se tenait debout un sbire coiffé d'un casque à pointe.
"Ce sont des Allemands" me dit mon père. Ce jour-là, pas de cavaliers à tête d'or. Pas de messe
non plus, pas de sonnerie de cloches en ce dimanche d'août. Je crois même que les oiseaux ne
chantaient pas.
Le lendemain, à pas de loup, nous nous sommes hasardés au village et là, j'ai vu d'autres
hommes à cheval. Ils étaient coiffés d'un drôle de chapeau en fer, en fer comme leur drôle de
veste. "Des cuirassiers "m'expliquait mon père. Ils montaient des chevaux comme chez nous,
massifs mais curieusement harnachés. Ce furent les derniers hommes à cheval que je pus regarder
avant longtemps. Dernière image étonnante avant les terreurs. Ces terreurs se sont déclenchées
en ce matin du 22 août où j'ai été réveillé, dans ma belle petite chambre, par un curieux
bruit de crécelle. J'avais donc alors été brusquement arraché de mon lit par mon père.
Je nous revois ensuite monter au village avec lui et le copain Léon. La présence de Léon
indiquait qu'il devait être plus de huit heures. Nous avons marché longtemps sans rencontrer
âme qui vive. Bizarre impression d'avancer dans un silence opaque. Mon père, lui, était trop
curieux pour être impressionné. Nous sentions sa main nerveuse qui nous secouait. Il était
pressé, impatient de voir et de savoir ce qui se passait.
Arrivés au carrefour, près de l'église, toujours rien, sinon un bruit de conversations, là
plus loin. Nous voilà, après quelques instants, devant l'hôtel Degive. A la terrasse, une,
dizaine de Français, des officiers sûrement, étaient attablés, parlant haut, riant fort.
Voilà qui était rassurant. Continuant sur la route de Paliseul, qui voyons-nous devant sa ferme?
Emile Castus entouré d'un groupe d'hommes qui, tous ensemble, regardaient vers le bois de
Haumont.
Quel souvenir ineffaçable ! Sortaient du bois, à un km environ, à la file indienne et longeant
la lisière, des hommes en pantalon rouge, baïonnette au canon. Encore quelques minutes et
beaucoup seraient couchés pour l'éternité. Ils marchaient vers la route de Jehonville … et vers
la mort.
Nous avions à peine eu le temps de les apercevoir qu'un cri nous dispersa comme une volée de
moineaux. "Sauve qui peut, voilà les Allemands !"
Au moment même éclata la fusillade. Et elle venait du côté de chez nous. Comment rentrer ?
Heureusement une petite route dévalait la colline et permettait de rejoindre un sentier bordé
de haies qui menait à notre jardin.
Ouf nous voilà arrivés. Mon père affirmait que jamais coureur à pied n'avait couru aussi vite.
En tout cas, accrochés à ses mains, Léon et moi, touchions à peine le sol. Durant cette course,
j'entendais, pour la première fois, pas la dernière hélas ! des sifflements étranges et si
nombreux que j'en étais comme a assourdi. Je n'avais pas peur mais si j'avais su ... ?
Mon père, lui, savait. C'est ce qui faisait de lui un super marathonien, un super champion
olympique. Combien de temps dura cette course ? Quelques minutes sans doute. Quel soulagement
quand, par l'arrière du jardin, nous nous retrouvâmes dans notre cave où, ce jour-là, au moins
dix personnes s'étaient déjà réfugiées. Rares étaient en ce temps-là, dans nos villages, les
maisons dotées d'une cave. Ca tiraillait de partout et moi, inconscient, je me demandais
pourquoi, diable, nous ne pouvions pas nous tenir devant les soupiraux, ni face à la porte.
Tout le monde couché contre les murs. Et mon cheval de bois dans la cave à côté ! ... Pas
question d'aller le rejoindre. Il était face à une fenêtre.
Bizarre tout de même que, soudain, les fenêtres et les portes soient devenues dangereuses.
Et pourquoi tous ces gens, des voisins ont-ils l'air terrifié ? Et voilà le copain Léon qui se
met a brailler et à réclamer sa maman. Pourquoi ne le laisse-t-on pas rentrer chez lui ? Au
moindre mouvement qu'il faisait vers la porte, une main impitoyable le saisissait et
l'aplatissait. Mais il hurlait comme un damné dans le vacarme des explosions. Une brave femme
le prit près d'elle et, si je me souviens bien, a fini par l'apaiser.
Pendant ce temps, tout à coup, au-dessus de nous, ce fut un tintamarre d'enfer. Des cris, des
hurlements, des coups de feu, des vitres qui volent en éclat. Une bataille sauvage, au corps à
corps, se déchaînait.
Je commençais à comprendre et me mis à trembler. Dans notre maison, de méchants Allemands
essayaient de tuer de braves Français. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Depuis ce matin, il n'y
avait que des pourquoi? Je voyais tout le monde trembler. La bagarre là-haut n'en finissait
pas.
Puis, d'un seul coup, le calme est revenu. La bataille continuait mais plus loin. Elle était
ponctuée par des coups sourds et violents. Des coups de canon, disaient les gens autour de moi.
La fusillade s'étant déplacée vers le haut du village, certains alors osèrent regarder par les
soupiraux. Ils voyaient sur la route des corps allongés qui ne bougeaient plus ... qui ne
bougeraient plus jamais.
Soudain, sur la porte, des coups violents. C'était Marie, la grande soeur qui venait chercher
son frère. Malgré le danger, elle avait parcouru plus de 200 mètres. Haletante, elle suggérait
de nous réfugier chez elle où, disait-elle, était installé un poste de Croix-rouge allemand.
Ici c'était le danger, là-bas, la sécurité. Changer de refuge? Certains étaient pour, mais pas
tous. Après discussion, hésitations, indécision, on accepta: Là-bas, on serait plus loin de la
bataille et, surtout, on trouverait de quoi manger. A "l'hôtel du Commerce", on pourrait se
restaurer…
C'est donc l'estomac plus que le cerveau qui emporta la décision. Et nous voilà partis.
Après quelques pas, on sentit le danger. Il fallait traverser la grand-rue, un vrai champ de
tir de deux km au moins puisqu'on pouvait nous voir depuis la Lesse jusqu'à l'église. Et il
fallait, à découvert, traverser cette grand-route d'une largeur insensée. Plus de trois mètres.
Il y eut conseil de guerre et il fut décidé de traverser en une fois, tous ensemble.
Et, allons-y ! On se retrouva de l'autre côté, entre tune haie et la rangée d'arbres. Mon père
me portait. Léon, lui, était dans les bras d'une forte commère mais je ne sais plus qui c'était.
Comme enfant, il y avait encore Gesta (qui connaît une fille appelée Gesta ?) dans les bras
de Céline, sa mère. Ici mes souvenirs se brouillent. Comment sommes-nous arrivés dans la cave
du café? Tout ce que je me rappelle, c'est que, à la grande désillusion de tous, le garde-manger
tant espéré était aussi vide que nos estomacs. Des Allemands étaient passés par là qui, eux
aussi, avaient faim.
Mais c'est à Marie qu'on en voulait, qui devait le savoir et n'avait rien dit. L'important
pour elle et ses parents, c'était d'avoir une cave bien garnie ... de voisins !
Evidemment, rien de pire, dans le danger, que de se sentir seuls. Ils nous avaient bien eus,
dans tous les sens du mot ! Pendant tout ce temps, les balles sifflaient, les obus claquaient
et les Allemands, ici postés … buvaient. Ils avaient vidé le garde-manger et, à présent, ils
mettaient toute leur ardeur guerrière à vider les tonneaux. Péquet à volonté à "L'hôtel du
Commerce".
Baïonnette au canon, ils descendaient dans la cave, notre refuge, et exigeaient à boire. Ils
s'étaient déjà soûlés ailleurs mais, en bons soldats du Kaiser, ils restaient disciplinés. Ils
descendaient un à un, jamais deux à la fois. Ils me faisaient peur tant ils avaient l'air
brutal. Ils lampaient une rasade dans leur gobelet et remontaient l'escalier à quatre pattes.
Au suivant ! Fusil en main, baïonnette au canon, chacun de ces froussards, plein d'alcool, se
laissait tomber dans l'escalier, atterrissait comme il pouvait et tendait son gobelet.
Puis, il n'y eut plus de suivant. Tout à coup, au-dessus de nous, hurlements, tintamarre à
tout casser. Comme ce matin, chez nous. Et soudain, miracle ! On entendait parler français,
là-haut.
Ivresse de joie ! Nous étions libérés. Vite, on grimpe l'escalier. Déception ! Personne en vue.
Du coup, la joie retombe comme un soufflé refroidi. Pourtant nous n'avions pas rêvé. D'ailleurs
il n'y avait plus un Allemand à voir. Ici, à nouveau, mes souvenirs s'effacent.
Par contre, je me souviens très bien que, le soir tombant, accompagnés d'un Français portant
une lanterne, mon père et moi sommes remontés à notre maison. Sur la route, gisaient des
hommes en pantalon rouge, immobiles ou gémissants. Devant notre porte, il fallut enjamber le
cadavre d'un Allemand. C'était un officier supérieur, ai-je appris longtemps après; il portait
des épaulettes tressées.
Et puis, nous entrâmes. Pas besoin d'ouvrir la porte, il n'y en avait plus. Après deux ou
trois pas, quel spectacle ! Quelle horreur ! Des cadavres, des blessés hurlants. Deux dans le
couloir. Le gris ne bougeait plus, le bleu gémissait. Et dans la grande pièce ! Du sang, des
cris plaintifs, des hommes déchiquetés, un d'eux décapité, là, un gris, le ventre ouvert.
Quelques uns ne bougeaient plus.
Et tout cela au milieu d'un salon réduit en miettes. Imaginez, si vous le pouvez, un buffet,
un dressoir, une grande table, deux fauteuils, des chaises, un piano, des verres, des tasses,
des couteaux, des cuillers, des fourchettes, des assiettes, des gravures, des portraits, enfin
tout ce qui peut constituer un intérieur, disons, bourgeois : tout cela écrabouillé, réduit en
miettes et répandu sur le sol avec des douilles, des cartouches, des pansements, des sacs, des
ceinturons, des fusils, des baïonnettes, que sais-je encore !
Spectacle d'apocalypse. Quelle horreur pour un gosse de cinq ans. Et, pour son père, plus
conscient encore du désastre, ce devait être pire. Nous sommes passés dans la cuisine. Là, pas
de cadavre, ni de, blessé, mais, sauf le poêle bien sûr, tout avait volé par la fenêtre.
Sommes-nous montés à l'étage ? Je ne sais plus, mais descendus à la cave, ça je m'en souviens.
J'y ai retrouvé, dans son box, mon cheval à bascule. Intact. Je ne savais pas que je le voyais
pour la dernière fois.
Mon père était effondré. Il restait là, comme hébété, la tête entre les mains.
Il répétait : " Mon Dieu ! Mon Dieu !
L'homme à la lanterne - j'allais l'oublier - hochait du képi, levait les bras mais ne pipait
mot. Il fit tout de même comprendre qu'il devait reprendre son poste. Le coeur battant, nous
redescendîmes au café Lebutte. Nous y retrouvâmes pour passer la nuit, tous nos compagnons et
compagnes de misère. On avait étendu des matelas mais qui aurait pu dormir? Pour qu'un gosse
de cinq ans n'ait pas, de toute une nuit, connu un seul instant de sommeil, il fallait bien
que quelque chose de terrible le tienne éveillé.
Tout autour de la maison, ce n'était que cris, plaintes et gémissements. Des milliers de
blessés gisaient dans les champs, sur la route, dans les jardins, sur la voie du tram. Ils
appelaient désespérément au secours. Mais de secours il n'y en eut point. La mort seule put
mettre fin à leurs indicibles souffrances. Ce sont eux qui, par milliers, reposent au cimetière
de Maissin.
Mais cette nuit affreuse déboucha sur une autre catastrophe. Les Allemands étaient de retour!
Les Français s'étaient retirés sans bruit.
Quelle déception et quelle appréhension d'entendre, au-dessus de nos têtes, ces coups de
gueule teutons, rauques et violents.
Soudain la porte de la cave s'ouvre et voilà qu'un des gris apparaît, revolver au poing.
"Raus" qu'il hurlait. Tout le monde, tremblant, fut collé au mur d'un hangar à quelques mètres
de la maison. Devant nous, vinrent se ranger une dizaine de "casques à pointe". D'autres, plus
nombreux, occupaient la salle du café. Et voilà que l'un d'entre eux sortit comme un diable
d'une botte. Il roulait des yeux furibonds et nous harangua en un français impeccable. Il tint
un petit discours dont je retiendrai toute ma vie les derniers mots : "S'il y a encore un seul
Français chez vous, vous serez tous fusillés."
Bien sûr qu'il devait en rester. Des blessés, des morts, des abandonnés. Quelle émotion parmi
nous. Tout le monde s'embrassait, les larmes aux yeux, en se disant adieu. "Qui est le patron
ici ? hurlait le teuton.
C'est la patronne, la mère de Léon qui se présenta. L'Allemand la fit marcher devant lui et,
avec deux sbires, baïonnette au canon, le petit groupe pénétra dans la maison.
Miracle ! Malgré une fouille minutieuse - et qui n'en finissait pas - de la cave au grenier,
ils ne découvrirent pas un seul Français. Du coup, nous pouvions regagner la cave.
Ouf ! On est sauvés ! Sauvés ? Pas du tout ! Nous étions condamnés. Ces salauds avaient trouvé
plus amusant de nous voir grillés, puis écrabouillés. Je me souviens d'un grésillement qui
ressemblait à celui d'un feu de bois. Les Allemands faisaient du feu. C'est amusant de, faire
du feu ! Je me souviens qu'avec Léon ... en cachette, bien sûr …
Mais ça commençait à craquer là-haut comme des milliers d'allumettes. Je commençais à
remarquer que les grandes personnes n'avaient pas l'air de s'amuser. C'est la peur, au
contraire, qui, peu à peu, les gagnait, puis la terreur, puis la panique.
Deux ou trois se lancèrent dans l'escalier, ouvrirent la porte. Trop tard ! Tout le couloir
n'était qu'un brasier. La fumée commença à nous envahir par les soupiraux. Ces salauds en
avaient brisés les vitres à coup de crosse. Il fallait se coucher pour respirer. Nous hurlions
de terreur. Asphyxiés puis écrasés sous les décombres, nous allions connaître une fin horrible.
C'est alors que mon père se montra un chef. Il avait vu la seule voie de salut : le soupirail
des tonneaux. En rampant, il atteignit le, prit appui sur un casier et ouvrit le panneau plan
incliné.
Il se laissa retomber et cria : "Les gosses d'abord". On nous balança tous trois dans le jeu
de quilles sans ménagement. Et puis ? Et puis … et bien, il y en avait qui refusaient de sortir
: "Ils vont nous tirer comme des lapins", hurlaient-ils. A nouveau, mon père prit l'initiative.
Il sortit le premier et se tint debout. Indemne.
Inattendu, providentiel, un groupe de Français, infiltré dans l'atelier du train, canardait
tout ce qui portait casque à pointe. Au diable la baïonnette. A présent, la parole était à la
poudre. Aplatis derrière le talus du tram, nos bourreaux ne pouvaient nous voir. La plupart
d'entre eux reposent au cimetière militaire de Mais sin. Les Français aussi, hélas ! Cette
intervention miraculeuse nous aura sauvé la vie. Encore fallait-il fuir et se mettre à l'abri.
Ah ! Cher et hypothétique lecteur, tu as deviné. Le trou dans la haie ! Nous étions trois à en
connaître l'existence: Léon, moi et ...Nénenne. Nénenne qui avait fait semblant de ne pas
remarquer notre manège mais qui en profitait, elle aussi, pour aller voler des prunes et
agrandir le trou ! La morale en prenait un coup mais nous étions sauvés.
Sauvés ? Pas tous hélas ! Il y eut une exception. Nous avions rejoint la vieille route de
Villance. Mon père me portait et je regardais vers l'arrière. C'est alors que j'eus l'horrible
vision du village en feu. Ça flambait de partout. Nous sortions d'un incendie pour en voir
éclater plus d'une dizaine dont celui de notre maison. Partout des craquements assourdissants,
des gerbes de feu créaient lin spectacle de fin du monde. Toute la fenaison s'en allait en
flammes. D'une des granges, celle de Léopold André, l'oeil de boeuf vomissait en rugissant une
colonne rouge qui aurait mi le feu au ciel. Il fallait, au plus vite, fuir cet enfer. A un
moment donné, je ne sais pourquoi, nous avons quitté la route et couru à travers champs. C'est
alors qu'un de nous, Constant Aniset, prit dans ses bras sa fille Gesta, se cala dans une haie
et déclara en wallon : "Mi d'je n'va nin pu lon". Moi, je ne vais pas plus loin.
Personne, pas même sa femme Céline, ne prit ces paroles au sérieux. Mais, après quelques
instants, ne le voyant pas nous rejoindre, Céline voulut faire demi-tour, Mon père, avec
beaucoup de peine, l'en dissuada.
Lui-même nous quitta et revint sur ses pas. Il m'a confié à Céline qu'il fallait sans cesse
retenir de faire demi-tour. Après un temps qui sembla interminable, mon père revint avec Gesta.
Et Constant ? Constant était mort, assassiné. Mon père m'a, maintes fois, raconté l'affreuse
histoire. Une horreur de plus parmi tant d'horreurs. Au détour d'une haie où il s'était
dissimulé, il avait vu des "casques à pointe" en train de fouiller Constant. L'un d'entre eux,
triomphait, avait retiré d'une des poches du malheureux, une douille de cartouche de chasse.
Tout fier, il la montrait à ses complices. Le sort du pauvre Constant était scellé. Une balle
dans la nuque l'envoya dans l'autre monde.
A Maissin, sur le monument du souvenir, son nom, pourquoi ? n'est pas gravé comme une dizaine
d'autres, dont celui de l'abbé Maréchal, tué la veille de sa première messe. Cette pénible
histoire a interrompu le récit de notre fuite. A la vue de son enfant porté par mon père,
Céline comprit tout de suite. Elle s'écroula, évanouie. On dut la porter à bout de bras.
Quand elle revint à elle, nous étions à l'abri dans un poste de Croix-rouge allemand. "Par ici,
avec les enfants". Cet appel, je m'en souviendrai toute ma vie !
Enfin, des Allemands à face humaine. Sans casque à pointe, seulement coiffés d'un petit bonnet
rond. C'étaient des brancardiers-infirmiers, ecclésiastiques mobilisés dans le service de santé.
A travers eux, nous avons découvert un autre visage de l'Allemand. Des Allemands, concitoyens
de Goethe, de Schiller, de Beethoven, pas des Boches. Ils nous ont restauré de quelques
biscuits - il était temps - aidé, encouragé. Après un temps de repos, l'un d'eux nous a pilotés
à travers les masses "Feldgrau" et nous a frayé un passage. Nous marchions toujours à travers
champs, jamais sur la route réservée aux canons. Nous traversions une sorte de mer humaine,
grise, dont on n'apercevait pas le rivage. Des deux côtés de la route, cette mer progressait
"nach Paris". Nous marchions évidemment à contre-courant et avec bien des difficultés pour
rester ensemble.
Ces têtes casquées étaient parfois souriantes. On nous offrait même des bonbons, à nous les
gosses. Mais pas question de les accepter. Ils étaient sûrement empoisonnés. Nos adultes en
étaient persuadés qui, en chaque Allemand, malgré les brancardiers, voyaient un assassin en
puissance.
Enfin, cahin-caha, nous sommes arrivés à Libin. Comment ? Après combien de temps, je n'en sais
plus rien ! Tout ce que je me rappelle c'est que nous étions logés chez de vieilles demoiselles,
les soeurs Verheggen dont l'une s'appelait Blanche. Un drôle de nom, me semblait-il, c'est
pour cela que je l'ai retenu et oublié celui de sa soeur. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ont
eu bien du mal avec moi. Je vivais dans un sentiment permanent de terreur, en proie à un
incoercible sentiment de danger et d'abandon. Je m'accrochais à mon père. Sans lui, je me
sentais perdu. Or mon père s'absentait longtemps, tous les jours. Il était requis pour aider
aux soins des blessés. Il n'y connaissait rien mais son dévouement lui tenait lieu de
compétence. Combien de jours avons-nous passés à Libin ? J'ai oublié. Pas très longtemps sans
doute. Par contre, j'ai retenu en détail notre arrivée à Redu, chez notre tante et nos cousins.
Que de larmes et d'embrassades ! Incroyable bonheur. Nous étions encore en vie.
Ici on avait reçu de terribles nouvelles. La légende aidant, plus une seule maison n'était
encore debout à Maissin et toute la population avait été exterminée. Nous-mêmes ignorions tout
des autres Maissinois. Quelqu'un pourtant avait, mais en vain, tenté de rassurer les familles.
C'était un officier allemand qui, précisément, avait pris logement chez notre tante. Il avait
réquisitionné le salon, la plus belle chambre à coucher, la cuisine. Son ordonnance partageait
celle-ci, moitié-moitié, avec Angélique qui, en ces jours, portait bien mal son nom. Elle en
faisait voir de toutes les couleurs au malheureux troufion allemand, vaguement cuisinier,
contraint à une collaboration impossible.
L'officier, notre hôte obligatoire, commandait une batterie d'artillerie dont les canons et
les caissons, sans parler des attelages, encombraient le village comme lui encombrait la maison.
Cet officier allemand portait un grand nom français: von Savigny de la Rigaudière. Le "von"
n'était pas d'origine mais tout le reste l'était sans aucun doute. Mon père m'a expliqué, des
années après (car, en août 14, vous imaginez si ça intéressait un gosse de cinq ans !) que
c'était un Allemand dont les ancêtres, calvinistes français, s'étaient réfugiés en Allemagne
sous Louis XIV. Ce faux grand roi avait révoqué l'Édit de Nantes et rendait la vie impossible
aux Protestants. Notre officier nourrissait à l'égard de la France une haine incompressible
sinon incompréhensible. Il ne pouvait pas comprendre que la Belgique se soit rangée aux côtés
de la France.
Pour lui, c'était comme une trahison en plus d'une stupidité. La France allait être écrasée et
nous aussi.
Son assurance a dû être quelque peu ébranlée quand il a reçu l'ordre de faire mouvement à
toute vitesse vers le front. L'incroyable s'était produit. Des Français en taxis, venaient de
battre à plate couture une armée allemande aventurée sur la Marne. Quant à mon père et à moi,
pour combien de temps allions-nous être des réfugiés ? Qui aurait pu le prédire ? Plus de moyen
de transport sauf pour l'occupant. Une lettre de maman, (apportée par qui ?) nous annonça, un
beau jour (ou plutôt un beau soir) la naissance d'un petit frère, le 24 septembre.
Cette lettre nous était adressée à Maissin. Ma mère - sa lettre le prouve - ignorait tout des
événements survenus en Ardenne le mois précédent. La presse, sous contrôle de l'occupant, n'en
pipait mot. Ma mère était si loin de la réalité qu'elle demandait à mon père de venir d'urgence
à Bruxelles et de lui apporter - car il commençait à faire froid - son manteau de fourrure !
Éclat de rire - de rire jaune - autour de la table. Mon père lisait tout haut à la lumière de
la plus grosse lampe à pétrole, qu'on allumait avec une nécessaire parcimonie. Le niveau de la
réserve était déjà très bas dans la cuve. Et il ne pouvait être question, avant longtemps, de
se réapprovisionner en pétrole.
Avant que cette lettre ne nous parvienne, nous étions retournés à Maissin, à pied, bien entendu.
Nous n'avions pas eu besoin d'"Ausweis", Maissin étant dans le périmètre du "Kreis". Il faisait
un temps superbe. Belle promenade vers le désastre. L'église, intacte apparemment, était
entourée de ruines. De notre maison, il ne restait que des murs noircis. Une moitié de la cave
était écroulée. Adieu, mon cheval ! Au milieu des gravats, mon père, à ma grande surprise, est
entré dans la cave à charbon. Le charbon brûlait encore, à petit feu. Quelle importance ? Eh
bien ! C'est que mon père, dès le va-et-vient des troupes, avait cru bon de cacher le vin sous
le charbon ! Il dégagea du feu une pièce informe, toute tordue et de couleur indéfinissable.
Feu - c'est le cas de le dire – la bouteille.
Après avoir causé avec des gens toujours très abattus, devant quelques maisons restées
intactes ou seulement à moitié sinistrées, nous avons pris la route du retour. Un retour,
pensions-nous, paisible et sans histoire, quand, soudain, surprise, frayeur. Nous longions le
bois du Bôlet d'où surgit un ... fantôme ! Képi français, veste civile, pantalon rouge. Il nous
fit signe et replongea dans le bois.
Mon père avait compris. Il suivit le fantôme. Moi aussi, forcément. A l'abri du bois, je les
entendis parler à voix basse. Je vis mon père qui, secoué d'émotion, se jeta sur le Français
et l'embrassa en pleurant. Puis, il m'empoigna comme une botte de paille et fonça à l'assaut
du château de Pinval. D'un seul mouvement, tout en me portant, il parcourut quelques 200 mètres,
traversa un jardin, gravit un escalier et actionna une sonnette.
Il piétinait d'impatience quand voilà qu'apparut, toute pâle une femme en tablier blanc. En
nous voyant, elle reprit ses couleurs. Mon père, je suppose, déclina ses noms et qualité. La
brave bonne femme ! On aurait dit qu'elle voyait le Bon Dieu !
Elle s'engouffra dans une grande pièce où elle disparut. Très vite, apparurent deux dames,
tout de noir vêtues.
Je fus relégué dans une petite pièce et mon père fut reçu dans le salon. Le temps passait !
Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien se dire ? Comme ça durait ! Enfin, les voilà ! Mon père
réapparaissait, l'air très satisfait. Les deux châtelaines l'accompagnaient, partageant
visiblement sa joie. Ce n'est qu'en 1916 que j'appris le fin mot de l'histoire.
C'est après la visite de mon père que des militaires français, rescapés de la guerre, cachés
dans le Bôlet, furent ravitaillés, vêtus d'habits civils, hébergés dans des granges ou des
cabanes et employés aux travaux des champs. Pendant le terrible hiver de 16-17, ils durent
bien se rendre. J'en ai vu, les mains et les pieds entourés de gros bandages, traités très
humainement, je dois le dire par les Allemands qui les embarquaient dans des ambulances.
Mais fermons cette parenthèse inattendue et retournons à Redu.
Notre séjour se termina après la Toussaint.
A la suite de je ne sais quelles démarches et tractations, nous pûmes nous rendre à Bruxelles ...
en tapissière !
A Maissin, la villa de Me Thomas Braun était restée presque intacte. Le mobilier, par
contre... !
Après sûrement des tas de formalités que j'ignore, du mobilier fut apporté - ou emporté ? je
ne sais plus. Mais l'ai-je su ?
Je me souviens en tout cas d'un beau jour où, sur la grand route nous sommes montés dans un
véhicule d'une longueur ! d'une hauteur !... Une tapissière, disait mon père, tirée par deux
énormes quadrupèdes, domptés par deux gros hommes en costume de travail. En cours de route,
nous avons dormi dans une grange. Le jour suivant, merveille ! Nous entrions dans une grande
ville sur une place ronde encerclée de rails sur lesquelles roulait le tram 60.
Nous étions à Bruxelles.
MON VILLAGE A L'HEURE ALLEMANDE.
Nous voici donc à Bruxelles. Pas pour longtemps malheureusement. La santé du petit frère
exigeait le retour à la campagne. Bon air et bon lait étaient les conditions de sa survie.
C'est pourquoi, au début de 1915, nous étions de retour à Maissin. Nous y avons changé de
logement trois fois en deux ans. Un trou à rats, puis une baraque en pierre, puis, enfin, en
1916, notre nouvelle maison, spacieuse, flanquée d'un grand jardin qui, en ces temps joyeux,
ne pouvait être que potager. Dès notre retour, notre père avait rouvert l'école. Après les
heures de classe, par tous les temps, avec de l'aide occasionnelle et souvent incertaine, il
se fit terrassier et puis maçon. Très bien, mais pour les portes, les fenêtres et la charpente,
il lui fallait un menuisier charpentier.
Heureusement cet homme existait à Maissin même. C'était Jean-baptiste Lebutte, un remarquable
artisan qui n'avait pas été sinistré et avait conservé tout son outillage. Qui a été le
plombier ? Je n'en sais plus rien. Mais l'ardoisier, celui-là, je m'en souviens. D'abord à
cause de sa haute taille et de son visage rubicond. Le péquet y était, disait-on, pour quelque
chose.
Mon père l'avait déniché dans un village voisin ; à Our, sauf erreur. Bien des années plus
tard, j'ai appris ce qu'il avait de plus extraordinaire ; c'était son nom : d'Arras d'Audrecy !
Un authentique descendant des comtes d'Arras. Ses ancêtres avaient fui la guillotine en se
réfugiant dans nos Ardennes où ils avaient fait souche. Courageusement, ils se sont mis au
travail et, audacieux, ils ont opté pour le métier d'ardoisier.
Pierre Nothomb les a fait connaître, mais sous un autre nom, dans son livre : "Le blason
champêtre".
Depuis lors, ils ont repris leur rang et se sont, pour la plupart, établis en France. Du
grand, passons au petit; je veux dire à mon frère. Il reprenait du poids, grâce au bon air des
Ardennes, bien sûr, mais aussi, grâce à la vache de Gesta ! C'est ainsi qu'assez comiquement,
nous avions baptisé la vache de la brave Céline Aniset, la veuve de ce malheureux Constant
Aniset, abattu par des soudards allemands, le 23 août 1914, comme je l'ai raconté.
Heureusement, Céline avait retrouvé intacte sa petite ferme. Elle vouait à mon père une
gratitude sans borne, parce qu'il avait, disait-elle, sauvé sa fille. Elle nous a fourni
autant de lait qu'elle pouvait, durant toute la guerre. Mais ces lignes ne peuvent ni ne
veulent tourner à la chronique familiale. Ce que je suis sollicité d'écrire, ce sont les
événements et les situations qui ont prévalu, en 14-18, dans mon village dévasté.
N'oublions pas que, dans les champs et les bois, au hasard de la marche, on piétinait des
fusils, des baïonnettes, des pistolets, des cartouches par centaines et, bien des fois, un
cadavre que les feuilles d'automne avaient soustrait à la vue des équipes de ramassage.
Ces équipes se sont relayées, sans désemparer pendant près de deux ans. Par la volonté de
l'occupant, on dirigeait les corps, séparés jusque dans la mort, vers deux cimetières
différents, l'un allemand, l'autre français. Les Allemands avaient transformé en cimetière une
prairie voisine de la villa de Me. Thomas Braun. Les Français, eux, on les entassait loin du
village dans un espace ouvert à tous vents.
En 1916, le cimetière allemand fut inauguré en grande pompe par un Général, entouré d'un
Etat-major en grande tenue. Il y eut des discours, des chants, des prières. Et puis la guerre
continua.
Nous en subissions, de plus en plus, les amères conséquences. Peu à peu, nous fûmes au bord de
la famine et cela en plein village agricole !
En 1916, fini ! Plus de boulanger. Chaque famille recevait une ration de ce que l'on osait
appeler de la farine. Avec cette mixture, il fallait se débrouiller pour faire son pain. Mon
père qui avait déjà fait le terrassier, puis le maçon, essaya de faire le boulanger. Quel
désastre ! Ce qui sortait du four - un simple four de cuisinière - était une masse flasque et
si lourde qu'aucun estomac n'aurait pu la supporter. Et d'ailleurs, comment l'avaler ?
Ma mère parvint, tout de même, à en faire quelque chose de mangeable sous forme de crêpes. On
essayait de tartiner le produit avec du saindoux ... quand on en trouvait. D'une famille à
l'autre, on se passait des recettes.
Rares, heureusement, étaient ceux qui ne possédaient pas un lopin de terre pour y cultiver
quelques légumes. "Légumes" ?
Hum ! Hum ! Surtout des rutabagas !
Ah ! Les soupes aux rutabagas ! Essayes en ! Bon appétit !
Mais n'avez-vous pas appris, cher lecteur, que le comité de ravitaillement distribuait du
lard américain ?
Eh oui ! C'est vrai. Ce prétendu lard américain, pas même un Esquimau n'aurait pu le manger.
Quand il y avait du charbon ou du Schlamm, on le faisait fondre et il en sortait un jus qu'on
lapait avec une faisant fonction de tartine. Et les cultivateurs, direz-vous ? Eh bien ! Les
cultivateurs cultivaient ... pour eux. Pour eux et pour les Allemands qui réquisitionnaient la
moitié des récoltes. La moitié? Laissez moi rire. Disons la moitié de ce qui n'était pas
planqué dans des cachettes bien camouflées puis vendu au marché noir. Des gens venaient de Mons,
de Liège, de Bruxelles et, au ris que de les voir saisis par les "Feldgrau", emportaient du
beurre, du saindoux, du pain, du jambon, que sais-je encore ?
Tout cela bien sûr à prix d'or. Certains fermiers redoutaient la fin - pas la faim - de la
guerre.
Lors des moissons, nous allions glaner. Voilà bien une activité inconnue de nos jours. Après
le passage des moissonneuses mécaniques, pas mal d'épis restaient éparpillés sur le sol. Il
suffisait de les ramasser. Avec les quelques kilos ainsi récoltés, on allait au moulin et on
en sortait avec un petit supplément de farine.
Du gâteau pour le dimanche.
Mais, nous, les gosses, nous glanions encore bien autre chose que des épis. Les prairies et
les bois étaient jonchés de bottes de cartouches !
Imaginez ça ! Des gosses qui allument un gros feu de bois. Ils y lancent trois, quatre,
parfois davantage, des paquets de vingt cartouches françaises ou allemandes. Après quelques
secondes, quel feu d'artifice !
Bien entendu, nous, les méchants gamins, étions à l'abri, qui dans un fossé, qui derrière un
arbre. Mais, au village, c'était la terreur I Les cinq ou six vieux "Landsturm" qui occupaient
l'hôtel Guyot, coiffaient leur casque, armaient leur fusil et, baïonnette au canon, faisaient
irruption sur la place. A ce moment là, finies les explosions.
Tout désorientés, ces valeureux guerriers ne savaient où donner du casque à pointe. Mais nous
qui les avions mis en alerte, nous n'avions pas le plaisir de les voir penauds. Nous ne
pouvions tout de même pas faire notre feu d'artifice au milieu du patelin !
C'est alors qu'un d'entre nous - je ne sais plus qui - a trouvé un truc génial. Avec ça, on
ferait éclater la pétarade sur le mur même de la Kommandantur !
C'était simple comme toutes les grandes inventions. Dans les ruines traînaient des clés
d'écurie ou de grange. De grandes clés creuses. Bourres le tube avec le soufre d'une dizaine
d'allumettes. Introduisez un clou dans le tube. Reliez le clou à la poignée par une ficelle.
L'engin est prêt.
Prenez la ficelle en main et tapez la tête du clou sur n'importe quelle surface dure et vous
obtiendrez une explosion qui vous claquera aux oreilles.
Imaginez six ou sept gamins qui jouent à ce jeu-là sur le mur de la Kommandantur et vous aurez
du spectacle l Casque à pointe, fusil, baïonnette, irruption sur la place. Il n'y a rien là
que quelques gosses qui jouent au mouchoir. La semaine suivante, tout recommence. Rien sur la
place, sinon une grosse bonne femme poussant une brouette chargée d'un panier de linge.
Nous, les "bandits", nous nous étions éclipsés et regardions la scène derrière les pierres
tombales du cimetière qui, en ce temps-là, se trouvait à quelques mètres de l'hôtel Guyot-
Kommandantur.
Notre troisième démonstration tomba à plat. Un seul Allemand sortit, sans arme, sans casque,
comme un curieux intrigué par un phénomène étrange. La farce ne prenait plus. Nous n'avons pas
insisté. De plus, les allumettes devenaient introuvables.
Pendant ce temps de "jeux interdits", continuait à tourner la "noria" des cadavres, cadavres
qui se ramassaient à la pelle. Vingt Français pour un Allemand. Sur la route de Redu, face au
bois du Bôlet, des croix, des croix, des croix, jusqu'à l'horizon. Très peu portaient un nom.
Rien que des noms français.
C'est en 1923, je crois, que l'actuel cimetière militaire franco-allemand fut inauguré, sous
l'impulsion principalement,sinon totalement, de Maître Thomas Braun, C'est à lui certainement
que revient le mérite de la commémoration annuelle de la bataille et l'hommage aux victimes
des deux camps. C'était avant 40 ! ...
Mais revenons aux réalités de 1915. Peu à peu, certains fugitifs de 1914 rentraient et
trouvaient souvent leur maison incendiée ou à moitié détruite. Ils donnaient bien de la
besogne à Edgard Henrion, notre bourgmestre qui s'activait à les loger vaille que vaille. Tout
le monde mettait, comme on dit, la main à la pâte pour que chacun, au plus vite, se refasse un
foyer, souvent réduit à deux pièces et une étable.
S'enfuyaient les jours, passaient les semaines et les mois. On se sentait installé dans le
provisoire, dans le cours monotone des saisons. Et puis, un beau jour, grand branle-bas. Le
Kaiser Guillaume II en personne allait traverser le village. Comme des nuées de moustiques,
des "Feldgrau" s'abattirent sur le patelin. Tous les balais furent réquisitionnés ainsi que
leurs propriétaires.
Pas un grain de poussière ne pouvait offusquer la vue de Sa Majesté. Que c'était comique de
voir ce ballet des balais !
Après ça, sur la route propre et luisante, plus un chien, plus un chat. Quelle catastrophe si
une vache insolente s'était payée une petite promenade quelque peu "flatteuse" ! Rien de
semblable n'eut lieu et le Kaiser passa. Quand ? Comment ? Certainement pas à bicyclette !
Personne ne l'a vu. Il y eut tant de va et vient d'automobiles - pas de chevaux - malheureux !
Que le Seigneur de la guerre - le "saigneur", osaient dire les mauvaises langues - ne fut
reconnu de quiconque. L'Histoire n'a pas retenu l'événement, mais, pour nous, Ardennais isolés,
ce fut une distraction qui rompait la monotonie des jours. J'ai dit : "monotonie". Elle se fit,
un jour, terrifiante quand elle commença à nous apporter le son du canon. Le canon de Verdun !
Pendant des semaines et des mois, jour et nuit, le pilonnage effroyable nous faisait imaginer,
à nous qui avions vécu une bataille, ce que devait être cet enfer où les damnés en uniforme se
faisaient écrabouiller.
Mais on s'habitue à tout et, avec la canonnade comme bruit de fond, la vie, vaille que vaille,
continuait. La vie et, bien sûr aussi, la mort. Comment oublier les funérailles dramatiques de
l'épouse d'Honoré Lambin? Il était l'image même de l'homme au désespoir. Mais qui aurait pu
imaginer ce qui allait se passer au cimetière ? Les prières terminées, ce fut le drame. Le
malheureux s'est jeté sur le cercueil, l'a embrassé en sanglotant, en gémissant avec tant de
désespoir que tous, depuis le curé, jusqu'au plus jeune enfant en passant par les adultes les
plus insensibles, en restaient figés d'émotion et de douleur partagée. De ma vie, je n'ai
jamais rien vu de plus dramatique. Tout un village immobile et retenant son souffle entre les
murs d'un cimetière où un homme désespéré tentait d'arrêter le destin. Le malheureux,
finalement, s'évanouit et un groupe d'amis, accompagné de quelques braves femmes, l'emporta
chez lui. Pendant des semaines, il n'en est plus sorti. Il y eut, bien sûr, pendant ces quatre
ans de guerre, d'autres deuils, d'autres funérailles dont celles d'une petite fille de huit ans,
morte du croup.
Et celles du fermier de l'Allemoine. La ferme de l'Allemoine étale son corps de logis, ses
étables et ses granges à environ deux kilomètres du village en direction de Paliseul. Nous
étions à l'automne de 1916. Ce jour-là, défila en direction de l'Allemoine, une kyrielle de
petites voitures occupées par un homme, parfois par un homme et une femme. C'étaient les gros
fermiers des environs qui se dirigeaient vers la mortuaire au pas mesuré de leur cheval. Ils
venaient, vêtus de -noir, aux funérailles de leur compère, en affichant un air de circonstance
qui aurait trompé les plus perspicaces. Quand, vers 16 heures, je les vis repasser, la
circonstance ne semblait plus peser lourd sur leur coeur. Le visage cramoisi, faisant claquer
leur fouet, ils dévalaient ventre à terre la pente qui les amenait aux ponts de la Lesse.
Bacchus aidant, ils sont tous rentrés chez eux, indemnes.
C'est à peu près à la même époque, si mes souvenirs sont bons, que se produisit un événement
tragi-comique à peine croyable. C'est la vieille servante qui donna l'alerte. Elle se
précipita à l'hôtel Guyot en clamant : "Vla l'Golinvaux qu'est tumé meirt !"
Coiffé de son éternel et informe chapeau - un homme de qualité ne sort pas sans chapeau,
voyons ! - le père Guyot traversa la route et pénétra solennellement dans la maison de
Golinvaux.
Pâle et raide, Golinvaux gisait sur le sol, au pied d'un escalier. Une demi-heure plus tard,
dans tout le village, la nouvelle se répandait : "Golinvaux est moër !" Une heure plus tard,
il était couché sur son lit, en toilette funéraire, un chapelet entre les mains, deux cierges
à ses côtés, un crucifix au dessus de sa tête et, sur la table de nuit, une branche de buis
trempant dans un bénitier.
Qui aurait pu deviner que Golinvaux ne mettait jamais les pieds à l'église ? Les rites
funéraires ne souffraient pas d'exception et s'accomplissaient, avec la précision d'une
mécanique, grâce à des personnes spécialement douées pour cette oeuvre de miséricorde. Guyot
qui était doté d'un des deux téléphones du village - l'autre étant un privilège du maïeur -
avertit le docteur Dubois à Libin. Il viendrait le lendemain pour faire le constat officiel.
Dans l'attente des funérailles, comme toujours en ce temps-là on veilla le mort. Pendant le
jour, c'était le rôle des femmes: elles se relaient par groupe de trois ou quatre et récitaient
le chapelet. Dès la tombée du jour, c'était le tour des hommes qui, eux étaient seuls à se
relayer de deux en deux heures.
Ce jour-là, le premier à prendre la garde fut le cordonnier. Or, le cordonnier, surnommé
(pourquoi ?) le "Mayon" - orthographe incertaine - était accablé de besogne. Des souliers
neufs, on en avait à peine le souvenir. Alors, en vue de l'hiver, chacun faisait réparer,
vaille que vaille, de vieux croquenots qu'en temps ordinaire, on eût jetés sur le fumier.
Le Mayon prit son tour de garde mais, en catimini, il transporta son trépied et son matériel,
dans la chambre mortuaire et se mit, sans plus de cérémonie, à faire son boulot, éclairé de
quelques bougies. Absorbé par son travail, il ne comprit pas tout de suite ce qui lui arrivait ...
Derrière lui, quelqu'un avait parlé. Quelqu'un ? Mais ! Le Mayon faillit avaler le clou qu'il
maintenait entre ses lèvres. Le mort bougeait, le mort parlait : "On ne tape pas la semelle
quand on veille les morts. A côté du cordonnier surgit le fantôme de Golinvaux. Un fantôme à
poigne qui se mit à le secouer sans ménagement. Le Mayon a raconté qu'il s'était évanoui.
Evanoui ? Peut-être. Pétrifié certainement.
Le fantôme, quant à lui, avait enfilé ses gros souliers et, en longue chemise, sortit dans la
nuit. Je te laisse deviner, cher lecteur, les émois, la terreur, les évanouissements, les
appels au secours qui se succédaient au fur et à mesure que le "fantôme" allait frapper aux
portes. Le couvre-feu mit fin à la sinistre farce. Golinvaux rentra chez lui, se mit au lit,
passa une bonne nuit et ne défunta que quelques années plus tard. Un phénomène de catalepsie,
hasarda le docteur qui n'avait jamais connu un cas semblable.
Et puis la vie continua. La terre tournait comme elle en avait pris depuis si longtemps
l'habitude, les saisons succédant aux saisons. Mais l'hiver de 16-17, celui-là, personne ne
pourrait l'oublier. Un mètre de neige au moins et un thermomètre dont le mercure, la nuit,
n'était même plus visible. Chose curieuse, je ne me souviens pas d'avoir eu tellement froid.
Dans mes souvenirs, je retiens la hauteur de la neige et nos courses en traîneau. Sans jeu de
mots, nous, les gosses, nous faisions des trains de traîneaux et dévalions le village du haut
en bas. Quel sport !
Oui, mais nous rendions la route glissante et un malotru a voulu nous en empêcher, Devant sa
maison, il avait semé de la balle d'avoine ! Imaginez ce que cela peut donner un traîneau
lancé à toute vitesse et qui, brusquement, est stoppé net, en plein élan. Intolérable ! Nous
aurions volontiers mis le feu à la maison du salopard. C'était un peu risqué et puis, personne
n'avait d'allumettes ! Alors quelqu'un, je crois que c'est Léopold Chaudrel, a trouvé la
solution.
Nous étions une bonne douzaine de traîneaux.
Chacun est rentré chez soi et, moins d'une heure plus tard, nous étions tous au point de départ,
armés d'un "ramon". (pour les ignorants, je me dois d'expliquer qu'un "ramon" est un balai
composé de branches de genêts.)
Et nous voilà en piste. Imaginez une bonne dizaine de traîneaux - de nos jours, on dit des
luges - à trois de front, fonçant sur l'obstacle, faisant voler en l'air la paille d'avoine
éparpillée par le vent.
Fureur et imprécations du gros balourd qui, tout de même, n'essaya pas de recommencer son
épandage.
C'est en mars 1917 que le dégel commença. Ah ! Ce qu'on a pu patauger !
Mais voilà que ce printemps revenu, travailla, sans doute, le cerveau du fils Bartel. Dans le
bas du village, en direction de Villance, sa grande roue actionnée par le Ry d'Chane, le moulin
Bartel était posté à la limite du village. Le meunier était aveugle mais son grand lascar de
fils voyait pour deux. Fameux atout pour un braconnier.
Braconner ! mon Dieu, ce n'est pas un crime, mais tirer sur des uhlans, c'était au moins une imprudence.
Léon Lebutte et moi, par un curieux hasard, l'avons vu accomplir son exploit. Nous avons vu
tomber un des deux uhlans, l'autre fuir au grand galop et le fils Bartel rentrer dans le bois.
Mais vous pensez bien que l'histoire n'est pas finie. Deux jours plus tard, le village était
investi par des centaines de "Feldgrau", à casque à pointe. Le jour à peine levé, les portes
étaient enfoncées à coups de crosse et tous les habitants, beaucoup en chemise de inuit, se
virent entassés sur la place. Nous, les enfants, pouvions rester chez nous. Mais, sur la place,
quel spectacle ! Tremblants et terrorisés, les malheureux Maissinois durent subir la diatribe
interminable d'un, officier jouant au Savonarole pour s'indigner d'un acte barbare, indigne
d'un peuple civilisé, etc. etc.
Comme le uhlan n'était que blessé, grâce à la clémence, à la générosité, etc. etc. des autorités
militaires, personne ne serait fusillé.
Ouf ! Oui, mais le bourgmestre désignerait deux hommes valides qui seraient déportés en
Allemagne comme travailleurs. Amen !
Le bourgmestre n'avait qu'à se débrouiller. C'est ce qu'il fit en tirant publiquement au sort
le nom des deux victimes. Je ne me souviens pas de leurs noms et je ne sais pas ce qu'ils sont
devenus!
Le fils Bartel, lui, court toujours...
Façon de parler car, en fait, il est au cimetière depuis longtemps.
Dès notre retour, en février ou mars 1915, mon père avait rouvert l'école et entreprit une
"lutte scolaire" assez inattendue. Ouvrir l'école, rien de plus facile, y amener les élèves,
ce fut une croisade épuisante. Les gamins, ça aide dans la maison ou dans la ferme. Alors vous
pensez bien que l'école non seulement, on s'en balance mais on ne veut pas en entendre parler.
L'instruction obligatoire, qui s'en souciait ? C'était une idée de gens de la ville qui, eux,
"avaient les moyens". Heureusement, mon père reçut l'aide efficace du maïeur et de Jean Servais,
le facteur. A eux trois, par la persuasion et la menace, ils finirent par remplir l'école des
garçons. Pour les filles, les religieuses s'étaient bien débrouillées. Elles avaient repris
les classes après la Toussaint sans rencontrer de grande résistance. Mais pour les garçons,
rien n'était jamais assuré.
Je me souviens qu'un jour, en pleine matinée, une virago fit irruption dans la classe pour
exiger de récupérer son rejeton. C'est la seule fois que je vis mon père rouge de colère.
Comme une flèche, il traversa la classe, sans ménagement, saisit la commère par le cou et la
lança, comme une botte de foin, hors de la classe.
Sans le vouloir, il venait d'asseoir pour de bon son autorité. Comment s'y prenait-il pour
diriger, occuper, instruire des garnements de six à quatorze ans dont la plupart ne savaient
pas ou ne savaient plus ni lire, ni écrire ?
Je me le demande encore. Toujours est-il que personne ne restait une minute inoccupée. Un jour,
ce devait être en 1916, nous reçûmes la visite d'un inspecteur. Il nous questionna tous, l'un
après à l'autre et rares furent ceux qui restèrent à quia. L'inspecteur ne cachait pas sa
surprise. C'était un homme bien habillé - quel phénomène ! - qui nous arrivait de Paliseul ...
à bicyclette !
Un civil à bicyclette ! Depuis 1914, on n'avait plus jamais vu ça.
Notre école qui était communale, n'était pas, pour autant, anticléricale. Le curé du village
était autorisé à y interroger les élèves sur leurs connaissances en catéchisme. En fait,
c'était une manière d'inspecter l'instituteur. Un bon curé aurait pu faire cela amicalement.
On était loin de compte et sans avertir, sans frapper à la porte, à l'improviste, il faisait
irruption dans la classe, s'asseyait, toujours coiffé de sa barrette, derrière le pupitre
professoral et posait des questions si brutalement que nous en restions sans voix. Mon père
s'installait au fond de la classe, sans dire un mot. Il se savait mal noté par l'homme en
soutane mais il s'en fichait royalement.
"Dieu, disait-il, était parfois bien mal servi par ceux qui prétendent le représenter."
Le bâtiment dont l'école n'était qu'une partie n'existe plus, à présent. Il a été rasé pour
faire place à l'automobile. Oui, depuis quelques années, à la place de l'école et du monument
aux morts, s'étale un carrefour de cinq routes.
Mais au temps dont j'écris, l'édifice comprenait, outre l'école,deux autres salles dont une,
à l'étage, pour les réunions du conseil communal et, au rez-de-chaussée, faisant pendant à la
classe, une autre grande pièce dont j'ignore la destination précédente.
Pendant la guerre, on y servait ce qu'on appelait la soupe scolaire. Qui faisait la soupe, qui
fournissait les ingrédients, qui procurait les bols et les cuillers, qui faisait la vaisselle ?
Je ne m'en souviens plus.
Ce que je me rappelle, c'est que chaque jour, vers 10 heures, on y réunissait, ô scandale; les
garçons et les filles !
Pas aux mêmes tables, malheureux ! Mais en ces temps, c'était déjà une audace.
Scandale ou pas, Il n'y avait pas d'autre organisation soupière possible. Bien entendu, nous
étions sous haute surveillance. Une surveillance qui, peu à peu, se fit débonnaire. On n'osait
pas s'interpeller mais, d'abord timidement, puis à pleine voix, nous nous sommes mis à chanter
ensemble; "Flotte, petit drapeau..." Quelle joie, quelle fierté de braver les "Feldgrau" !
Et, le 21 juillet, éclata, la Brabançonne. Nous l'avions apprise à l'école, malgré l'interdiction
de l'occupant. A part cela, la vie continuait, répétitive et monotone jusqu'au jour où ...
Quelle stupéfaction ! Une apparition ! Oh rien de surnaturel, rassurez-vous, mais, pour être
naturel, ce ne fut pas moins sensationnel. Une épicerie sur roues. Ce n'est déjà pas banal
mais qu'en penserez-vous quand vous saurez que l'épicier n'était rien moins que le comte de
Ridremont.
Un comte épicier, ce devait être une pièce unique, si pas dans le monde, du moins dans nos
Ardennes.
Le comte de Ridremont avait acheté le château de Pinval. Et c'est de là, qu'avec son épicerie
roulante, il sillonnait le pays depuis Wellin jusqu'à Bertrix et de Saint-Hubert à Paliseul.
L'occupant n'y a vu que du feu, tout comme les gens du pays d'ailleurs.
Ce n'est qu'après la guerre qu'on a su. Pendant des mois, par tous les temps, il circulait
avec son drôle de machin et sa marchandise.
Quel drôle de machin, en effet, Imaginez deux grands panneaux qui s'appuient sur les
marchepieds d'un landau et se rejoignent, en oblique, à leur sommet. Accrochés à ces panneaux,
des casiers tiroirs. Combien ? Ici, ma mémoire me trahit. Ils devaient être environ six de
chaque côté. Dans ces casiers, que de merveilles des boutons, des lacets, des allumettes et
même, figurez-vous, des chemises, des chaussettes, des galoches, des bonbons, mais oui, et
aussi des espèces de grandes couques, mangeables quand elles avaient trempé au moins une heure
dans un liquide.
Où se procurait-il ces marchandises qu'on ne trouvait nulle part, chez nous, en ce temps-là!
Je ne l'ai jamais su. D'ailleurs je ne me posais pas la question.
Les prix affichés étaient exorbitants. Mais ça, c'était pour la galerie, je veux dire, pour
les Allemands. Le comte se fichait pas mal du prix qu'on lui payait.
Ce qu'il cherchait, c'était des contacts. A Maissin, son "contact" était l'hôtelier Guyot chez
qui s'était installée la Kommandantur. Imprudents Fritz ! A leur insu, Guyot comprenait
parfaitement l'allemand. Aucune communication téléphonique ne lui échappait, surtout celles
des hauts gradés de passage.
Vous aurez compris, cher ami, que le comte de Ridremont faisait de l'espionnage au profit des
alliés. Je ne crois pas qu'il ait été découvert.
Les "apparitions" quasi hebdomadaires du comte épicier étaient bien insuffisantes pour
distraire la jeunesse. Du pain et des jeux ! La plupart des jeunes avaient trop peu de pain et
pas de jeux.
Un beau jour toutefois, on inaugura le jeu de quilles.
C'est sur ce jeu de quilles, souvenez-vous, que nous avons failli être fusillés en août 1914.
Le père de Léon Lebutte, mon copain, avait reconstruit sommairement sa maison, rouvert le café
et réinstallé le jeu de quilles. C'était la grande distraction du dimanche et on y jouait pour
de l'argent : des Pfennigs et des Marks. Eh oui ! seul l'argent de l'occupant avait cours et,
après la guerre, ce fut un problème national de reconvertir en francs belges, les Marks allemands.
Le jeu de quilles, c'est bien, mais, à part pour quelques enragés, ça commençait à devenir
monotone. Un "bistrotier", sans foi ni loi, l'a vite compris et, incroyable mais vrai, a
organisé un bal.
Quel scandale! "C'est le plus court chemin vers l'enfer, tonnait le curé, à qui des âmes
pieuses étaient venues apporter l'abominable nouvelle.
Mais nous étions déjà en 1917 et bientôt, il ne fut plus question ni de quilles, ni de bal.
Un beau jour - si l'on peut dire - notre village ne fut plus qu'une caserne. Les Allemands
envahisseurs se firent envahissants. Les écoles, les hangars et les granges servirent de
dortoirs à tout un bataillon du génie.
Sa mission était simple. Utiliser le tram pour en transporter les rails qu'ils enlevaient au
fur et à mesure au départ de Poix St. Hubert. Ils les chargeaient sur de grandes plates-formes
qui prenaient la direction de la France.
Avec les rails, ils emportaient aussi les wagons. Quelque chose qu'ils voulaient décisif se
préparait sûrement ! Une revanche du cuisant échec de Verdun ? Pas besoin d'être voyant
extralucide pour le deviner.
Le démantèlement du tram se fit en été, si je me souviens bien. Comme c'était triste ! Ce tram
était si amusant quand il s'essoufflait sur la montée depuis la Lesse.
Bizarre tout de même cette locomotive qui suivait les rails. Mais comment ? Elle n'avait pas
de roues. Quel curieux engin ! Crachant, fumant, glissant au-dessus des rails et remorquant
des wagons qui, eux, roulaient sur de vraies roues.
Arrivé au passage à niveau, Jules Borre, un des deux machinistes, sautait en marche,
bondissait devant la machine infernale pour manoeuvrer un lourd levier. Du coup, miracle, le
tram changeait de voie. C'était fascinant. On pouvait voir ça tous les jours à la même heure
ou à peu près ... Chaque fois, on était rassuré: Jules Borre n'avait pas trébuché. Mais
désormais, plus de tram ! Le dernier rail enlevé, l'équipe des "dérailleurs" alla s'installer
plus loin, peut-être à Paliseul d'abord, puis, évidemment, à Bouillon, station terminus.
Du jour au lendemain, on passa du tohu-bohu au calme plat. Enfin on se retrouvait entre soi !
Même les vieux "Landsturms" de la Kommandantur" partageaient notre contentement d'être délivrés
de leurs encombrants compatriotes.
La vie courante put reprendre. Sans doute, grâce à la soupe scolaire, les écoles retrouvaient
leurs élèves. Quant aux travaux agricoles, rien ne pouvait les arrêter.
Le ravitaillement, hélas ! ne s'en trouvait guère amélioré. Même plus de lard américain.
Evidemment, puisque les U.S.A. étaient entrés en guerre contre les Allemands. La santé de la
plupart des enfants donnait des signes inquiétants de faiblesse. A l'église, pas une messe ou
un salut sans qu'un ou plusieurs enfants ne s'évanouissent.
Quand cette guerre maudite allait-elle finir ! Visiblement, ce n'était pas pour bientôt. La vie
du village se poursuivait, parfois ponctuée d'événements tristes, comiques ou sensationnels.
Parmi ces derniers, c'est l'atterrissage forcé d'un avion allemand qui tient la première place.
Son pilote devait être un as car, sur une courte distance, dans des prairies pas très
horizontales, il avait posé, indemne, son engin.
En panne d'essence, Mais quel sensation dans le patelin !
En moins d'une demi-heure, autour de l'appareil, ce fut la cohue. Chose difficilement
explicable, les trois membres de l'équipage avaient abandonné leur machine pour se rendre au
village.
Bien sur ! Il fallait avertir la base aérienne mais, pour cela, un seul aurait suffi.
Sans doute, comme leur appareil, devaient-ils faire le plein! Mais, pour nous, quelle aubaine!
D'abord, à distance respectueuse, on en faisait le tour, puis, peu à peu, on s'enhardissait,
on tâtait, on se souvenait du petit "coucou" français égaré qui, en août 14 avait atterri dans
une prairie.
C'était une libellule comparée à cet épervier.
Quelle envergure ! Trois moteurs ! Et à l'intérieur ? On tâchait d'y voir du dehors ... Personne
n'osa trop vite se hisser sur le plancher. Mais la curiosité l'emporta. Et, puisqu'il n'y avait
personne pour nous en empêcher, eh bien, on se hasarda. Que de place ! Que de manivelles Et
tous ces cadrans et tous ces leviers !
On se faisait la courte échelle pour aller, l'un après l'autre, contempler ces merveilles.
Jusqu'au moment où ... Eh oui, je connais quelqu'un qui, sur son arrière-train, reçut un bon
coup pas bien méchant - du plat d'une baïonnette.
Venant de je ne sais où, une garde militaire était arrivée. Dès ce moment, le public fit
cercle à bonne distance. Le charme était rompu. Très vite le groupe des derniers curieux se
dilua.
C'était le moment de rentrer chez soi.
Le lendemain, l'oiseau s'envola.
Mais quel sujet de conversation ! Et moi, j'ai vu ceci ! Et moi j'ai vu cela ! Et moi je l'ai vu
s'envoler ! Oui, mais comment ça tient-il en l'air, cet énorme machin ? Qui aurait pu deviner
que 25 ans plus tard ...
Plus nombreux que les avions, en ces temps sans radio, volaient ... les "canards". "Moi, j'ai
entendu que..." "Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui ..." "Moi, je te dis que..." "Et moi,
disait l'homme de bon sens, je suis sûr qu'on est sûr de rien !"
Pendant ce temps, les Allemands se fichaient des"canards" mais s'intéressaient aux chevaux.
Plus la guerre durait, plus il y avait de réquisitions de chevaux.
Fameux problème pour les fermiers. Comment "planquer" les chevaux, et les soustraire à la
réquisition ? Il fallait, au moins, garder les meilleurs, ceux là même que l'ennemi convoitait.
Pour cela, on s'adressait à Rossion, le maréchal-ferrant. Lui, d'un cheval fringant, il
faisait une haridelle boiteuse, impropre au service. Plus tard, le danger passé, on retaperait
la brave bête.
Mais, pour nous, les gosses, la forge de Rossion, c'était à la fois le paradis et l'enfer. Ah !
Quel plaisir d'aller tirer sur le soufflet paradis pour activer le feu de l'enfer ! Rossion,
c'était plutôt Vulcain, mais, en ce temps-là, Vulcain ne faisait pas encore partie de nos
connaissances.
Nous étions seulement heureux d'être les anges du feu. Nous dépassions la contradiction.
Vulcain, dans sa pénombre, n'admettait qu'un ange à la fois. Avec quel respect mêlé d'un peu
d'effroi, on se glissait dans l'antre des ténèbres pour saisir la poignée du soufflet!
Vulcain-Rossion, géant bardé de son tablier de cuir se tenait dans la pénombre comme une
puissance redoutable.
Dès que, grâce au soufflet, le feu éclatait, Rossion apparaissait. Dans une main, il tenait
un marteau et, dans l'autre, une grande pince enserrant un objet en fer qu'il plongeait dans
le feu.
On soufflait, on soufflait, le feu rugissait et le fer rougissait. Porté à incandescence, il
passait du feu à l'enclume. Alors, c'était le feu d'artifice. Le marteau de Vulcain faisait
jaillir des centaines d'étoiles qui se perdaient dans l'immensité de la forge. Un bing-bang
miniature. Mais le rôle du souffleur était fatigant, épuisant même pour nous, les gosses
sous-alimentés.
Madame Rossion nous apportait souvent une tartine, une vraie, une tartine beurrée ! Pas
toujours bien sûr!
Avec un mari, travailleur de force, il lui fallait mettre de côté pour lui ce que les fermiers,
mine de rien, lui glissaient dans la poche du tablier ou bien "oubliaient" dans le corridor de
la maison.
Pour nous, les gosses, la forge était une attraction permanente, belle sans doute, mais sans
rien d'inattendu.
Par contre, pour les adultes comme pour les garnements que nous étions, la grande attraction,
c'était les disputes publiques : Mr.X contre Mr.Y ou Mme Z, ou l'inverse. X sortait devant sa
porte et attendait, pour l'interpeller que passe Y. Et la scène éclatait. "Le chien de X
chassait les poules d'Y." "Le gosse d'Y piétinait les plates-bandes de Z." "La vache de Z
mangeait le trèfle de X." "Et le fils d'Y qui courait après la fille de B."Et le gamin de C
qui volait la salade de B." " Et Madame D qui ne disait plus bonjour à Madame F."
Et patati et patata. A la suite de cette accusation initiale commençait le grand discours
comminatoire dans quoi se déversaient les rancoeurs, les antipathies, les reproches, fondés ou
non que X, Y ou Z et les autres nourrissaient en rongeant leur frein jusqu'au jour où...
Souvent, dans les replis secrets de la conscience, se dissimulaient des oppositions politiques.
Avec ou contre ? Avec ou contre qui ?... Mais le curé, bien sûr. Le maïeur lui, était contre.
Le reste se devine aisément.
Et voilà qu'un beau jour - beau ? - la bombe éclata. Imaginez cela. Le grand chef de "droite"
épouse l'égérie de "gauche" ! Eclats de rire, ricanements, indignation selon le cas et le
caractère.
C'est que, comme le susurrait un loustic, il y avait un "polichinelle dans le tiroir".
Le jour du mariage, grande réconciliation autour de la table. Le grand chef, gros fermier,
avait de quoi garnir les estomacs. Grande rigolade. Grande ripaille. Ce jour-là, on sortait du
temps.
Et puis, le lendemain, le temps ayant repris la funeste habitude de s'écouler, reprirent aussi,
en catimini, les hostilités villageoises. Et les cancans. Voilà-t-il pas que le petit bossu,
réparateur de chaussures, épouse une jeune fille, mère de quatre enfants. ! Les langues les
plus agiles furent prises de frénésie. Sur les unes, le sucre, sur les autres, le vinaigre ou
le vitriol.
Ah! On avait de quoi raconter à la vesprée ou au lavoir.
Le lavoir ! Qu'il était utile et qu'il était beau ! Hors du village mais dans quel décor
merveilleux. Entouré d'une couronne de vieux chênes, creusé en plein air, à même la source,
c'était un lieu romantique à souhait et ... idéal pour laver son linge mais pas en famille !
Dans la pratique, c'était la mare aux cancans. Et on avait toujours de quoi jaser ... Surtout
quand "elle" revenait de Paliseul, celle-là qui faisait l'unanimité contre elle. On la voyait,
descendant furtivement d'une voiture automobile, conduite par un chauffeur en uniforme. Elle
"travaillait", dans un Etat Major. Nippée comme une princesse, elle venait, assez régulièrement,
faire visite à sa mère que rien, semble-t-il ne pouvait offusquer.
Dame ! Quand on est logé dans un abri de trois pièces, quand on a faim et qu'on vous apporte
des provisions de choix pour plus d'une semaine, les grands principes se glissent, silencieux,
derrière le buffet.
N'ayez crainte, ils réapparaîtront quand l'occasion sera favorable pour faire la leçon.
Mais nous voici arrivés, cahin-caha, en mars 1918. A peine sorti d'un pénible hiver de faim,
de brumes et de crachin, nous voici de nouveau envahis. Pendant des jours et des nuits, ce fut
une ruée ininterrompue de fantassins et d'artilleurs dotés de tout leur matériel. Caissons,
canons, ambulances, camions de toutes sortes se mirent à défiler.
Ils marchaient, "nach Paris", jusqu'à l'épuisement. Beaucoup, n'en pouvant plus, s'attachaient
à un véhicule et se laissaient traîner en titubant.
Combien de jours dura cette marée grise? Impossible de m'en souvenir ... Mais quelle saleté
sur la route! Eh oui ! Tout ce matériel était hippomobile. Et les chevaux, eh bien ! ça laisse
certains souvenirs...
Quelle crasse ! Disions nous. Quelle aubaine ! chantaient les fermiers.
Le calme revenu, la vie reprit son cours habituel.
Imprimé à Liège (sauf erreur) un journal, dont j'oublie le nom, paraissait, bien entendu sous
haute surveillance de l'occupant. C'était un diffuseur patenté de bonnes nouvelles, simple
instrument de propagande mais où les plus perspicaces avaient appris à lire entre les lignes.
Pendant des semaines, au début 18, le ton fut triomphal.
Et puis, peu à peu, il souffrit d'une crise de modestie et, en juillet, il disparut.
Que se passait-il, au juste ? Inévitablement, des bruits circulaient, contradictoires ou farfelus.
Et, un beau jour, ce devait être fin août 1918, on a compris.
Voilà-t-il pas que nos vieux "Landsturms" préparent leur "barda" ! Sacs, valises, paquets,
tout ça étalé mais bien en ordre devant la Kommandantur.
Embarqués dans un camion tiré par deux haridelles et déjà occupé par d'autres pauvres vieux,
ils disparurent un beau soir, en direction de Poix.
D'autres signes plus révélateurs de la débâcle allemande se manifestèrent bientôt. Il y eut
d'abord ... les automobiles. Les Etats-majors se déplaçaient en automobile. Je ne me souviens
pas de leur passage vers l'ouest. Mais, par contre, comment oublier leur retour.
Imaginez des roues sans pneu. Oui, je dis bien : sans pneus. Plus de caoutchouc dans les
arsenaux impériaux. Alors on a remplacé les pneus par des ressorts à boudin. Imaginez une roue,
garnie si on peut dire ! d'une vingtaine de ressorts à boudin, reliant la jante à un cerceau
d'acier.
Les tous grands chefs, eux, roulaient encore sur pneus en caoutchouc. Mais les Etats-majors,
les simples colonels, les petits Hauptman, secoués comme des pruniers, se mouvaient, vaille
que vaille, sur ces engins qu'il fallait réparer tous les vingt ou trente km.
Pourtant ces seigneurs de la guerre avaient intérêt à se hâter car ils savaient qu'ils
allaient être submergés par des hordes démantelées, débraillées, mais armées,qui leur feraient
payer cher la débâcle où ils les avaient menées.
C'est d'ailleurs ce qui eut lieu.
Comme un flot impétueux, les rescapés de la défaite firent une irruption sauvage dans les
communes qu'ils avaient traversées triomphalement trois mois plus tôt.
Mais c'était dans l'autre sens ! A l'aller, ils chantaient: "Gloria", "Victoria." Au retour,
ils braillaient l'Internationale !
Dans ce magma informe, certaines unités, pourtant, restaient bien disciplinées. Elles étaient
rares mais d'autant plus étonnantes. Encadrées par des chefs de qualité, marchant au pas,
l'arme à la bretelle, elles se faisaient conspuer sans broncher.
Ce qui, par ailleurs, était particulièrement pénible à voir c'étaient les chevaux. Etiques, la
peau toute couturée, couverts de pansements, ils tenaient à peine debout. Certains s'affalaient
et ne se relevaient plus.
Un vétérinaire allemand leur donnait le coup de grâce.
La mort des chevaux avait une conséquence évidente. Canons, caissons, véhicules militaires
restaient à l'abandon, ce qui n'était pas sans danger pour les gens du village.
Il faut croire que, dans toute cette pagaille, les chemins de fer n'étaient pas totalement
désorganisés, puisque, venant de Bruxelles, ma grand-mère est venue me chercher.
Souffrant, depuis au moins un an, de crises d'asthme extrêmement graves, pouvant, selon le
médecin, devenir mortelles, je devais changer d'air et faire de la natation ... si possible!
Guidé et protégé par ma grand-mère, je ne sais plus comment je suis arrivé à Poix-Saint-Hubert.
C'est là que nous avons pris le train pour Bruxelles.
Aucun souvenir de ce voyage sauf, qu'à Namur, nous avons dû nous réfugier dans un passage
souterrain, à cause, paraît-il, d'un bombardement aérien dont je n'ai rien entendu.
Nous sommes arrivés indemnes à Bruxelles et ici, se termine cette histoire qui m'a permis de
revivre des années décisives de mon existence et, peut-être d'intéresser l'un ou l'autre
lecteur ou lectrice.
Document gentiment envoyé pour l'enrichissement du site par Madame Jeanne Jeangout.
|
 Médecins de la Grande Guerre
Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Conférences
-
Conférences
-
![]() Articles
Articles
![]() Photos
-
Photos
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques